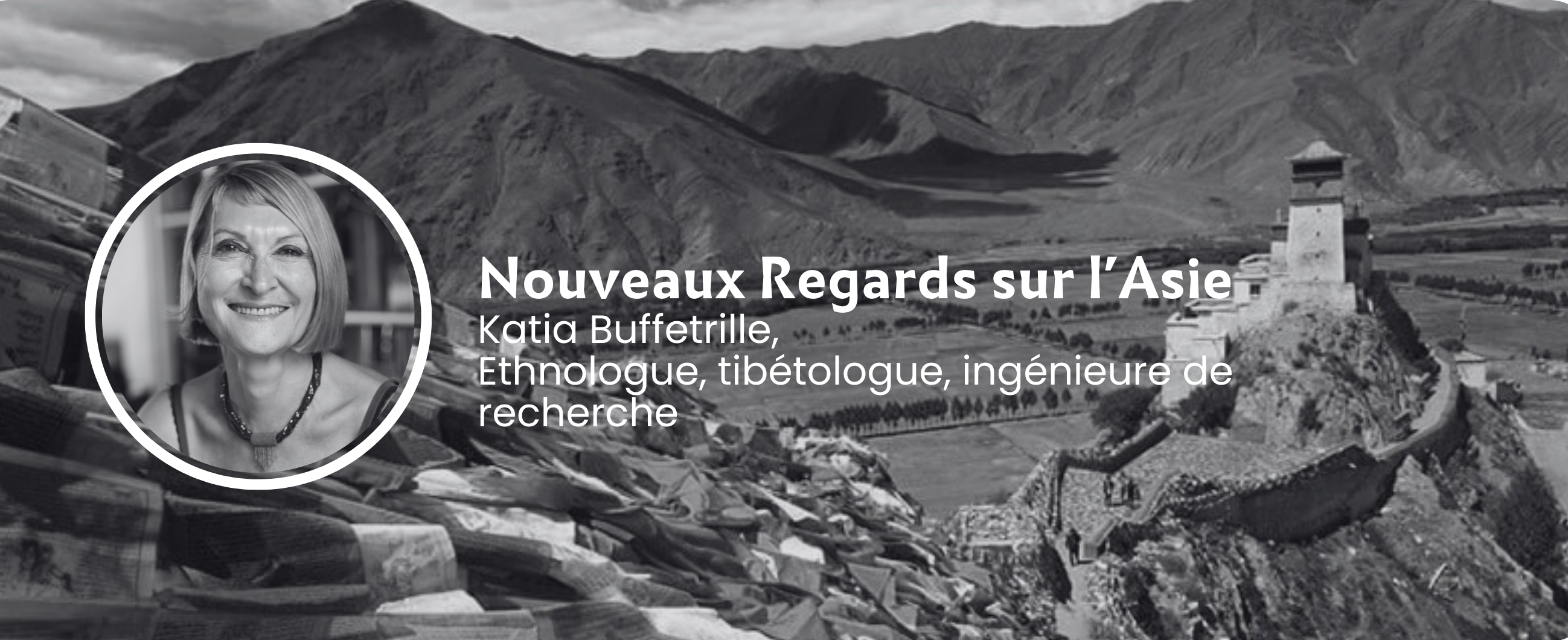
Jean-Raphaël Peytregnet : Ethnologue et tibétologue, vous êtes spécialiste de la culture tibétaine à la fois ancienne et moderne. Quelle est la situation aujourd’hui de cette « Région autonome du Tibet » (RAT), telle qu’elle a été administrativement découpée par Pékin, au même titre que celles du Ningxia, de Mongolie intérieure, ouïghoure du Xinjiang et Zhuang du Guangxi ?
Katia Buffetrille : La Région autonome du Tibet, fondée en 1965, n’a rien « d’autonome » car elle est totalement dépendante des financements et des décisions du gouvernement central. Depuis l’accession au pouvoir de Xi Jinping en 2012, le contrôle du Parti Communiste Chinois s’est considérablement renforcé dans tout le Tibet et particulièrement dans cette région.
La nomination de Chen Quanguo, ancien militaire, secrétaire du Parti de la RAT de 2011 à 2016, y est pour beaucoup. Il est à l’origine d’un système de surveillance particulièrement performant et intrusif qui s’est renforcé au fil des ans avec les progrès technologiques.
À cela, il faut ajouter un nombre de migrants Han qui ne fait qu’augmenter dans la RAT et qui est un des éléments de la sinisation que connaît le Tibet actuellement. Lors de ma dernière visite à Lhassa en 2024, j’ai été frappée par l’accroissement considérable de la population d’ethnie han par rapport à ce que j’avais connu en 2017, par la sinisation de l’espace : drapeau chinois sur toutes les maisons et édifices, religieux ou non, et le long des routes, l’installation en 2019 de pavillons chinois sur les stèles érigées devant le temple du Jokhang à Lhasa, dont l’une datant de 821/822 porte le traité de paix entre l’empire tibétain (VII-IX siècle) et l’empire Tang, la désacralisation des lieux religieux avec, par exemple, l’installation d’un restaurant KFC (Kentucky Fried Chicken) et d’une Pizza Hut le long du Barkor, le chemin de circumambulation qui entoure le temple du Jokhang, le temple le plus sacré du Tibet et l’utilisation de symboles religieux à des fins décoratives et touristiques : moulins à prières dans les gares ou autre lieu inapproprié, ou stupas le long des routes.
Quelle est l’origine du mot « Tibet » ? Comment les Tibétains eux-mêmes dénomment-ils leur terre ancestrale ?
Les Tibétains appellent leur pays Bö (Bod). Le nom Tibet semble avoir été emprunté au persan (Tibbat, Tibit, Tibbet) ou au mongol (Töböt). Ces formes persanes seraient basées sur la forme arabe Tubbat que l’on trouve dans des textes dès le IXe siècle, elle-même héritée peut-être du sogdien ‘Topet’. Le nom Tibet apparaît dès les XIe-XIIIe siècles dans les écrits de Jean de Plan Carpin (1180-1252), Guillaume de Rubrouk (1215-1295) ou Marco Polo (1254-1324).
En remontant encore plus loin, on trouve Töpüt dans des inscriptions turques du VIIIe siècle. Des chercheurs (Louis Bazin et James Hamilton) pensent que ces différents noms, qu'ils associent au turc töpä signifiant « sommet, hauteur », sont d'origine turco-mongole. Ils se seraient répandus par l'intermédiaire des Tuyuhun, un peuple appartenant au groupe linguistique turco-mongol, qui vivait entre le IVe et le VIIe siècle à l'interface des mondes chinois, turc et tibétain.
Les écrivains chinois contemporains utilisent le terme Tubo. De manière surprenante, ce terme Tubo a été utilisé au Musée Guimet dans le contexte de l’exposition sur « La Chine des Tang ». A l’époque Tang, les Chinois appelaient le Tibet Tufan, un terme qui aurait été prononcé Tubo d’après une lecture moderne. Pourtant, cette affirmation a été réfutée dès 1915 par le grand sinologue Paul Pelliot (1878-1945). Cette appellation, encore utilisée en République populaire de Chine pour parler de l’empire tibétain, lui permet de dissocier les Tibétains d’aujourd’hui de leur prestigieux passé impérial.
Le Musée Guimet avait montré en 2024 qu’il désirait se plier au diktat de la Chine en changeant l’appellation des salles d’exposition « Tibet-Népal » au profit d’un vague « Monde himalayen », une appellation qu’aucun scientifique sérieux n’utiliserait pour désigner le Tibet mais qui a l’avantage d’éviter le terme Tibet honni des autorités chinoises puisqu’il renvoie à un pays et à un peuple totalement distincts sur les plans culturel, linguistique, religieux, des Han, l’ethnie majoritaire à 92 % en République populaire de Chine.
Tout comme les Chinois exigeaient de Bertrand Guillet, directeur du musée de Nantes, que les termes « Gengis Khan, empire et mongol » ne soient pas utilisés dans l’exposition sur Gengis Khan en échange de prêts d’objets, on peut penser que des demandes de même type ont été faites auprès du Musée Guimet.
Mais alors que l’on observait, au musée Guimet, la disparition du terme Tibet au moment même où débutait l’année de commémoration des 60 ans de l’établissement des relations franco-chinoises marquée par quatre expositions sur la Chine avec prêt d’objets, le musée de Nantes, lui, avait renoncé à sa collaboration avec le Chine afin de respecter les « valeurs humaines, scientifiques et déontologiques » défendues par l’Institution. Cependant, en 2024, une magnifique exposition sur « Gengis Khan et la naissance de l’empire mongol » était organisée au musée de Nantes avec des objets provenant des collections nationales de Mongolie, de grands musées européens et des collections privées.
L’emploi de Tubo dans l’exposition sur les Tang est un moyen d’éviter de parler d’empire tibétain. L’absence de toute carte participe à cette confusion. Tout est fait dans cette exposition pour faire oublier que l’empire tibétain rivalisait en puissance avec l’empire Tang et que ce dernier le ménageait grâce à une politique de cadeaux et d'alliances matrimoniales.
Le terme Tubo est inconnu du grand public et connu des seuls spécialistes. Cela permet de l’utiliser, dans cette exposition, pour désigner un peuple, une époque, un style ou une culture. Ainsi, certains cartels portent la mention : « Dynastie Tang, époque tubo », laissant croire que Tubo réfère à une période de la dynastie Tang. Le but est de conduire les visiteurs à penser que ces « Tubo » étaient sous la dépendance des Tang. Le même processus est utilisé en ce qui concerne le Turkestan oriental afin de faire croire que les Ouighours étaient également sous la dépendance des Tang, ce qui est historiquement faux. Cela s’appelle réécrire l’histoire pour coller au nouveau narratif chinois.
Le terme chinois pour désigner la Région autonome du Tibet est Xizang. Il apparaît dans les sources chinoises sous la dynastie mandchoue des Qing (1644-1912). Les Tibétains n’utilisent jamais ce terme lorsqu’ils parlent tibétain. Son emploi a été réclamé en 2023 par des chercheurs chinois lors d’un colloque à Pékin. Depuis, toutes les revues chinoises en langues occidentales l’emploient et la Chine cherche à l’imposer également à l’étranger.
Que faut-il entendre par « Tibet historique » ou « Grand Tibet », termes auxquels le peuple tibétain semble très attaché ?
Le Tibet recouvre pour les Tibétains les trois provinces du Ütsang (Tibet central) Kham (province orientale) et Amdo (province nord-est). De 1642 au soulèvement de Lhasa de 1959, le gouvernement des Dalaï-lamas, appelé Ganden phodrang, régnait sur un territoire qui correspond à peu près à celui de la Région autonome du Tibet. Les régions du Kham et de l’Amdo connaissaient traditionnellement des organisations politiques diverses : royaumes, chefferies sous l’autorité de religieux ou de rois laïcs. Cependant, tous regardaient vers Lhasa, où vivait le Dalaï-lama car, ainsi que l’exprime un dicton célèbre : « Ne pas aller en pèlerinage à Lhasa, c'est n’être qu’à moitié humain ».
Ce territoire immense, 2 500 000 km2, un quart de la RPC, avait une faible densité de population, environ 6 millions de Tibétains. Si les identités locales étaient fortes, le bouddhisme, une culture bien spécifique, une langue savante écrite commune, une même mythologie et une même histoire donnaient à la population de l’immense plateau tibétain le sentiment d’appartenir à un ensemble partageant un grand nombre de traits identitaires.
Il est vrai que la dynastie mandchoue des Qing a mis progressivement en place, au cours du XVIIIe siècle une forme de protectorat sur le gouvernement des dalaï-lamas, avec un contrôle plus ou moins effectif ou nominal selon les périodes. Mais le gouvernement tibétain était toujours en place et les dirigeants du pays sont restés, dans une très large mesure, tibétains.
En 1979, Deng Xiaoping invita à Pékin, Gyalo Thondup, le deuxième frère aîné de Sa Sainteté le Dalaï-lama, et lui indiqua à cette occasion qu’hormis l’indépendance du Tibet, toutes les autres questions concernant cette région pouvaient être discutées et les problèmes résolus. Deng proposa que le Dalaï-Lama envoie des délégations d’enquête au Tibet afin d’observer les conditions de vie des Tibétains. Le 14 mars 1980, se tint à Pékin le premier Forum de travail sur le Tibet organisé par le Secrétariat du Comité central du PCC, sous la présidence de son Secrétaire général d’alors, Hu Yaobang. Le mois suivant eut lieu la première tournée d’inspection au Tibet par une délégation tibétaine. Suivront quatre autres missions d’enquête entre 1979 et 1985 et deux délégations de pourparlers (juillet 1980 et octobre 1984) conduites par Lobsang Samten, un autre frère aîné du Dalaï-Lama à Pékin. Après cette date, un canal de communication entre Dharamsala et Pékin a été maintenu mais il semble que le dialogue entre les autorités chinoises et tibétaines soit au point mort depuis 2010. Quels sont les points bloquants qui empêchent ces discussions d’avancer du côté chinois comme tibétain ?
L’élément problématique des discussions est que les Chinois ne veulent parler que du statut du Dalaï-lama. En 1988, le hiérarque a annoncé, dans un discours au Parlement européen à Strasbourg, renoncer à l’indépendance du Tibet pour une autonomie réelle de toutes les zones tibétaines à l’intérieur de la République populaire de Chine, dans le cadre de la constitution chinoise. Cette revendication paraît tout à fait irréalisable dans le contexte de la politique actuelle menée par le président Xi Jinping. Il est vrai que certains membres de l’administration tibétaine ont dit qu’il existait de nos jours encore des canaux de discussions mais rien n’a été officiellement dit sur la teneur d’éventuelles discussions.
Pékin déploie depuis 2014 une politique assimilationniste théorisée par certains chercheurs. Pour ces derniers, l’avenir de la Chine repose sur une « nation chinoise » (zhonghua minzu) unique, dans laquelle les lois seraient identiques pour tous, Han et non-Han, où il n’y aurait plus de régime d’autonomie accordé aux régions non-han, ni de mention de « nationalités » (minzu) sur les cartes d’identité. Ils rêvent d’une Chine totalement chinoise dans laquelle Han et non-Han ne formeraient qu’une même nation chinoise.
Sa Sainteté le XIVème Dalaï-lama, Tenzin Gyatso, approche de l’âge vénérable de 90 ans (il est né le 6 juillet 1935 dans un village situé dans la province du Qinghai, l’ancien Amdo tibétain). Se pose la question de sa succession, bien qu’il ait prédit à au moins deux reprises qu’il vivrait jusqu’à l’âge de 113 ans, ce que l’on ne peut que lui souhaiter. Comment envisage-t-il sa succession après qu’il a renoncé à son autorité temporelle en 2011 au profit du gouvernement tibétain en exil installé à Dharamsala, dans l’État indien de l’Arunachal Pradesh, pour ne conserver que son autorité spirituelle ?
Le Dalaï-lama a effectivement dit plusieurs fois qu’il vivrait jusqu’à 110 ou 113 ans. Selon certains chercheurs, ce serait une manière de dire aux autorités chinoises : c’est avec moi qu’il faut discuter. Il a également affirmé à différentes reprises que lorsqu’il arriverait à 90 ans, il annoncerait si et où il se réincarnerait. Or, il vient d’écrire un livre dans lequel il dit clairement que sa réincarnation naîtra dans le monde libre, donc hors de Chine et hors du Tibet occupé.
Il est souvent difficile pour les Occidentaux de comprendre l’importance qu’a le hiérarque pour son peuple. Pour les Tibétains, le Dalaï-lama est l’émanation d' Avalokiteshvara, le bodhisattva protecteur du Tibet.
Il est fort probable que les autorités chinoises craignent des troubles au moment du décès du Dalaï-lama. On peut se demander si l’envoi de cadres han un peu partout dans les villes et les villages n’a pas pour but d’éviter des débordements à ce moment.
Je ne doute pas pour ma part que les autorités chinoises nommeront leur propre Dalaï-lama, comme elles l’ont fait pour le Panchen-lama (le deuxième plus grand chef spirituel du bouddhisme tibétain). Cela a été annoncé de multiples fois et les autorités chinoises cherchent, dès à présent, à convaincre les pays étrangers d’accepter leur choix.
*****
Katia BUFFETRILLE est ethnologue et tibétologue. Elle étudie depuis trente-cinq ans les rituels « populaires », particulièrement les pèlerinages autour des montagnes sacrées et les changements qu’ils connaissent au sein de la RPC. Ses intérêts portent également sur les phénomènes ‘bouddhiques' actuels (immolations, végétarisme) et les relations sino-tibétaines. Elle se rend régulièrement au Tibet pour plusieurs mois depuis 1985 et au Népal depuis 1974. Elle a publié de nombreux articles et livres dont L’âge d’or du Tibet : XVIIe et XVIIIe siècles. Belles Lettres, 2019.