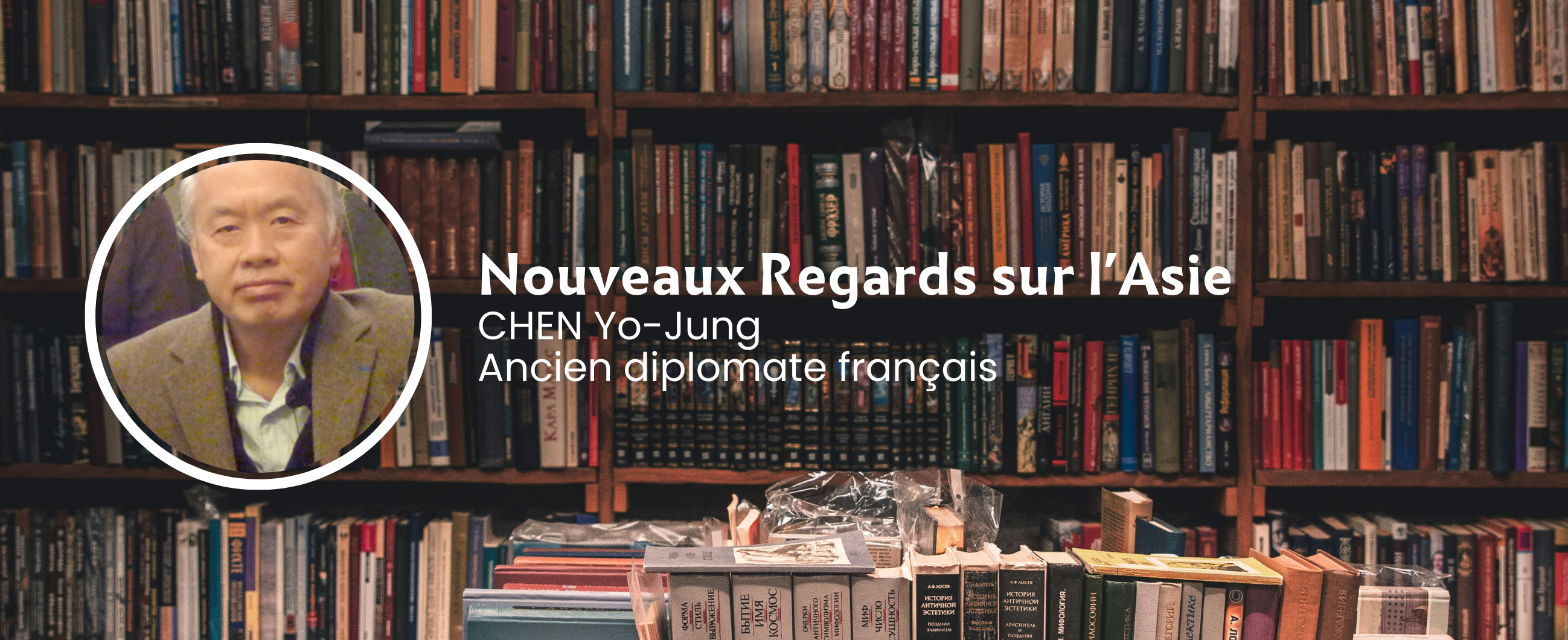
Par CHEN Yo-Jung
L’Asie orientale est une région pleine de nuances dans tous ses aspects mais avec en partage une culture empruntant tout ou en partie à l’écriture de l’ethnie han (Hanzu 漢族/汉族) : hanzi 漢字/汉字 chinois, kanji 漢字 japonais, hanja 한자/漢字 coréen, chữ nho 𡨸儒 vietnamien.
Dans cette constellation de pays orbitant autour de l’astre chinois depuis deux millénaires, le Japon, la Corée, le Vietnam partagent, chacun à leur manière et à différents degrés, des traits culturels empruntés à la civilisation chinoise véhiculée par son système d’écriture.
C’est le cas du confucianisme, du bouddhisme mahāyāna महायान ou du grand véhicule, dacheng 大承 en chinois, daijô 大乘(même graphie en japonais), ou encore de la riziculture, du système administratif, etc. Loin d’aboutir à une uniformité, chacun d’eux a, au contraire, affirmé sa propre identité nationale distincte de celle de l’empire voisin.
L’écriture : premiers impacts culturels
Corée
Les premiers impacts de la culture han sur la Corée apparaissent vers le IIIème siècle avant notre ère, sous la dynastie Han 漢朝/汉朝 (206-220), avec l’introduction dans la péninsule du système d’écriture désigné localement sous l’appellation hanja 한자.
Le pays était alors divisé en trois royaumes Goguryo (de 37 av. J.-C. à 668), Baekje (de 18 av. J.-C. à 660) et Silla (57 av. J.-C. à 935). L’introduction du hanja a donné à l’élite de ces royaumes l’accès à la culture et la philosophie hans. L’apprentissage de l’écriture et des ouvrages canoniques confucéens a conduit à l’introduction des systèmes politique et administratif chinois dans la vie publique du pays. Sous les dynasties coréennes successives, le Hanja s’est imposé comme l’écriture officielle et était omniprésent dans tous les aspects de la vie publique tout en demeurant un outil plus ou moins privilégié de l’élite.
Il a fallu attendre 1443 pour voir apparaître, à l’initiative du Roi Sejong, le hangul 한글, un alphabet phonétique conçu pour populariser l’écriture et la lecture en coréen. Hanja et hangul coexistèrent alors dans la vie publique en Corée même si, initialement, l’élite tendait encore à privilégier l’usage des sinogrammes (hanzi 漢字/汉字).
Aujourd’hui, le souci de simplifier l’écriture a conduit à l’extension de l’usage du hangul qui l’a emporté sur l’autre type d’écriture. En Corée du Sud, le hanja est toujours enseigné à l’école mais de manière limitée, tandis qu’en Corée du Nord, nationalisme oblige, les sinogrammes ont entièrement disparu en faveur du hangul qui porte à Pyongyang la dénomination de Josŏn'gŭl 조선글, par référence à la période Joseon (1392-1897), celle de la Corée historique (hangeul : 조선 ; hanja : 朝鮮).
Japon
C’est en passant par la péninsule coréenne que la culture han a touché les rives de l’archipel japonais vers le IVème siècle. Bravant les périls de la traversée de la mer du Japon, des lettrés et des moines bouddhistes coréens, armés de leurs riches connaissances des kanji (漢字 sinogrammes han) et de la culture han 漢文化/汉文化, sont venus en grand nombre apporter leurs savoir-faire dans l’édification de la nation archipélagique naissante.
L’arrivée des kanji a permis au Japon, qui n’avait pas alors de système d’écriture propre, de sortir progressivement de sa culture orale et de commencer, vers le VIème siècle à consigner par écrit son histoire. Jusque-là, on ne trouvait que d’anciens témoignages de voyageurs-aventuriers, dont ceux vivant à l’époque de la dynastie Wei 魏 (IIIème siècle), pour trouver les toutes premières mentions écrites d’un peuple désigné sous le nom de Wa 倭 (nain).
Les Wa adoptèrent les kanji pour transcrire des textes religieux, des documents administratifs et des chroniques historiques. Pour populariser la lecture et l’écriture, il leur a fallu adapter l’écriture han à la langue morique (ou moraïque) du pays. Ce processus a donné naissance, vers le Vème siècle, à des kana 仮名, une forme cursive simplifiée des kanji (ex. le morphème あ en japonais est issu du sinogramme « an » 安).
À l’issue de multiples évolutions à travers l’histoire, l’écriture mélangeant kanjis et kanas devint la norme dans l’archipel. Celle-ci a survécu à des vagues d’occidentalisation (circonscrite par l’écriture katakana カタカナ), comme au moment de la restauration de l’empereur Meiji en 1868 et de l’occupation américaine (1945-1952), pour demeurer toujours en usage dans la vie courante japonaise d’aujourd’hui.
Là où, jusqu’à nos jours, l’usage des kanji à côté des kanas demeure, le Japon se distingue de la Corée où les sinogrammes sont en voie de disparition en faveur de l’écriture nationale hangul. Cet usage se diffère aussi de celui qui a cours au Vietnam où les sinogrammes ont été entièrement remplacés par le chứ nôm, écriture reprenant des éléments des sinogrammes mais conçue phonétiquement pour s’adapter à la langue locale.
Au lieu de se contenter des sinogrammes venus de Chine, le Japon a su imposer son propre système d’écriture. Cet arrangement est appelé « waseikango » 和製漢語 (mots japonais composés de morphèmes chinois réemployés au Japon). Ces termes s'écrivent en kanji et se prononcent conformément à l'onyomi 音読み (lecture phonétique) coexistant avec le kunyomi 訓読み (lecture sémantique), qui reprend le sens (ou pas) du sinogramme/kanji, en empruntant une ou plusieurs prononciations de la langue orale japonaise. Certains mots appartiennent au vocabulaire sino-japonais, d'autres n'existent pas en chinois ou ont un sens différent dans les deux langues, d'autres encore sont réempruntés à la langue chinoise.
L’arrivée du waseikango en Chine a connu un essor particulier au XIXème siècle quand le Japon s’est modernisé à l’occidentale. Dans leur effort d’assimiler la culture, la pensée et la technologie occidentales, les Japonais ont recouru à des assemblages de sinogrammes pour créer des mots ou des termes nouveaux représentant des notions et des idées occidentales inconnues jusqu’alors en Asie : « démocratie » 民主, « révolution » 革命, « communisme » 共產主義, « philosophie » 哲學, « international » 國際, « atome » 原子, etc.
Ce nouveau vocabulaire, exprimé par des sinogrammes mais de fabrication japonaise, a été ensuite repris par les lettrés chinois en manque de termes équivalents dans leur langue. A l’époque, l’empire mandchou hanisé était en pleine décomposition, affaibli par un système féodal corrompu et soumis à l’occupation des puissances occidentales. Cette situation attira au Japon de nombreux étudiants chinois impressionnés par les progrès scientifiques et technologiques de l’empire du Soleil levant (riben 日本).
Cette introduction en Chine de sinogrammes élaborés au Japon, comme les mots « république» 共和国, « téléphone » 電話, « démocratie » 民主主義, etc., n’était cependant pas du goût des éléments les plus conservateurs de l’élite chinoise de l’époque, dont l’amour-propre souffrait de ce renversement du rapport maître-élève. D’autres, plus libéraux, l’encourageaient afin de promouvoir la modernisation du pays.
Vietnam
Le Vietnam a été mis en contact avec la langue et l’écriture chinoises vers l’an 111 av. J.-C. à la suite de la conquête par les envahisseurs hans puis mongols du nord du pays. Pendant son occupation de dix siècles, l’administration chinoise y introduisit la langue et l’écriture chinoises, appelées localement chữ nho 𡨸儒 (écriture érudite) ou chữ hán 𡨸漢 (écriture han), dans tous les aspects de la vie de ce pays. Tout comme les Japonais et les Coréens, les Vietnamiens ont dû adapter les sinogrammes à la langue locale qui est phonologiquement différente de la langue chinoise.
Le système d’écriture ainsi créé et développé localement, le chứ nôm 字喃 (écriture du sud), utilisant des caractères chinois adaptés et des caractères nouvellement créés pour transcrire la prononciation nationale ou quốc âm (國音), devient peu à peu l’écriture standard du pays à partir du Xème siècle lorsque le Vietnam, à la suite de sa victoire contre les sino-mongols à la bataille de Bạch Đăng (1288), devient indépendant sous la dynastie Ngô 吳. Le chứ nôm répond parfaitement à l’émergence d’un nouveau sentiment national, constituant un moyen par excellence d’affirmer une identité culturelle distincte de celle de la Chine.
Combinant, d’une part, l’emprunt de sinogrammes pour leur valeur phonétique ou sémantique et, d’autre part, la création de nouveaux caractères pour représenter des mots vietnamiens sans équivalent phonétique en chinois, le chứ nôm est mieux adapté à la langue locale et à son usage dans l’administration et la littérature, faisant que celui-ci s’est imposé sous les dynasties successives vietnamiennes du XIIIème au XVIIIème siècle.
Ce n’est que vers le XVIIème siècle que le chứ nôm commence à s’effacer progressivement devant l’émergence du quốc ngữ 國語 (langue nationale). Une nouvelle écriture romanisée basée sur l’alphabet latin est introduite par des missionnaires européens, dont le père jésuite Alexandre de Rhodes (1591-1660).
Le quốc ngữ romanisé s’avère si pratique et efficace comparé à l’écriture chinoise et au chứ nôm qu’il est officiellement adopté comme écriture nationale par les autorités coloniales françaises. On comprend aisément la préférence de ces dernières pour une écriture basée sur l’alphabet latin. Son adoption définitive en 1954 par le Vietnam devenu enfin indépendant (1975) témoigne d’un souci de simplifier l’apprentissage de l’écriture et de faciliter la modernisation du pays.
Le chứ nôm demeure néanmoins un symbole de l’identité nationale et de la résilience culturelle vietnamiennes face à la domination chinoise. Aujourd’hui, cet héritage culturel fait l’objet d’un effort national de préservation, et de nombreuses études à son sujet ont été publiées. Entre autres, la contribution importante du père de l’auteur de cet article, expert de renommée mondiale dans la recherche historique et culturelle de l’ancienne Indochine. L’auteur a connu le grand bonheur de travailler comme assistant de son père dans la réalisation de l’un des meilleurs ouvrages scientifiques de ce dernier sur le vhứ nôm : « A Collection of Chứ Nôm Scripts with the Pronounciation in Quốc Ngữ » (Chen Ching-Ho, Keio University, 1970).
Influence du confucianisme et du bouddhisme
L’introduction des sinogrammes entraîna inévitablement dans chacun des trois pays concernés des emprunts à la culture, à la pensée, à la religion, et au système politique et administratif de leur grand voisin.
Plus de deux siècles d’influence occidentale dans cette partie du monde et des décennies de communisme oriental hostile aux enseignements confucéens n’ont pas effacé, ni en Chine ni au Vietnam, les empreintes profondes laissées par le confucianisme dans la société de cette sphère placée sous l’influence des sinogrammes.
C’est par le biais des sinogrammes, mais aussi de l’écriture sanskrite, que le bouddhisme mahayana a été introduit au Vietnam. Tout en s’adaptant aux mœurs sociales locales, le bouddhisme s’est souvent trouvé en concurrence avec la doctrine confucéenne pour avoir la faveur des dirigeants politiques du pays. Mais les deux courants de pensée finiront par coexister au sein de la société des trois pays.
Vivant au carrefour de cette sphère des hanzi et de l’héritage de la pensée confucéenne, l’auteur a lui-même vécu au sein de sa famille des scènes tantôt harmonieuses tantôt conflictuelles entre un père chinois (de Taïwan), une mère vietnamienne et une épouse japonaise. Chacun s’en tenait obstinément à son interprétation des valeurs familiales et de piété filiale prêchées par le penseur du Vème siècle av. J.-C. Les choses se compliquaient davantage lorsque s’y mêlaient les valeurs chrétiennes occidentales du frère et des sœurs devenus français et américaines respectivement.
Corée
Premier des trois pays à adopter les sinogrammes sous l’appellation locale de hanja, la Corée a accueilli le confucianisme à l’époque de la dynastie Han en Chine. Devenu le dogme du pays, en particulier entre le XIIème et le XVIIème siècles, la pensée chinoise a structuré la société coréenne en matière de hiérarchie familiale, d'éducation et de bureaucratie. Les ouvrages canoniques confucéens étaient au cœur de l’éducation coréenne et ont donc influencé profondément la société de ce pays. Il y avait également une forte dose de confucianisme dans les structures administratives du pays calquées sur le modèle chinois.
Le bouddhisme, arrivé en Corée via la Chine au IVème siècle, a influencé l'art, l'architecture et la pensée de ce pays. Les écoles bouddhistes chinoises, comme le chan 禪 (ceon en coréen, zen en japonais), ont marqué d’une profonde empreinte la spiritualité coréenne.
Malgré des périodes de conflits, comme à l’époque de la dynastie Joseon (1392-1910) où le confucianisme avait été érigé en dogme d’État au détriment du bouddhisme, les deux courants de pensée et de croyance sont parvenus à coexister. Cette coexistence se poursuit encore de nos jours dans la vie courante des Coréens qui participent sans contradiction à des pratiques bouddhistes et confucéennes à la fois.
Japon
L’introduction des sinogrammes au Japon a été précédée par l’importation, via la Corée, de la riziculture et de l’art de travailler le bronze et le fer entre le IIIème et le VIème av. J.-C. Ce serait via des lettrés coréens que les sinogrammes (kanji en japonais) auraient été introduit dans l’archipel, ouvrant à l’élite japonaise tout un horizon intellectuel allant des textes bouddhistes, aux documents administratifs et aux chroniques historiques de sources chinoises.
Le système politique et administratif chinois, ainsi que le confucianisme et le bouddhisme, ont, après de multiples adaptations, demeuré dans la vie nationale du Japon jusqu’au XIXe siècle.
Introduit au Japon vers l’an 552 par les Coréens, le bouddhisme a dû, dans un premier temps, lutter contre la domination du shintoïsme (shintō 神道 ou voie divine), pratique chamanique locale, pour se tailler une place au sein de l’élite gouvernante du pays. Ce n’est qu’à partir de la période Nara, vers l’an 750, que l’Empereur Shomu a élevé le bouddhisme au rang de religion d’État, un statut qu’il a gardé jusqu’à la modernisation occidentale du pays à partir de 1868.
Cette année-là, avec la restauration de l’empereur Meiji marquant la fin du shogunat des Tokugawa et la restitution du pouvoir d’État à l’empereur, le Japon abandonne définitivement le système chinois, pourtant son modèle national durant vingt siècles, pour se convertir en un État monarchique moderne de style occidental. Alors que les samuraïs (侍) étaient encore plongés dans les classiques chinois comme les « analectes » (Lunyu 論語 ou Entretiens (avec Confucius) à la veille de cette restauration, l’empire nippon a, du jour au lendemain, tourné le dos à l’influence culturelle et politique chinoises pour s’occidentaliser à marche forcée. Le confucianisme est relégué à l’arrière-plan et le bouddhisme cède sa place au shintoïsme devenu désormais religion d’État.
Ce n’est qu’en 1952, au lendemain de la défaite militaire du Japon et de sa renaissance en tant que démocratie moderne, que le bouddhisme retrouve une place respectable à côté d’autres croyances religieuses. Le shintoïsme perd alors son statut de religion d’État même s’il a continué à être pratiqué en privé par la famille impériale et par plus de 90 millions de Japonais. Quant au confucianisme, qui est souvent en opposition avec la modernité occidentale exercée sur les mœurs et les valeurs en vigueur aujourd’hui, celui-ci a pratiquement disparu du devant de la scène dans la vie courante du Japon contemporain même s’il en reste encore des traces, à voir la façon dont les Japonais demeurent par exemple attachés au respect des aînés.
Vietnam
À la différence de la Corée et du Japon directement influencés par la culture chinoise, le Vietnam est un carrefour où se rencontrent la culture chinoise venue du nord et la culture indienne en provenance de l’ouest (royaume du Champa). De la Chine, notamment au travers de plus d’un millénaire de domination chinoise (de 111 av. J.-C. à 969), le Vietnam a non seulement absorbé les sinogrammes mais aussi, à travers ceux-ci, le bouddhisme, le confucianisme, et le taoïsme, comme aussi le système d’administration, l’architecture et les pratiques agricoles chinois. Par l’ouest, sont aussi arrivés le bouddhisme, l’hindouisme et les échanges commerciaux maritimes. La culture indienne, avec l’écriture sanskrite, s’est superposée à ce que le Vietnam avait hérité de la culture chinoise.
Les deux courants chinois et indien se syncrétisent pour aboutir à une culture unique et à une identité culturelle complexe qui a cependant su préserver les traditions locales.
En particulier, le confucianisme, introduit dès le IIème siècle av. J.-C. sous la domination de la dynastie Han, a profondément marqué la culture et la société vietnamiennes, devenant la base idéologique de l’État à partir du XIIIème siècle. Ironiquement, c’est en retrouvant son indépendance par rapport à la Chine que le Vietnam a véritablement intégré la pensée chinoise dans l’ensemble de l’organisation de l’État et de sa société.
Depuis, le confucianisme a pénétré tous les aspects de la vie nationale, du système administratif et politique aux valeurs sociales et familiales du Vietnam. Ces valeurs prêchées par le courant de pensée confucéen sont toujours à l’ordre du jour dans la société vietnamienne contemporaine malgré l’influence de la culture occidentale sous la colonisation française et en dépit du régime communiste actuel.
Le système administratif chinois pour sa part a subsisté dans ce pays jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À titre d’illustration, encore sous la colonisation française et l’occupation militaire japonaise dans les années 1930-1940, le grand-père maternel de l’auteur servait à la cour des derniers empereurs de la dynastie Nguyên (1802-1945) en sa qualité, très chinoise, de jianyi daifu 諫議大夫 (Conseiller impérial).
Le bouddhisme est arrivé au Vietnam par le nord (la Chine) et par l’ouest (l’Inde) via des moines chinois et indiens, et a coexisté avec le confucianisme et le taoïsme tout au long de l’histoire du Vietnam. Après l’indépendance du Vietnam de la Chine au Xème siècle, le bouddhisme a connu une période d’essor particulier en devenant religion d’État. Il façonne l’art, l’architecture et l’éducation et voit une vague de constructions de pagodes ordonnées par les empereurs successifs.
Au XVème siècle, la montée du confucianisme, qui devient l’idéologie dominante du pays, relègue le bouddhisme à un rôle secondaire. Malgré ce déclin, celui-ci, déjà profondément ancré dans la vie populaire, s’adapte en intégrant davantage de pratiques taoïstes et de croyances locales.
D’une religion importée, le bouddhisme a évolué pour devenir un pilier de l’identité culturelle du pays. Malgré des restrictions diverses sous la colonisation française et sa mise sous contrôle de l’État sous le régime communiste aujourd’hui, il demeure une religion incontournable dans la vie des Vietnamiens.
Relations avec la Chine
Malgré une profonde assimilation de la culture chinoise sur une période s’étalant sur plus de vingt siècles, les trois pays ayant emprunté les sinogrammes ont remarquablement réussi à se protéger d’une domination de la Chine, chacun ayant pu maintenir son identité nationale distincte de celle de son géant voisin.
Cela étant dit, la Corée, le Japon et le Vietnam, n’en demeurèrent pas moins des pays tributaires des dynasties chinoises successives pendant plus de deux millénaires.
L’empereur chinois étant considéré Fils du Ciel (Tianzi 天子) et censé régner sur tout ce qui existe « sous le Ciel » (tianxia 天下). Il apparaissait dès lors naturel que tous les pays se situant en dehors de l’empire chinois (y compris, en principe, l’Europe) soient considérés comme les sujets de Sa majesté céleste. Ses vassaux avaient l’obligation de présenter périodiquement leur soumission au Fils du Ciel et de lui faire des cadeaux en échange d’une reconnaissance diplomatique, de droits de commerce et de faveurs diverses et, avant tout, pour avoir la paix avec cet empire menaçant. Raison de plus pour que les pays périphériques ayant bénéficié de l’influence culturelle chinoise se soumettent à ce rituel.
Tout en se soumettant en apparence à l’autorité chinoise en tant que pays vassaux et tributaires, les royaumes japonais, coréen et vietnamien ont dans le même temps fait preuve d’un effort constant d’affirmation de leur propre identité nationale et d’une indépendance politique vis-à-vis de la Chine. Chacun à leur manière, ils ont entretenu des relations particulières avec la Chine sans succomber pour autant à une soumission politique et culturelle.
Il est intéressant de noter que, dans leur effort d’assimilation du système chinois des Hans, ces trois pays ont appliqué à l’intérieur de leurs propres frontières la notion de « Tianxia », chacun étant sous le règne d’un empereur ou fils du Ciel. Au Japon, par exemple, l’unification du pays en 1590 par Toyotomi Hideyoshi après des décennies de guerres internes entre clans féodaux rivaux prend le nom en japonais « d’universalisation » de Tenka 天下 (le monde).
Aujourd’hui…
Au premier quart du XXIème siècle, les trois anciens pays tributaires continuent à orbiter, mais d’une manière différente, autour d’un « empire central » redevenu puissance militaire et économique mondiale. À la place de l’adhésion culturelle inconditionnelle de naguère, il règne aujourd’hui une méfiance générale à l’encontre du géant communiste en pleine ascension. En même temps, les trois pays, comme beaucoup d’autres dans le reste du monde, ne peuvent pas se passer d’entretenir une relation économique étroite avec la désormais deuxième puissance économique mondiale.
Même si ces pays n’ont pas oublié l’héritage culturel chinois sur lequel sont bâtis leurs pays respectifs, on ne peut que déplorer que la Chine, dont la nature du régime suscite crainte et méfiance, n’ait pas su exploiter en sa faveur ce sentiment d’adhésion à une même culture.
S’agissant de la Corée du Sud, en dépit d’une rivalité idéologique et géopolitique, des échanges ont lieu entre les deux pays emportés par la « vague coréenne » hallyu (한류 en hangul, 韓流 en hanja) avec le K-Pop de la jeune génération et les « dramas » télévisuels coréens devenus très populaires en Chine.
En revanche, le ressentiment des 35 années de la colonisation japonaise était si fort que la culture japonaise (langue, chanson, cinéma, manga,…) est demeurée interdite en Corée du Sud entre 1945 et 1998.
Pour le Vietnam, la Chine a toujours été historiquement un objet d’admiration culturelle mais aussi de méfiance politique. À la fois un modèle et une menace. Après avoir vécu mille ans sous domination chinoise, le Vietnam indépendant a connu des périodes de souveraineté tantôt réelle tantôt nominale (comme sous la colonisation française) jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Comme dans le cas de la Corée, le siècle de domination de la France n’est pas parvenu à effacer la culture locale ni ce qu’il restait de l’influence culturelle chinoise au Vietnam. Certes, les sinogrammes localement adaptés, les chứ nôm, ont été remplacés par l’écriture romanisée en usage aujourd’hui. Mais le bouddhisme y occupe une place centrale tandis que le confucianisme laisse encore des traces avérées dans la société vietnamienne contemporaine.
Après la Restauration de Meiji de 1868, le Japon s’est employé quant à lui à effacer son héritage culturel chinois comme s’il s’était agi d’un fardeau honteux. Mais les empreintes venues de son proche voisin marquées par le bouddhisme et le confucianisme, entre autres, sont néanmoins restées ancrées dans la société japonaise jusqu’à nos jours.
*****
Né en 1947 à Taïwan, CHEN Yo-Jung a grandi au Vietnam et à Hong Kong. Il a fait ses études supérieures au Japon puis a servi pendant 23 années à l’ambassade de France à Tokyo en tant qu’attaché de presse et traducteur interprète. Naturalisé Français en 1981, Chen Yo-Jung est devenu en 1994 fonctionnaire titulaire du Quai d’Orsay. Il a servi en tant que consul adjoint/conseiller de presse dans plusieurs postes diplomatiques et consulaires français, dont à Tokyo, Los Angeles, San Francisco, Singapour et Pékin, avant de prendre sa retraite au Japon en 2012.