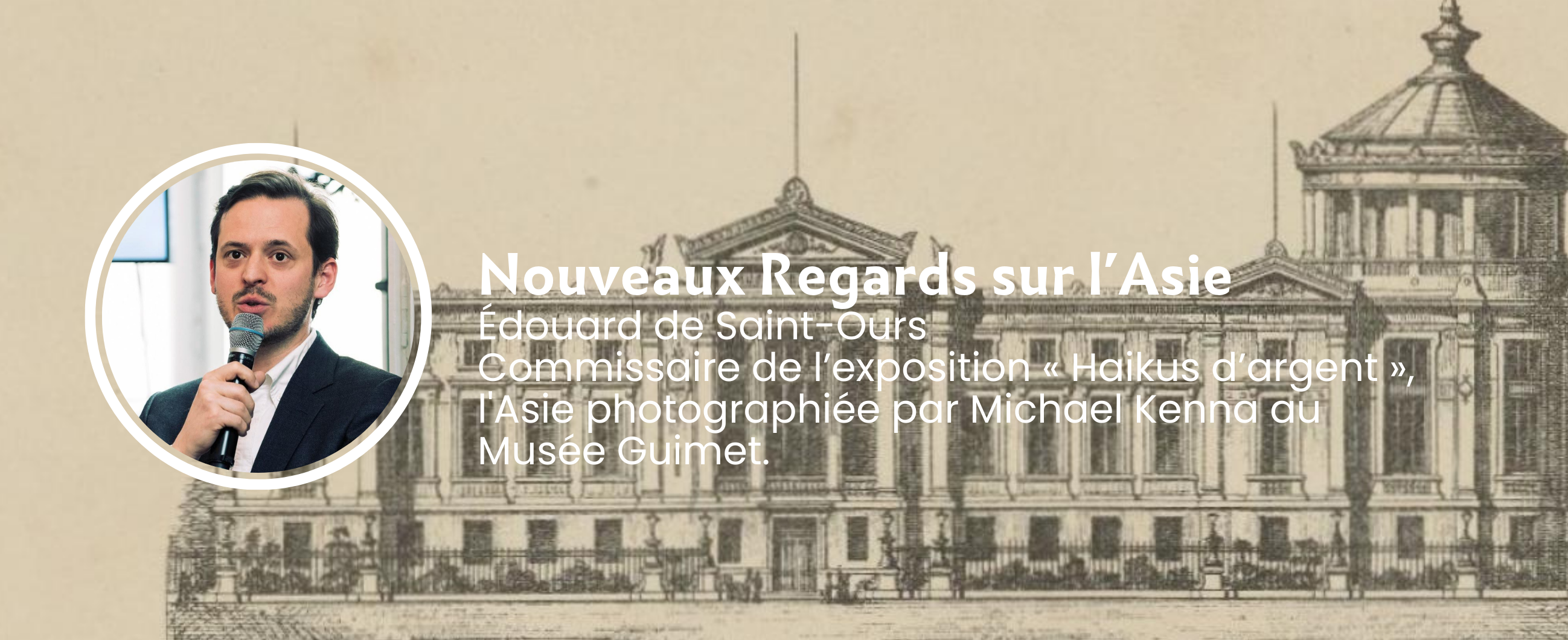
Jean-Raphaël Peytregnet : Avant de parler de l’exposition « Haikus d’argent : l’Asie photographiée par Michael Kenna » qui se tient actuellement au Musée national des arts asiatiques – Guimet jusqu’au 29 septembre, pourriez-vous nous en dire plus au sujet du fonds photographique dont vous avez la direction au titre de conservateur ?
Édouard de Saint-Ours : Les collections photographiques du musée Guimet sont très importantes. Elles rassemblent près de 600 000 photographies et ont été constituées à partir des années 1920. Au départ ces fonds avaient une vocation documentaire, celle d’être une ressource visuelle pour les historiens de l’art asiatique, les chercheurs, les professeurs, les étudiants, mais aussi pour venir en appui aux conservateurs pour la préparation d’articles scientifiques, d’ouvrages et d’expositions sur les arts asiatiques.
Cette photothèque représente aujourd’hui environ un tiers de la collection du musée. Elle est complétée par des donations et des acquisitions réalisées à partir des années 1940. Une bonne partie est constituée d’un fonds photographique ancien représentatif des tout débuts de la photographie en Asie, à partir des années 1850.
On y trouve des photographies rapportées par des missions scientifiques ou archéologiques, comme celles de Paul Pelliot (1878-1945), d’Édouard Chavannes (1865-1918) ou de Louis Delaporte (1842-1925), dont les collections qu’il avait constituées pour le Musée indochinois du Trocadéro, portant notamment sur l’art khmer, ont été rapatriées au musée Guimet après sa mort.
Nous avons aussi des fonds photographiques qui relèvent du photo-journalisme. Le musée Guimet a ainsi reçu en 2015 un don de Raoul Coutard (1924-2016) de ses photographies prises pendant la guerre d’Indochine et en 2019 l’intégralité du fonds de Marc Riboud (1923- 2016) par legs, qui représente environ 50 000 photographies.
Le musée Guimet dispose enfin d’un fonds photographique contemporain régulièrement enrichi depuis les années 2010. Par exemple, une acquisition récente de six tirages de Pierre-Élie de Pibrac a été faite suite à l’exposition « Portrait éphémère du Japon » (septembre 2023-janvier 2024) consacrée à son travail récent dans l’archipel nippon.
Le fonds contemporain contient aussi des photographies de Pascal Convert sur les grottes bouddhistes de Bamiyan, en Afghanistan, depuis la destruction des grands Bouddhas par les Talibans en 2001.
Nous avons enfin des œuvres réalisées par des photographes asiatiques, et notamment japonais, comme pour les daguerréotypes de Takashi ARAI, qui a travaillé dans les alentours de la préfecture de Fukushima après le tremblement de terre, le tsunami et la catastrophe nucléaire consécutive.
Notre politique d’acquisition pour la photographie est donc tournée à la fois vers les périodes anciennes, avec une attention particulière pour des zones géographiques peu représentées dans les collections, et vers la création contemporaine, cette fois-ci plutôt vers les artistes asiatiques.
Est-ce que les photographies peuvent faire l’objet de prêts entre les musées en France comme à l’étranger ?
Comme pour les autres domaines de collection, le musée Guimet prête volontiers des photographies pour des expositions hors de ses murs. Le musée emprunte aussi. Par exemple, pour l’exposition « Haïkus d’argent », la vaste majorité des tirages a été empruntée à la Médiathèque du patrimoine et de la photographie, qui a reçu en donation l’intégralité de l’œuvre de Michael Kenna, régulièrement enrichie au gré de ses voyages.
L’exposition consacrée à Michael Kenna s’intitule : « Haïkus d’argent ». Pourquoi ce titre ? En êtes-vous l’auteur ?
J’ai en effet proposé ce titre afin d’évoquer la poésie des images de l’artiste, qui interprète le paysage avec beaucoup de talent.
Michael Kenna n’a jamais souhaité faire de la documentation, comme il le dit lui-même. Il ne cherche pas à copier ou à enregistrer le réel. Il utilise au contraire la photographie comme un médium créatif et cherche à faire émerger du paysage des choses que l’on ne peut pas déceler à l’œil nu. Le sentiment poétique en fait partie. La photographie de Michael Kenna a par ailleurs plusieurs affinités avec le haïku [1], qui est un art de la suggestion. Les photographies de Kenna font preuve d’une concision remarquable tout en suggérant beaucoup de choses au-delà de ce qui est représenté, comme les haïkus sont contraints par leur forme (17 syllabes) à susciter l’imagination du spectateur.
L’« argent » du titre renvoie à la matière même des tirages, puisque Michael Kenna utilise exclusivement le procédé argentique, qu’il affectionne beaucoup. Son travail est véritablement façonné par cette technique. Il réalise non seulement ses prises de vues avec un appareil argentique, mais tire aussi lui-même chacune de ses épreuves. Kenna va même jusqu’à retoucher manuellement à l’encre bon nombre de ses tirages. C’est un travail presque artisanal, qui demande un savoir-faire important.
Mais toutes ces étapes, pour Kenna, sont surtout des moyens de façonner ses images afin d’y capturer, comme il le dit, l’invisible. Cet élément prend plusieurs formes dans son travail. L’émotion suscitée par la poésie d’une image en fait partie, mais aussi l’abstraction. Pour obtenir une photographie abstraite, il faut façonner le réel jusqu’à ce que les éléments du paysage deviennent des formes pures, jusqu’à ce que le spectateur ne puisse plus reconnaître ce qui est représenté.
Finalement, on pourrait presque dire que le spectateur participe également à la fabrique des images de Michael Kenna, tant l’intervention de l’imaginaire est importante pour lui. Il explique d’ailleurs qu’il recherche dans le paysage des lieux apparentés à des scènes de théâtre vides avant la représentation. Comme lorsqu’on attend le lever de rideau, ces lieux
invitent à imaginer ce qui va s’y dérouler.
Avec cette idée du vide et du plein, du noir et du blanc ?
En effet, il s’agit là d’un aspect qui n’est pas présent dans le titre de l’exposition mais qui l’est dans le parcours. C’est un des dénominateurs communs entre la photographie de Michael Kenna et certaines traditions artistiques de l’Asie orientale, en l’occurrence la peinture à l’encre (shuimohua en Chine, sumughwa en Corée, sumi-e au Japon). Dans bien des cas, la monochromie de cette technique est doublée d’une recherche sophistiquée d’équilibre entre le vide et le plein, comme chez Michael Kenna, dont les photographies sont toujours en noir et blanc.
L’art de la suggestion dont je parlais plus tôt se retrouve également dans les arts décoratifs japonais, en particulier le travail de la laque. La calligraphie est aussi un champ d’exploration pour Michael Kenna, qui s’empare souvent d’éléments sombres placés sur un fond clair pour dessiner dans le paysage une portée ou un texte indéchiffrable mais dont le rythme et la musicalité n’en demeurent pas moins perceptibles.
Les liens entre l’œuvre de Michael Kenna et les arts de l’Asie orientale n’avaient jamais été vraiment explorés jusqu’ici. Le musée Guimet était le lieu idéal pour le faire.
J’ai eu la chance, grâce à la complicité de mes collègues conservateurs, de pouvoir sélectionner des œuvres dans les collections pour introduire les sections thématiques de l’exposition. On y retrouve toutes sortes de matières : de la porcelaine, de la laque, des bronzes, de la peinture à l’encre, de la calligraphie et même des pierres de lettrés. Chaque œuvre est placée en regard d’un tirage grand format, dans une sorte de conversation formelle évoquant le thème de la section. Ce parcours thématique est divisé en neuf sous-sections réparties en trois parties. La première présente des photographies représentant une nature primordiale, vierge de toute présence humaine.
La seconde montre une nature habitée, avec les différentes manières que nous avons de peupler le paysage. Michael Kenna se concentre ici sur les traces des activités humaines mais sans jamais photographier personne.
La troisième partie de l’exposition est consacrée à ce qu’il appelle l’invisible et propose une progression vers l’abstraction. Cette dernière partie est peut-être la plus représentative du talent de Michael Kenna pour distiller le réel, comme un alchimiste qui chercherait à transformer le plomb en or.
On a l’impression que le Japon est très présent, qu’il y a une relation presque intime entre le Japon, l’art et la culture japonaise et la photographie, que cela soit chez Michael Kenna ou d’autres.
Il existe en tout cas un lien très fort entre Michael Kenna et le Japon. C’est le premier pays d’Asie qu’il a visité en 1987 et il y retourne désormais tous les ans, notamment en hiver sur l’île d’Hokkaido, qu’il aime pour ses paysages enneigés.
Mais il est vrai que l’art japonais a beaucoup influencé les artistes européens depuis le milieu du XIXe siècle. Et les photographes ne font pas exception. Je pense notamment aux Pictorialistes du tournant du XXème siècle, comme Alfred Stieglitz par exemple, dont Michael Kenna est en partie un héritier.
Et peut-être aussi dans l’autre sens ?
Tout à fait ! D’ailleurs, dans la salle des arts graphiques du département des collections japonaises du musée Guimet, on trouve actuellement une rotation d’estampes évoquant la manière dont les Japonais ont imaginé l’Occident dans le passé. Conçue par ma collègue Estelle Bauer, cet accrochage prend le contrepied de l’exposition « Haïkus d’argent », qui montre des photographies prises par un artiste européen en Asie.
Elle y a sélectionné des œuvres montrant comment les artistes japonais ont pu représenter les Occidentaux vivant à Yokohama ou bien fantasmer l’Europe et l’Amérique du Nord au XIXe siècle. Cette rotation illustre également bien comment les règles de la perspective occidentale codifiées par Brunelleschi à la Renaissance ont influencé les artistes japonais dès le XVIIIe siècle et ainsi transformé leur manière de représenter l’espace.
Michael Kenna s’inspire beaucoup des arts asiatiques, et notamment de l’art japonais, car de tous les pays d’Asie, c’est celui dont il se sent le plus proche.
Lorsqu’il s’y est rendu pour la première fois en 1987, à l’invitation d’une galerie de Tokyo qui a organisé une exposition de son travail, il dit être tombé amoureux de la culture et du paysage japonais. Il est depuis devenu sensible à son art, au bouddhisme zen, et au shintoïsme.
Ce dernier est d’ailleurs présent dans ses nombreuses photographies de torii, ces grands portails qui marquent l’entrée des sanctuaires shintô et symbolisent le passage du monde des vivants au monde des esprits et des dieux. C’est une idée qui plaît particulièrement à Michael Kenna, tout comme la présence d’innombrables divinités dans la nature.
Il est certain que Kenna a été profondément touché par l’art japonais et qu’il a renforcé ses propres recherches à son contact. Ce qui est intéressant, c’est que, pour lui, ce n’est pas une influence consciente. Il n’a pas étudié l’art japonais pour en appliquer ensuite les méthodes. C’est plutôt une affinité, une complicité entre ce qu’il cherchait à faire depuis les années 1970 et ce qu’il a découvert dans les arts japonais depuis qu’il visite ce pays.
Il est écrit quelque part dans le très riche dossier de presse [2] de l’exposition que les liens entre le travail de Michael Kenna et l’Asie n’ont jamais été analysés dans leurs spécificités.
En effet, les photographies de Michael Kenna sont souvent exposées seules, avec peu de contexte, d’une part parce qu’elles n’entendent pas documenter quoique ce soit mais aussi parce qu’elles sont d’une grande beauté et que cette qualité peut tout à fait se suffire à elle-même.
Les photographies qu’il a prises en Asie ont été beaucoup exposées mais le plus souvent sous le prisme géographique, pays par pays : la Corée du Sud, l’Inde, la Chine, etc.
Il n’existait jusqu’ici qu’une seule rétrospective générale sur l’Asie, organisée par la galerie indienne Tasveer en 2013, mais c’était une petite exposition. Il manquait donc une exposition d’ampleur sur cette question ainsi qu’une publication explorant ces liens en détail. C’est ce que nous avons souhaité faire au musée Guimet et dans le catalogue, qui donne notamment la parole à une spécialiste de l’histoire des rapports entre photographie et peinture à l’encre en Asie orientale, Haely Chang.
À ce sujet, le podcast mis en ligne par le musée Guimet est intéressant car l’artiste y commente certaines de ses photographies.
C’est quelque chose d’assez récent, mais on aime bien au musée Guimet tendre le micro aux artistes contemporains pour qu’ils puissent s’adresser directement aux visiteurs. Nous l’avons fait notamment pour l’exposition des photographies de Pierre-Élie de Pibrac en 2023- 2024.
Pour « Haïkus d’argent » c’était particulièrement important de donner la parole à Michael Kenna afin de rechercher un équilibre entre le discours que j’ai souhaité tenir dans l’exposition et sa propre vision des œuvres.
Dans chaque capsule du podcast, Michael Kenna raconte aux visiteurs les anecdotes derrière ses photographies, détaille ce qu’il recherchait, ce qui l’a touché dans tel paysage, ou encore le parcours de l’image depuis sa création. Le podcast est accessible via des codes QR dans l’exposition, afin de pouvoir l’écouter devant les œuvres, mais aussi sur internet [3].
Vous parlez aussi d’affinités entre les photographies de Michael Kenna et les arts de l’Asie orientale.
Nous avons déjà évoqué la poésie japonaise et la peinture à l’encre, mais il existe d’autres liens tangibles entre la photographie de Michael Kenna et les arts de l’Asie orientale. Tout d’abord sur le plan iconographique. On retrouve en effet dans ses photographies des motifs qui sont très fameux dans l’histoire des arts de la Chine, de Corée et du Japon, comme par exemple les montagnes.
La sous-section de l’exposition dédiée à ce motif est introduite par une peinture de Wang Xuehao (XVIIIème-XIXème siècle). Cette œuvre est placée en regard d’une photographie extraordinaire prise par Michael Kenna dans les monts Huang, dans le sud-est de la Chine.
Ce massif, célèbre pour sa beauté et l’omniprésence des nuages entre ses pics fantastiques, inspire les artistes peintres et les poètes chinois depuis des siècles. En allant se perdre sur ses sentiers et en photographiant ses vallées embrumées, Michael Kenna s’est en quelque sorte placé dans le sillage des artistes chinois du passé.
Les affinités entre l’œuvre de Kenna et les arts asiatiques concernent également certains procédés de composition. Dans les arts décoratifs japonais, et en particulier le travail de la laque, on ne représente pas de scènes anecdotiques. Les artistes ne montrent souvent que des bribes, des traces d’une activité, des détails permettant au spectateur d’imaginer l’action qui se déroule autour, avant ou après.
Par exemple, une sous-section de l’exposition débute avec une écritoire japonaise en laque maki-e exécutée par Honami Koetsu (1558-1637) et qui représente la proue d’une barque remplie de fagots et fendant les flots, rien de plus.
On n’y voit pas l’horizon, et aucun personnage. Mais à l’époque de sa création, une personne connaissant un peu la littérature japonaise aurait reconnu la saison (l’automne), le lieu (le lac d’Uji) et peut-être quelques histoires ou poèmes liés à cet endroit.
Cette œuvre entretient un dialogue très intéressant avec les photographies de Michael Kenna, qui mettent en œuvre le même procédé de suggestion, à une différence près : Michael Kenna ne fait pas appel à la culture générale du spectateur mais à son imaginaire.
On pense à ces peintures anciennes chinoises de paysages, de montagnes en général, où est représenté un chemin qui serpente, faisant s’interroger sur ce que l’on va découvrir au bout de celui-ci.
Vous avez tout à fait raison. Dans la peinture chinoise de « montagne et eau » le peintre compose son œuvre de manière à ce que le spectateur puisse la parcourir du regard, du premier plan à l’arrière-plan, et découvrir ainsi une multitude de paysages successifs.
Ce type de construction encourage, d’une certaine manière, la participation de la personne qui contemple l’œuvre. Michael Kenna recherche la même chose, il fait appel à la subjectivité de chacun.
Pour finir, comment vous est venue l’idée de cette exposition consacrée à l’œuvre de Michael Kenna, et avez-vous d’autres projets à venir d’expositions photographiques ?
Le projet de cette exposition remonte à plusieurs années, avant que je ne prenne la responsabilité des collections photographiques. L’idée s’est fait jour progressivement. Michael Kenna est venu au musée Guimet photographier des œuvres, puis il a donné en 2018 cinq tirages au musée, dont deux sont présentés dans l’exposition.
Parallèlement, il a décidé de léguer toute son œuvre à la France. Cet évènement exceptionnel a été annoncé à Paris Photo en 2022. L’exposition est donc à la fois le fruit d’échanges préexistants avec l’artiste et une célébration de cette généreuse donation.
Lorsque j’ai pris mes fonctions en 2023, j’ai eu la chance qu’on me confie d’emblée ce projet avec une grande liberté sur la manière de présenter les photographies de Michael Kenna.
Il fallait évidemment se focaliser sur son travail en Asie, mais le seul lien géographique me paraissait insuffisant. Il était aussi plus intéressant de développer un discours autour du style des photographies elles-mêmes, dans leurs liens avec les arts asiatiques, et donc avec les collections du musée Guimet.
Un autre aspect qui me semblait essentiel à aborder était les nombreuses étapes du travail de Michael Kenna pour passer du négatif à l’œuvre (planche contact, tirages test, tirage définitif, retouche manuelle). Cet aspect est rarement abordé pour les photographes contemporains. C’est pourtant central pour comprendre ce qu’ils ou elles font et pour réaliser l’ampleur de leur savoir-faire.
L’exposition consacre toute une partie à cette question, avec de nombreuses archives inédites et un très beau film réalisé par Richard Bonnet où Michael Kenna explique en détails son travail dans la chambre noire.
Quant aux projets futurs, nous préparons avec ma collègue Cécile Dazord, conservatrice chargée de l’art contemporain, une exposition qui ouvrira le 1er octobre jusqu’au 12 janvier 2026. Celle-ci présentera pour la première fois une installation extraordinaire de près de mille polaroïds de Nobuyoshi Araki, constituée pendant vingt-cinq ans et donnée au musée tout récemment par le collectionneur Stéphane André. Le travail d’Araki a fait l’objet d’une grande rétrospective au musée Guimet en 2016.
L’exposition de 2025 sera focalisée sur un aspect particulier mais central dans son œuvre : la photographie à développement instantané, mieux connue sous la marque Polaroïd. Depuis les années 1990, cette technique a permis à Araki de photographier son environnement de manière quasiment continue, et de constituer ainsi un journal visuel chaotique et poétique qui prend tout son sens dans la masse.
Nous avons aussi au musée Guimet des projets de recherche et de conservation, dont un consacré aux débuts de la photographie au Japon. Ce projet nommé HikarIA [4] entamé fin 2023 pour trois ans et financé en partie par l’État dans le cadre de France 2030, a pour but de valoriser une collection remarquable de plus de 20 000 photographies anciennes du Japon en développant de nouveaux outils d’intelligence artificielle pour la description automatique et la recherche iconographique dans ce fonds en partenariat avec la société TEKLIA.
[1] https://www.association-francophone-de-haiku.com/definition-du-haiku/
[2] https://www.guimet.fr/fr/espace-presse
[3] https://podcasts.nova.fr/radio-nova-michael-kenna-haikus-dargent-au-musee-guimet
[4] https://www.guimet.fr/fr/actualites-du-musee/le-projet-hikaria-laureat-de-france-2030
*****
Édouard de Saint-Ours est conservateur des collections photographiques au musée Guimet. Docteur en histoire de l'art (Université de St Andrews) et en histoire contemporaine (Université Le Havre Normandie), il est spécialiste de la photographie du XIXème siècle en Asie. Sa thèse, soutenue en 2024, examine le rôle de la photographie pendant les premières années du colonialisme français en Indochine (1845-1880). Il a également travaillé sur l'histoire des premiers procédés couleur et sur les réseaux franco-britanniques qui ont contribué au développement de la photographie dans les années 1840 et 1850.