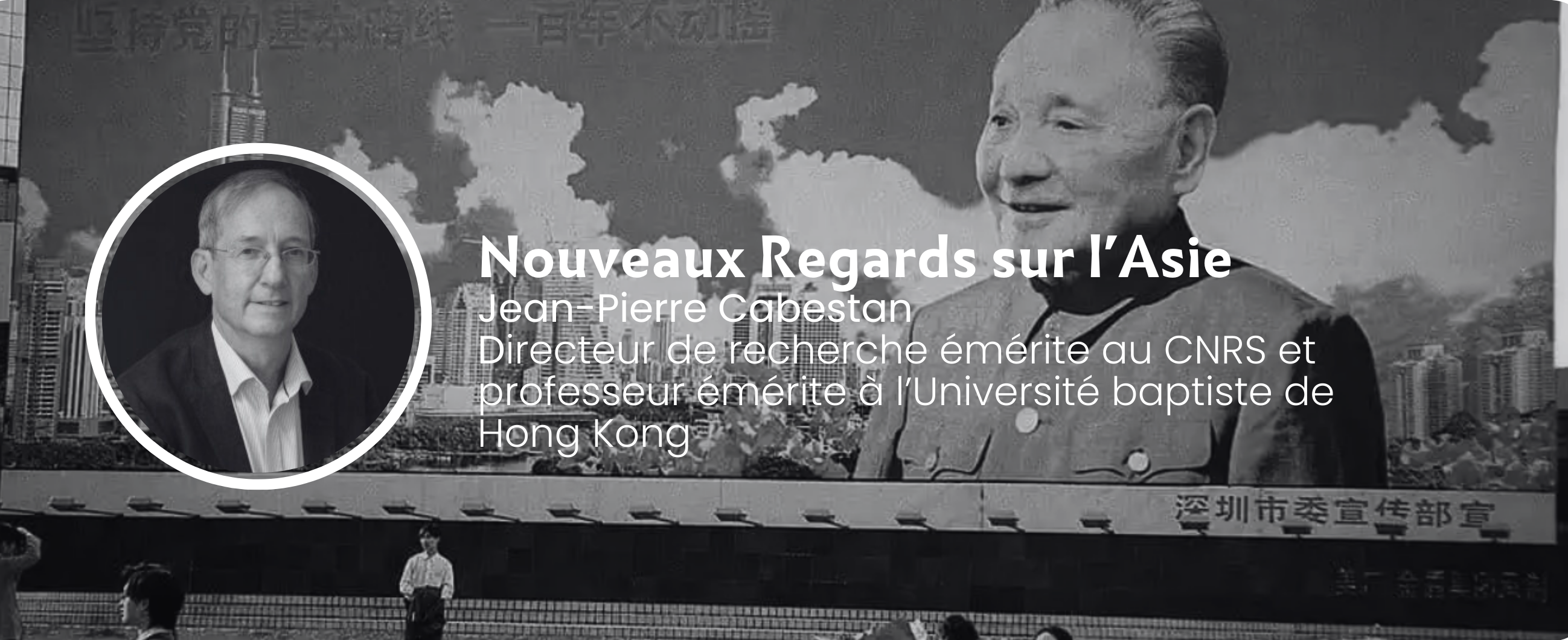
Propos recueillis par Jean-Raphaël Peytregnet
Jean-Raphaël Peytregnet : À en juger par le très faible nombre de biographies qui ont été publiées en France à son sujet avant la toute récente parution de votre ouvrage [1], Il semble que la figure de Deng Xiaoping n’ait pas beaucoup intéressé la sinologie et le public français, alors que les sinologues Geneviève Barma et Nicole Dulioust dans leur article « Les années françaises de Deng Xiaoping »[2] soulignent l’importance que notre pays a eu dans sa formation et par la suite sa brillante carrière d’homme de parti. Y voyez-vous une explication, notamment au regard de la personne de Mao Zedong qui, lui, a fait l’objet d’un bien plus grand intérêt, académique et des médias, dans notre pays comme partout ailleurs dans le monde ?
Jean-Pierre Cabestan : Deng Xiaoping a fait l’objet de nombreuses publications en anglais, dont celle d’Ezra Vogel mais aussi celles plus anciennes de David S. G. Goodman[3], ou plus récentes d’Alexander V. Pantsov et Steven I. Levine[4] ou encore de Michael Dillon[5]. Aucunes d’entre elles n’ont été traduites en français. En français, nous ne disposions seulement d’une traduction d’un ouvrage écrit en allemand par Uli Franz et publié en 1989[6], juste avant le massacre de Tian’anmen. Cette lacune est due à plusieurs raisons. La figure de Mao est autrement plus dominante que celle de Deng, subordonné de Mao et au Premier Ministre Zhou Enlai pendant des années avant de devenir fin 1978 le numéro un de fait de la Chine. Les années françaises de Deng ont compté dans sa conversion au communisme mais n’oublions pas qu’il était très jeune à l’époque : arrivé en France en 1920 à l’âge de 16 ans, il en part en janvier 1926 à l’âge de 21 ans.
Ensuite, l’enthousiasme pour l’homme qui a ouvert la Chine au monde et a entamé sa véritable modernisation s’est émoussé après Tian’anmen, son image s’est ternie. Puis il est mort en 1997 alors que le monde s’efforçait de comprendre si ses successeurs, comme Jiang Zemin et Hu Jintao, allaient poursuivre sa tâche. Enfin, l’arrivée de Xi Jinping au pouvoir en 2012 a directement contribué, dans la littérature officielle, à rejeter Deng dans l’ombre, à relativiser son rôle et même à apporter un certain degré de critique à son action, tant en matière d’ouverture jugée excessive sur l’extérieur que de tolérance de la corruption et de creusement des inégalités sociales. Aujourd’hui, Xi appréhende l’histoire de la République populaire comme un bloc et minimise le tournant opéré lors du fameux troisième plénum du Comité central du PC chinois de décembre 1978.
Sans parler de celle, officielle, publiée par les autorités chinoises en 2014 pour célébrer son 110ème anniversaire, les seules biographies dont on disposait jusqu’alors étaient plutôt les œuvres soit de sa fille préférée, Deng Rong plus connue sous son surnom de Maomao (une marque d’admiration pour l’homme ?), d’ordre plutôt affectif et admiratif (« Deng Xiaoping, mon père »), soit de sinologues étrangers principalement américains, dont la volumineuse (non traduite en français), du sinologue Ezra Vogel (1930-2020)[7], que vous qualifiez dans votre introduction de « complaisante » à l’égard du « petit timonier ». Qu’est-ce qui vous pousse à porter ce jugement ?
Ces deux biographies sont utiles car elles fourmillent d’informations sur Deng. Mais celle de Deng Rong est nécessairement hagiographique, surtout celle qui porte sur l’avant 1949. Le volume sur Deng pendant la Révolution culturelle apporte plus à mon sens sur la compréhension des épreuves que le personnage a dû traverser. La biographie de Vogel pour sa part pêche de deux manières. D’une part, elle est bien trop courte sur la carrière et la vie de Deng avant son premier retour au pouvoir en 1973. A cet égard, le Pantsov et Levine offre un panorama bien plus complet et critique de l’évolution de Deng entre son passage en France, puis en Union soviétique, son ascension dans le Parti à la fois au sein de la zone de guérilla établie par Mao au Jiangxi puis à Yan’an et le rôle clé qu’il a joué entre 1949 et 1966. De ce fait, Vogel édulcore combien Deng a été maoïste, que ce soit dans les monts Taihang au Shanxi pendant la guerre sino-japonaise, au Sichuan au début des années 1950, où à Pékin par la suite, prenant une part active à la répression du mouvement des Cent Fleurs en 1957, soutenant le catastrophique Grand Bond en avant (1958-1960) et secondant Mao dans sa dénonciation de Khrouchtchev et du soi-disant « révisionniste » soviétique.
D’autre part, et c’est étonnant pour un américain attaché à la démocratie et aux valeurs libérales, Vogel est bien trop compréhensif et même complaisant à l’égard des projets de Deng. On peut mettre au crédit de ce dernier une volonté indéniable de modernisation et d’ouverture économiques de la Chine, que ce soit en 1974-1975, après 1978 et enfin en janvier 1992, lorsqu’il se rend à Shenzhen pour justement relancer les réformes. Mais, ce qui frappe est combien Deng a toujours été opposé à toute réforme politique : d’où son limogeage de Hu Yaobang en 1987 puis de Zhao Ziyang, deux ans plus tard, juste avant le massacre de Tian’anmen ; jugés trop libéraux. Or Vogel à la fois minimise le choc de Tiananmen et refuse de reconnaître la logique et la constance politiques de Deng : un antidémocrate qui estime que seul le PC doit exercer, et donc monopoliser le pouvoir. En ce sens, il y a une forte continuité entre Mao, Deng et Xi.
Vous écrivez dans votre conclusion que, je vous cite, Deng a été tour à tour un communiste autoritaire, un maoïste, puis un détracteur de Mao…Vous l’avez même qualifié d’anti-maoïste. Est-ce tout à fait le cas dès lors qu’il semble s’être comporté, tout au moins jusqu’à la mort de Mao en 1976, comme un simple exécuteur servile des basses œuvres commandées par Mao, comme par exemple lors de campagne anti-droitiste de 1957 qu’il conduisit avec une extrême brutalité (tout autant que lors de la répression sanglante du mouvement de la jeunesse sur la place Tian’anmen en 1989) ?
Deng a évolué au cours de sa carrière. Je pense que le drame du Grand Bond l’a conduit à prendre, sur le plan intérieur tout au moins, ses distances de Mao et à travailler avec Liu Shaoqi et d’autres, comme Chen Yun, au rétablissement de l’économie entre 1961 et 1966. Cette évolution, comme on le sait, lui a attiré des ennuis : Mao l’a limogé en 1967, le traitant de « deuxième personnage qui a emprunté la voie capitaliste », après Liu Shaoqi. Plus tard, fin 1975, Deng entre en conflit de plus en plus ouvert avec les radicaux qui lui mettent des bâtons dans les roues ; en outre, il refuse de reconnaître le caractère positif de la Révolution culturelle ce qui provoque sa seconde disgrâce. Mais contrairement à Liu et en dépit des pressions de radicaux (Lin Biao et Jiang Qing en particulier), Mao n’a jamais accepté d’exclure Deng du Parti, que ce soit en 1968 ou en 1976, ce qui montre la profondeur des liens qui unissent les deux dirigeants, jusqu’à la mort du premier.
Toutefois là où Deng s’est véritablement révélé anti-maoïste, c’est après qu’il est devenu numéro Un de fait du Parti. Dès lors, il abolit les mouvements et campagnes de masse, il réhabilite des centaines de milliers de victimes du maoïsme qui végètent dans les camps de rééducation par le travail, pour certains depuis 1957 et même avant, il met fin à tout culte de la personnalité, il démantèle les Communes populaire établies au début du Grand Bond et introduit des réformes économiques sans précédent, autorisant progressivement l’entreprenariat privé, et il rétablit le principe de la direction collective, cherchant à mettre en place des garde-fous contre tout nouvel abus de pouvoir et tout déclenchement d’une nouvelle Révolution culturelle. Sur ce dernier plan, a-t-il vraiment réussi ?
Il consultait plus que Mao, notamment ses pairs comme Chen Yun ou Li Xiannian ; il déléguait aussi plus de responsabilités, notamment à Hu Yaobang et Zhao Ziyang et par la suite à Jiang Zemin. Mais pour toutes les décisions importantes, c’est lui qui tranchait en dernière instance : ce fut le cas lors du printemps démocratique de 1989 qu’il décida de réprimer par la force avec l’aide de l’Armée Populaire de Libération ; ce fut aussi le cas, lorsqu’il confirma Jiang Zemin dans ses fonctions et mis en place le système de trois positions pour un seul responsable (sanwei yiti) afin d’être sûr que son successeur puisse comme lui prendre les décisions les plus importantes et trancher lorsque la direction du Parti est divisée.
Deng était donc dès les années 1970 et même 1961 dans un certaine mesure anti-maoïste et même antitotalitaire ; pour autant, il n’a jamais été un démocrate. C’était un homme politique autoritaire qui était toujours prêt à faire usage de la force pour protéger la stabilité et la survie du régime de Parti unique qu’il avait contribué à établir en 1949.
Deng Xiaoping ne se présente-t-il pas plutôt comme l’anti-Mao, au sens de son antithèse, s’en tenant au contraire de ce dernier à la ligne politique d’avant la Grande Révolution Culturelle Prolétarienne (1966-1976), mettant l’accent sur la modernisation, la réhabilitation des « experts » et le rétablissement du fonctionnement rationnel-bureaucratique du régime ?
J’ai déjà en partie répondu à cette question (cf. ci-dessus). Je crois qu’au début des années 1960, Deng teste des réformes qu’il généralisera ou laissera généraliser à compter de 1977, notamment le système d’exploitation familiale des terres (chengbao daohu). Mais alors, le système économique chinois était encore très soviétique et très fermé ; toute idée de rétablissement de la propriété privée des moyens de production, en particulier dans l’industrie et les services était exclue. Elle l’est en fait restée jusqu’au début des années 1980 et ce n’est que très progressivement qu’elle a fructifié et été admise par la majorité du pouvoir chinois, contre l’avis de certains conservateurs comme Chen Yun. Toute ouverture sur l’étranger capitaliste, marqué par la mise en place de Zones Économiques Spéciales, était totalement exclue dans les années 1960 et même avant 1979. Donc, oui, Deng a rétabli nombre d’institutions et de modes d’organisations qui existaient avant la Révolution culturelle (Constitution, légalité socialiste, administrations d’État, assemblées populaires, etc.) ; mais après 1978, il est allé bien plus loin en particulier sur le plan économique, en matière d’ouverture et de règles juridiques, innovations qui ont permis à la Chine de se développer et plus tard d’accéder à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en 2001 et de se mondialiser avec les limites et les asymétries que l’on sait.
Deng Xiaoping a été à deux ou trois reprises (1968-1973, 1973-1975, 1976-1977) mis à l’écart du pouvoir pour ensuite effectuer un retour en grâce mais sans jamais vraiment avoir été l’objet de persécutions comme ce fut le cas du président Liu Shaoqi (1898-1969) ou du maréchal Peng Dehuai (1899-1974), ni n’être même exclu du PCC, grâce à l’intervention du président Mao auquel Deng pourtant s’opposait, tout au moins quant à sa ligne politique précipitant la Chine dans le chaos (la grande famine du Grand Bond en avant, puis les dix années d’anarchie de la Révolution culturelle). Comment expliquez-vous cette sorte de bienveillance de l’homme fort d’alors à l’égard du « petit homme » comme le décrivait Mao à des interlocuteurs étrangers ? Dans le sens inverse, en parcourant l’interview que Deng avait accordée en 1980 à la journaliste italienne Oriana Fallaci [8], il apparaît nettement qu’il fait preuve d’une grande indulgence à l’égard du Grand timonier. Il lui reconnaît des fautes mais en aucun cas des crimes, et pourtant… Cela ne pose-t-il pas indirectement la question de la démaoïsation qui n’a jamais eu lieu en Chine à l’inverse de la déstalinisation conduite par Nikita Khrouchtchev en 1956 ? Qu'en pensez-vous ?
Dès la fin des années 1950, Mao a deux successeurs possibles à l’esprit : pas Liu Shaoqi avec qui des désaccords apparaissent déjà mais Deng Xiaoping et Lin Biao. Du fait du rapprochement entre Deng et Liu au début des années 1960, Mao optera d’abord pour Lin, mais il s’apercevra rapidement qu’il ne fera pas l’affaire ; il le marginalise en 1970 ; celui-ci prend peur et, sur le conseil de son fils qui a tenté, à son insu et de manière assez improvisée, d’assassiner Mao, s'enfuit en avion vers l’Union soviétique en septembre 1971. Comme on le sait, il périra dans l’accident de cet avion (abattu ?) en Mongolie extérieure. Alors qu’en 1972 Zhou Enlai est déjà atteint d’un cancer incurable, il ne restait donc plus que Deng, d’où son retour au pouvoir. La proximité entre Mao et Deng a aussi joué en faveur de ce dernier. Mais n’oublions pas que Mao a finalement écarté Deng pour lui préférer Hua Guofeng, un ancien responsable provincial dont on a trop souvent sous-estimé l’importance. Mao savait-il que Hua ne serait qu’un président de transition ?
Nul ne le sait. Quoiqu’il en soit, je pense aussi que Mao a toujours fait preuve d’une certaine indulgence, et pour de bonnes raisons, à l’égard de Deng. Quant au bilan établi par Deng sur Mao, il poursuit un but essentiel : protéger la légitimité du régime et le rôle de Mao dans la révolution chinoise. Contrairement à l’URSS, la Chine populaire ne disposait que d’un seul héro, Mao et non de deux, Lénine et Staline. Il était par conséquent plus aisé à Khrouchtchev puis Brejnev d’en revenir à Lénine et de déstaliniser qu’à Deng de « démaoïser » la Chine. D’où le choix fait par Deng et la direction du PCC de l’époque d’accuser Mao de « graves erreurs » à la fin de sa vie, à compter de 1958 et surtout de 1966. Mais dans la réalité, il y a eu démaoïsation, un mouvement qui ressemble diablement au dégel de l’époque de Khrouchtchev : libération de milliers de prisonniers politiques, exclusion et condamnation des radicaux, la « Bande des quatre », les partisans de Lin Biao, et même à titre posthume de Kang Sheng, parfois surnommé le Béria chinois, ouverture aux idées libérales et réformes économiques.
En réalité, sur le plan économique, la démaoïsation introduite par Deng est allée beaucoup plus loin que la déstalinisation en Union soviétique. Mais le mot démaoïsation reste tabou pour le PCC, car il mettrait à mal la légitimité du régime politique établi en 1949.
Depuis l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, et notamment pendant son second et actuel troisième mandat, le nouveau dirigeant de la Chine n’a semble-t-il cessé de « détricoter » l’œuvre réformatrice et modernisatrice de Deng Xiaoping. Est-on en train d’assister aujourd’hui à un grand retour du maoïsme triomphant et à un socialisme pur et dur, farouche ennemi du « tigre de papier » comme Mao surnommait de son temps les États-Unis pour mieux relativiser leur dangerosité ?
Xi Jinping a remis en cause plusieurs réformes importantes introduites par Deng, en particulier pour ce qui concerne le fonctionnement du Parti et le système de succession. Il a remis à l’honneur un certain culte de la personnalité, même si celui reste bien modeste par rapport au caractère hystérique de l’idolâtrie de Mao à compter de 1966. Il a concentré de multiples pouvoirs entre ses mains, mettant à mal le principe de la direction collective, consultant et déléguant moins le pouvoir (même s’il faut être prudent à l’égard de la manière dont Deng comprenait et appliquait ce principe). Et surtout, il a battu en brèche le système de succession introduit par Deng à la fin de sa vie : chaque numéro Un devait passer la main au terme de deux mandats de cinq ans à la fois comme secrétaire général du Comité central, président de la Commission militaire du Parti et président de la République.
En 2018, Xi a révisé la Constitution afin de rester chef de l’État aussi longtemps qu’il le souhaite, ce qui, du fait du lien institutionnel et politique entre les trois postes qu’il occupe, lui permet de repousser la succession autant que sa santé lui permettra. En outre, contrairement à Deng, Xi cherche à renforcer à tous les niveaux le rôle du Parti, y compris au sein des entreprises privées et de toutes les ONG qui sont autorisées. Enfin, la fin de la Guerre froide a eu une conséquence structurelle qui n’est apparue que très progressivement : l’émergence d’une nouvelle bipolarité entre les États-Unis et la Chine qui est venue se substituer à la bipolarité américano-soviétique. On peut se demander si Deng aurait adopté une autre posture de politique étrangère que Xi. Comme on sait, après 1989 il a conseillé à ses successeurs de maintenir un profil bas sur le plan international (taoguang yanghui).
Mais alors, la Chine était plus faible sur les plans à la fois économique et militaire qu’aujourd’hui. Peut-être que trente ans plus tard, il aurait lui aussi été tenté d’affirmer la puissance de son pays et décidé d’entrer dans une compétition stratégique, technologique et idéologique avec la puissance que la République populaire veut aujourd’hui surpasser.
Enfin, selon vous, que reste-t-il aujourd’hui de l’héritage de Deng Xiaoping et de sa « théorie », telle qu’elle est inscrite dans la constitution chinoise aux côtés de la « pensée » de Mao Zedong et de Xi Jinping ? Lui survivra-t-elle ?
C’est paradoxal que le PCC qualifie les écrits de Deng de « théorie » car Deng était bien plus un pragmatique qu’un théoricien. Est-ce que par exemple la formule « un pays, deux systèmes », appliquée d’abord à Taiwan, puis ensuite à Hong Kong et Macao, constitue une théorie. J’en doute. Mais l’idéologie du PCC a progressivement accumulé des strates successives qui se sont sédimentées : après le marxisme-léninisme et la « pensée Mao Zedong », les textes officiels chinois ajoutent non seulement la « théorie » de Deng, mais aussi les « trois représentativités » de Jiang Zemin, « l’approche scientifique du développement » attribuée à Hu Jintao et évidemment la pensée de Xi sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère.
Tout ceci ne veut pas dire grand-chose. Néanmoins faire disparaître toute référence officielle à Deng et à ses successeurs provoquerait une rupture politique et donc un facteur d’instabilité qu’il vaut mieux éviter. C’est pourquoi Xi préfère jouer la continuité et protéger la légitimité de toutes les périodes historiques de la République populaire. Pourtant, aujourd’hui c’est clairement la pensée de Xi qui domine ; et Deng, sans être oublié, est mis en veilleuse dans le but de réduire l’importance du tournant de décembre 1978 et de légitimer le régime dans son ensemble et ceci depuis sa fondation en 1949. C’est le message de Xi, un Xi qui, contrairement à ses deux prédécesseurs, n’a jamais fait le pèlerinage au village de Paifang, au Sichuan, pour y visiter la maison natale de Deng. Tout un symbole.
[1] Jean-Pierre Cabestan, « Deng Xiaoping – Révolutionnaire et modernisateur de la Chine », éd. Tallandier, 2024 , 427 pages.
[2] https://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1988_num_20_1_27937
[3] Deng Xiaoping and the Chinese Revolution : A political Biography, Routledge, London/New York, 1994, 209 pages. [4] Mao : The real story, éd. Simon and Schuster, 2013, 755 pages.
[5] Deng Xiaoping – The man who made modern China, éd. Bloomsbury Publishing, 2014, 336 pages.
[6] Deng Xiaoping, éd. Compagnie 12 : Fixot. Paris, 1989, 353 pages.
[7] Ezra Vogel, « Deng Xiaoping and the transformation of China”, Harvard University Press, 2013, 928 pages.
[8] https://redsails.org/deng-and-fallaci/
*****
Jean-Pierre Cabestan
Jean-Pierre Cabestan est directeur de recherche émérite au CNRS et professeur émérite à l’Université baptiste de Hong Kong. Il est rattaché à l’Institut de recherche français sr l’Asie de l’Est (IFRAE) de l’INALCO. Il est aussi chercheur associé à Asia Centre, Paris ainsi qu’au Centre d’étude français sur la Chine contemporaine de Hong Kong. Il est en outre Non-Resident Visiting Senior Fellow au German Marshall Fund of the United States à Washington DC. Ses récentes publications incluent Demain la Chine : démocratie ou dictature ?, Paris, Gallimard, 2018 (Médaille du Prix Guizot, 2019), publié en anglais (édition mise à jour) sous le titre China Tomorrow: Democracy or Dictatorship?, Lanham, MD, Rowman & Littlefield, 2019, publiée en chinois (édition mise à jour) sous le titre 中國的未來會走向民主還是獨裁, Taipei, 八旗 Gusa, 2024 ; Demain la Chine : guerre ou paix ?, Paris Gallimard, 2021 (Prix Albert Thibaudet, 2022, Prix La Plume, 2023) dont l’édition anglaise a été publiée par Rowan & Littlefield en 2023 sous le titre Facing China : Prospect for War and Peace, et Deng Xiaoping, révolutionnaire et modernisateur de la Chine, Paris, Tallandier 2024.