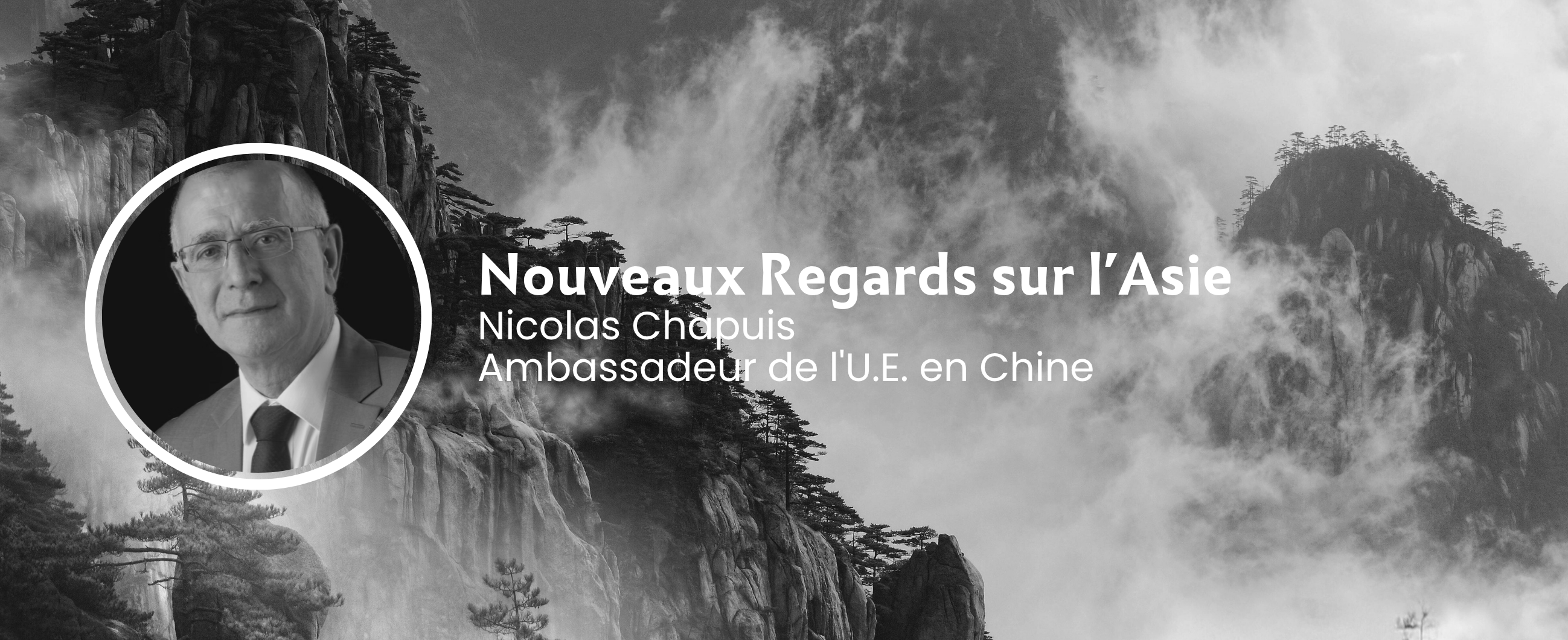
Jean-Raphaël Peytregnet : Vous vous êtes attelé à la traduction en français de l’œuvre poétique complète du grand poète de la dynastie Tang 唐 (618-907), Du Fu 杜甫. Un quatrième volume de son œuvre monumentale, qui dénombre 1144 poèmes en vers réguliers (shi 詩), paraît le 22 août aux éditions Les Belles Lettres.
Vous avez occupé au cours de votre carrière de très hautes fonctions en tant que diplomate, notamment en Chine où vous avez été ambassadeur de l’Union européenne, et donc amené à traiter de sujets en rapport avec les relations internationales dans le présent. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette époque ancienne et à ce poète en particulier, dont l’œuvre et la vie semblent a priori très éloignées des vicissitudes du monde moderne ?
Nicolas Chapuis : Je lis et relis la poésie chinoise classique depuis mes études de chinois. La diplomatie m’a conforté dans l’idée que la langue est non seulement l’instrument évident du dialogue, mais aussi, à son niveau le plus élevé, de l’intelligence d’une culture, l’outil par excellence de la connivence. Il se trouve que, dans la haute antiquité chinoise, la diplomatie était conduite en vers, avec un jeu subtil d’allusions et de joutes verbales, comme en témoignent les Annales des Printemps et Automnes (Chunqiu zuozhuan 春秋左傳). Ainsi ai-je trouvé dans l’étude continue de la poésie chinoise classique le moyen de mieux comprendre les ressorts de la pensée de cette grande civilisation, notamment dans la question longtemps débattue des fondements de l’humanisme chinois.
Cela m’a énormément servi dans mes missions successives en Chine, mes interlocuteurs appréciant cet investissement personnel et m’accordant de ce fait une confiance qui aurait sans doute été plus ardue à établir sans cette reconnaissance de proximité culturelle. Comme disent les Chinois, je « connais la musique » (zhi yin 知音), autrement dit j’étais pour eux un alter ego avec qui il était possible de dialoguer en profondeur. La traduction en chinois d’un de mes essais, « Tristes Automnes », a consolidé cette position enviable pour un diplomate.
J’en suis venu à Du Fu pour la simple raison qu’il figure dans la tradition chinoise comme le plus grand des poètes classiques et qu’il incarne ainsi, mieux que tout autre, l’essence même de la culture. Il est admis sans la moindre contestation que son génie poétique n’a jamais été dépassé, bien qu’il fut souvent imité.
Vous êtes le premier sinologue français, à ma connaissance, à vous lancer dans ce travail titanesque. D’autres avant vous, anglo-saxons pour la plupart, s’y étaient essayé. Je pense notamment à Stephen Owen qui mit quelque huit années à traduire l’intégralité en six volumes de l’œuvre du poète, achevée en 2015. Je pense aussi aux traductions de William Hung et d’Albert Davis réunies dans l’ouvrage « Tu Fu » publié en 1971, ou encore à celles de Burton Watson, auteur des poèmes choisis de Du Fu (« The Selected Poems of Du Fu ») parus en 2003. Avant que vous ne vous lanciez dans ce travail, il semble qu’il y ait eu au sein de la sinologie française peu d’intérêt pour ce grand poète mondialement connu, à en juger par le tout petit nombre de ses poèmes traduits dans notre langue. La BBC lui a même consacré un documentaire, comparant le génie du « plus grand poète » chinois à Dante Alighieri et à William Shakespeare. Comment l’expliquez-vous ?
Il est vrai que peu de poèmes de Du Fu étaient accessibles en français avant que la collection bilingue de la Bibliothèque Chinoise des Belles Lettres, dirigée par Anne Cheng, Stéphane Feuillas et Marc Kalinowski, décide il y a dix ans d’accueillir l’intégrale de son œuvre poétique, réparant ainsi ce regrettable manque.
D’éminents sinologues français ont traduit les poèmes les plus célèbres, ceux que les enfants chinois apprennent à réciter à l’école ; je pense en particulier à François Cheng et Florence Hu-Sterk. Il existe également des versions intéressantes de non-sinologues, comme celles d’André Markowicz, Claude Roy, ou encore Jean-Marie Le Clézio, attestant de l’universalité de la voix de Du Fu. Mais au total, ces traductions parcellaires ne rendent pas vraiment compte de la position singulière de Du Fu par rapport aux autres poètes classiques.
La seule explication est d’une banalité navrante : la poésie de Du Fu est très difficile, bien plus complexe à déchiffrer que ce qui l’a précédée et ce qui l’a suivie ; les commentateurs classiques avaient coutume de dire que Du Fu était « incompréhensible » (bu ke jie 不可解).
Même Stephen Owen, qui demeure aujourd’hui le plus grand lecteur américain de la poésie des Tang et dont j’eus la chance de suivre un séminaire doctoral à Harvard en 1987-1988, reconnaît les difficultés parfois insurmontables qu’il a rencontrées en établissant sa traduction. Parfois le contexte nous manque, ou alors le texte est corrompu, souffrant de variantes plus ou moins farfelues, parfois encore on soupçonne des jeux de mots qui nous échappent aujourd’hui à treize siècles de distance.
David Hawkes (1923-2009), auteur d’une très belle traduction du célèbre roman classique Honglou meng 紅樓夢 (Le rêve dans le pavillon rouge ou The story of the stone dans sa version en anglais), disait à propos de l’œuvre poétique de Du Fu que, je le cite, « ses poèmes ne sont généralement pas très bien traduits ». Êtes-vous également de cet avis ? Quelles sont les difficultés particulières à traduire ses poésies ? Et surtout à restituer autant que possible son style et son expression littéraires ?
David Hawkes savait parfaitement de quoi il parlait, car il était l’auteur d’une traduction commentée des trente-cinq poèmes de Du Fu recueillis dans les Trois Cents Poèmes Tang 唐詩三百首 (A Little Primer of Tu Fu, 1967). Il démontre que la densité et la concision propres à l’expression de Du Fu se perdent dans toute traduction. Faut-il pour autant renoncer ? Le défi est autant proportionnel au génie du poète qu’à la capacité du lecteur de saisir son intention.
Une fois encore, Du Fu est « incompréhensible », il faut l’accepter, tout en cherchant paradoxalement à « comprendre » pourquoi sa voix est si puissante et aujourd’hui encore audible.
Dans mon travail, je suis parti de deux considérations liminaires : la musicalité propre à la poésie chinoise classique est impossible à rendre dans une autre langue, la perte est là, immédiate et ne peut être compensée que par la recherche d’un rythme, un balancement qui est celui du chant (car la poésie chinoise était chantée). En second lieu, le trait prosodique le plus marqué chez Du Fu est le parallélisme absolu dans la composition d’un couplet : à une couleur répond une autre couleur, à une action correspond une autre action, et ainsi de suite. Ce parallélisme est restituable en traduction au prix d’une discipline linguistique aussi rigoureuse que l’original.
Une autre difficulté de la lecture autant que de la traduction est l’emploi ad libitum d’allusions littéraires. Stephen Owen a constitué ainsi un lexique des allusions utilisées par Du Fu afin d’aider le lecteur anglophone à se familiariser avec un corpus de références inconnues dans sa propre culture. Pour ma part, j’aborde ces allusions dans le commentaire détaillé qui suit la traduction de chaque poème : en effet, à la différence d’Owen, je ne livre pas seulement un poème, mais également une interprétation du texte, ce qui permet au lecteur francophone de saisir la manière dont Du Fu arrange sa composition.
Enfin, le texte en français doit, selon les cas, émouvoir ou impressionner le lecteur autant que le texte original. C’est là probablement ce qu’il y a de plus difficile à produire dans la traduction. Les premiers volumes parus depuis 2015, à raison d’une centaine de poèmes par livre, ont été salués par la critique pour la clarté et l’élégance de la diction : je n’en attends pas plus, en espérant que ce travail inspirera de jeunes sinologues à prendre la relève, car il reste tant de textes essentiels à traduire en français, à commencer par le livre de chevet de Du Fu, le Wenxuan 文選 (Anthologie des Belles Lettres), datant du VIème siècle.
Une autre grande figure de la poésie classique est Li Bai (701-762), qui vécut à la même période que Du Fu. La poésie de Li Bai se différencie de celle de son ami et contemporain. Du Fu a gagné le surnom de « Saint de la poésie » (Shi sheng 詩聖 ) ; Li Bai, celui de « poète immortel » (Shi Xian 詩仙). Du Fu lui-même dédia, si je ne me trompe, un poème à cet écrivain haut en couleur, adepte de la boisson, la « Chanson des Huit Immortels épris de boisson ». Tous deux ont en commun le fait d’avoir échoué aux concours impériaux et d’avoir été en quelque sorte à leur époque des « poètes maudits » (tous deux sont morts dans la misère) car plus ou moins marginaux et à l’époque ignorés. Qu’en pensez-vous ? Qu’est-ce qui les distingue ou les rapproche, selon vous ?
Li Bai était de dix ans l’aîné de Du Fu. Ce dernier était fasciné par la personnalité du premier, aventurier, redresseur de torts, qui eut son heure de gloire à la cour de l’empereur Xuanzong en dépit de son comportement erratique. Du Fu, lui, fut emporté par la guerre civile qui ravagea l’empire Tang en 755. La tradition a conservé quelques échanges de poèmes entre les deux poètes, où l’on discerne que Du Fu attendait plus de Li Bai que ce dernier était disposé à lui accorder.
Les deux ont en commun d’incarner l’âge d’or des Tang, celui des années 730-750, lorsque l’Empire était l’État le plus peuplé et le plus prospère de la planète, avec une capitale cosmopolite, Chang’an (aujourd’hui Xi’an), qui dénombrait un million d’habitants et accueillait les marchands de la fameuse Route de la soie.
Quand la guerre éclata, Du Fu prit la route de l’exil vers l’ouest puis le sud-ouest, tandis que Li Bai, pour des raisons mal élucidées mais peut-être liées à un ego démesuré, choisit de rallier le prince impérial Yong au sud-est dans une tentative avortée de coup d’État. Li Bai fut condamné à mort, puis finalement gracié et banni au Guizhou. Il mourut en 762, huit ans avant Du Fu.
Il est remarquable que Du Fu, malgré sa loyauté indéfectible au trône, pardonna à son ami son égarement politique. Dans un splendide texte datant de 759, intitulé « J’ai rêvé de Li Bai », Du Fu livre un dialogue avec son apparition fantomatique, lui confiant en conclusion : que vaut une réputation éternelle ? Après la mort il n’y a que le silence.
Le premier, Du Fu, semble adhérer à la pensée confucianiste et humaniste, alors que le second, Li Bai, paraît avoir été davantage influencé par le taoïsme et une certaine forme d’anarchisme. Est-ce le cas ? Pourriez-vous donner à nos lecteurs et lectrices un ou deux exemples des formes poétiques qui distinguent ces deux grands poètes ?
Effectivement, les deux lettrés n’avaient pas les mêmes attachements idéologiques. Pétri d’éducation rigoriste confucéenne, Du Fu semble d’ailleurs avoir envié dans sa jeunesse les aspirations libertaires de son aîné. Mais la guerre emporta ces velléités, et Du Fu, un peu à la manière d’un Victor Hugo exilé à Guernesey, dédia sa vie d’exilé à la composition de poèmes politiques qui dénoncent l’incurie impériale et appellent à la restauration de la moralité publique.
Je donnerai ici un exemple particulièrement évocateur de la différence de tonalité et d’inspiration entre les deux poètes en prenant le thème du clair de lune. Chez Li Bai, la lune est une compagne qui vient au secours de sa solitude, car elle projette une ombre avec laquelle il peut danser ; pour Du Fu, la lune n’apporte pas de réconfort car sa lumière révèle ce que la nuit s’efforce de cacher : la vieillesse du poète, la violence des armes.
Li Bai : « Lune et ombre sont des amies provisoires, pour s’amuser il faut jouir du printemps. Je chante pendant que la lune se promène ; je danse et mon ombre devient diffuse. » (Libation solitaire sous la lune)
Du Fu : (le clair de lune) n’apporte que souffrance à un cœur loyal, en ajoutant de la lumière sur des cheveux blancs. On voit bien que piques et lances sont partout : cesse d’éclairer le camp à l’ouest de la Capitale ! » (Lune)
Les critiques littéraires parlent de Du Fu comme d’un poète épique, lyrique et engagé. L’Histoire et la morale semblent deux composantes importantes qui ont marqué son œuvre. En quoi l’œuvre de ce grand poète parle encore aujourd’hui à ceux et celles qui le lisent, que cela soit dans le monde chinois ou en dehors ?
Comme Hugo, Shakespeare, Dante ou Goethe, Du Fu incarne ce qu’il y a d’universel dans l’humanité exposée à la souffrance de l’existence : un sens élevé de l’idéal qui transcende les vicissitudes. Dans le monde chinois, Du Fu est le lettré par excellence : confronté à la pire des tragédies de son temps, une guerre civile qui fit des millions de morts pendant six ans, qui détruisit l’ordre dynastique auquel il s’était voué et qui provoqua la mort d’un de ses enfants, il entreprend de témoigner ; il consigne autant les travers des princes que les souffrances des paysans arrachés à leur terre et des soldats massacrés dans des combats d’une rare cruauté.
Nul avant lui n’avait su faire preuve d’autant de réalisme et d’empathie, bien loin de l’image des poètes de cour cherchant à distraire le Fils du Ciel en quêtant prébendes ou honneurs. Il dit sans détours sa honte d’être impuissant, mais il demeure attaché en toutes circonstances à dire le droit, à dénoncer les injustices et à sauvegarder son honneur.
C’est la raison pour laquelle les plus grands intellectuels chinois se sont identifiés à Du Fu au cours des siècles. À la fin de leur vie, Qian Zhongshu 錢鍾書 (1910-1998) et Yang Jiang 楊絳 (1911-2016), le couple d’intellectuels le plus révéré en Chine contemporaine, passaient leurs soirées à calligraphier des poèmes de Du Fu, un hommage rendu à son refus de la compromission et à son intégrité morale.
J’espère que ma traduction en français de l’œuvre poétique intégrale de Du Fu, tout comme celle de Stephen Owen en anglais, permettra de mieux saisir la figure du lettré chinois.
L’Occident n’a évidemment pas le monopole du rôle public des intellectuels ; comprendre qu’en Chine aujourd’hui il y a des lettrés dévoués à un idéal moral comme l’était Du Fu relativise bien des discours sur l’absolutisme chinois.
Non que le régime ne soit pas totalitaire, il l’est sans la moindre ambiguïté possible ; mais la société civile, aussi fragile serait-elle face à la répression, est riche de personnalités qui font de l’honneur une vertu cardinale et de la honte un moteur de résistance. Tel est, à mes yeux, le legs remarquable de Du Fu.
*****
Nicolas CHAPUIS, né en 1957, a suivi des études de langue et civilisation chinoises aux Langues’O (INALCO) et à l’Université Paris VII. Diplomate de carrière, il a séjourné plus de quinze ans en Chine, où il a été notamment conseiller culturel auprès de l’ambassade de France (1989-1992), consul général à Shanghai (1998-2002) et ambassadeur de l’Union Européenne (2018-2022). Outre ses traductions de littérature contemporaine (Ba Jin, Yang Jiang), son intérêt pour la poésie classique chinoise a donné lieu à une traduction des Cinq Essais de Poétique de Qian Zhongshu (1987) et à un essai intitulé Tristes Automnes – poétique de l’identité dans la Chine ancienne (2001). La Bibliothèque Chinoise des éditions Les Belles Lettres accueille, en version bilingue, sa traduction de l’œuvre poétique intégrale de Du Fu. Quatre volumes, sur un ensemble prévu de quinze livres, sont disponibles : I - Poèmes de jeunesse, II - La Guerre Civile (755-759), III - Au bout du Monde (759), IV - Chengdu (760).