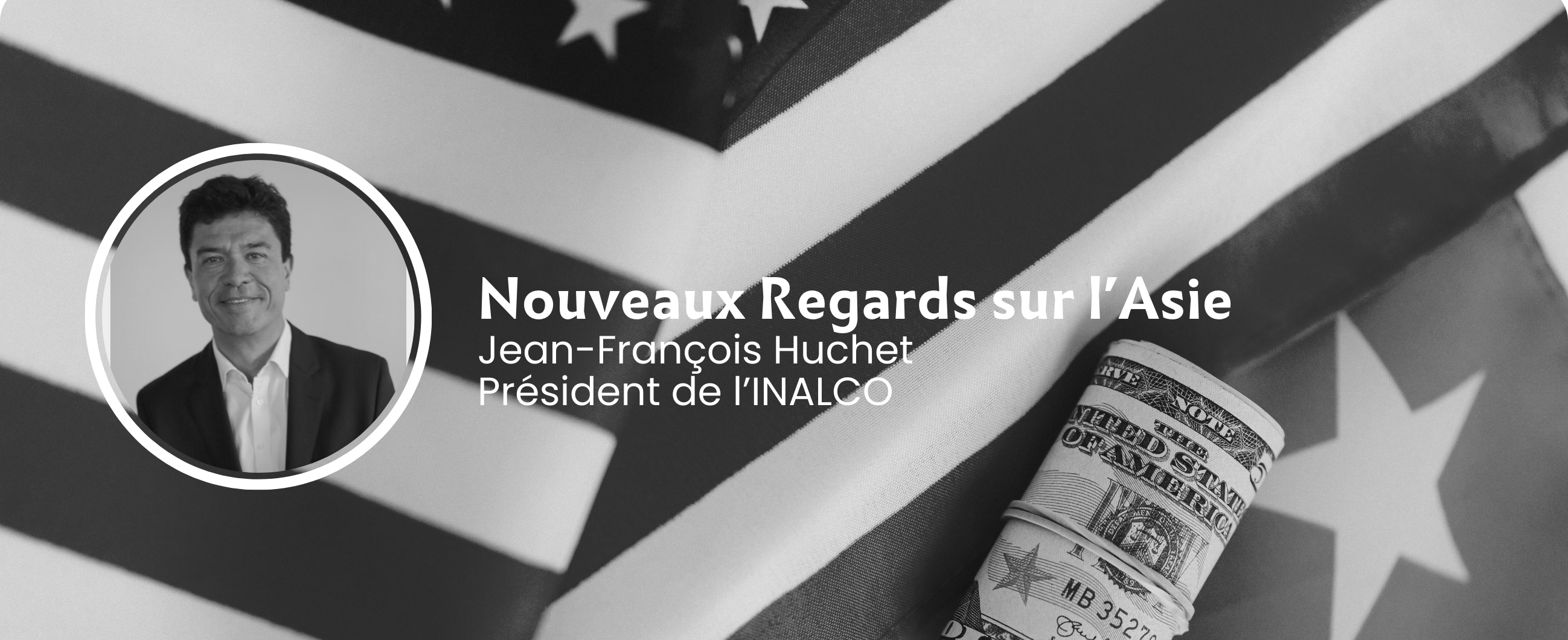
Jean-Raphaël Peytregnet : Au travers des hausses tarifaires américaines qui ont été annoncées, Trump s’est fixé comme objectif, comme il l’a dit lui-même, de ré-industrialiser les États-Unis et d’y attirer les investissements, tout en réduisant l’énorme déficit commercial que Washington enregistre avec le reste du monde, dont avec la Chine en particulier, même si cette dernière commence à réorienter ses exportations en direction des pays du « Sud global » (en voie de développement).
Selon les commentateurs, Trump chercherait dans le même temps à couper la Chine de ses chaînes d’approvisionnement l’obligeant de la sorte à s’en remettre davantage à son marché intérieur alors qu’elle continue de connaître une consommation atone malgré les premières mesures de relance qui ont été annoncées par le Premier ministre Li Qiang en mars à la suite de la réunion annuelle des « Deux assemblées » (Liang hui).
D’aucuns pensent qu’un autre objectif poursuivi par l’administration américaine serait aussi d’amener les pays menacés par ces hausses à réévaluer leurs monnaies d’échange permettant ainsi aux États-Unis d’améliorer leur productivité et de devenir plus compétitifs à l’exportation.
Si tels sont les objectifs de Trump, pensez-vous que cette hausse tarifaire généralisée soit la meilleure méthode pour y parvenir ?
Jean-François Huchet : Rétrospectivement, on observe deux choses : d’une part, il y a dans le système économique international un découplage des stratégies des entreprises et des pays qui, sans être forcément exactement les mêmes, peuvent parfois se recouper ; d’autre part, il se trouve des pays qui aident au travers de subventions leurs multinationales qui, par ailleurs, se livrent à des actions de lobby auprès des gouvernements.
Mais force est de constater que la poursuite d’un certain nombre de ces stratégies est ancienne, elles ne datent pas d’hier. Ainsi, ce phénomène de globalisation existe depuis la fin des années 1960. Des chaînes de valeurs extrêmement complexes ont été mises en place, notamment en Asie, qui ont amené ces multinationales notamment américaines à être présentes dans cette région du monde comme aussi en Europe. Par ailleurs, la question de la capacité de notre système international à absorber le système économique chinois tel qu’il s’est structuré depuis maintenant vingt-cinq ans a très certainement atteint aujourd’hui ses limites.
Le problème posé par la Chine sur le plan commercial était présent avant l’arrivée de Trump comme il l’était dans les discussions que nous avions pu avoir par le passé entre l’Union européenne et la Chine. Après avoir dit cela, si effectivement l’objectif ultime de Trump et de son administration est de revenir sur à peu près cinquante ans de globalisation et d’externalisation des chaînes de valeur ajoutée, je ne pense pas que cela se fera du jour au lendemain.
Les droits de douane peuvent être effectivement un instrument susceptible d’influencer les décisions des acteurs, mais c’est seulement à très long terme que celles-ci pourront avoir des répercussions sur la Chine et les États-Unis.
Exprimé d’une autre manière, si on prend un certain nombre de produits, par exemple le plus emblématique d’entre eux, à savoir les smartphones, car ils se trouvaient particulièrement pénalisés - et on a vu en l’espace d’un week-end l’administration américaine justement revenir sur les droits de douane imposés sur ce produit - on sait très bien que, pour relocaliser aux États-Unis une part importante de sa production, cela prendra énormément de temps. Il faudrait pour cela que Washington investisse quelque 30 milliards de dollars pour gagner 10 % de relocalisation.
Or le fait est qu’environ 80 % des smartphones exportés aux États-Unis sont fabriqués en Chine. Par ailleurs, compte tenu des conditions qui prévalent aujourd’hui aux États-Unis, ces derniers seraient dans l’incapacité de vendre un smartphone au consommateur américain à un prix inférieur à 1000-1200 USD, voire pour certains de ces produits à 3000 USD.
On voit bien que, derrière cette externalisation très complexe de la valeur ajoutée en Chine et en Asie de façon plus générale, nous avons affaire à un processus très complexe qui va prendre énormément de temps.
Il y a en effet un ensemble d’acteurs économiques qui sont présents en Chine et qui contribuent à la fabrication d’un produit fini comme, par exemple, un smartphone. Une multitude de sous-traitants se trouvent aujourd’hui en Chine et pas aux États-Unis. On a bien senti de la part des firmes une volonté depuis la pandémie du Covid notamment d’essayer de diversifier les risques. On le voit bien du côté d’Apple, pour ne prendre que cet exemple, avec cette volonté de s’implanter en Inde, de diversifier les chaînes de valeur ajoutée. Mais tout cela prend beaucoup de temps et coûte très cher.
On peut dès lors se poser la question s’il sera possible de maintenir des droits de douane prohibitifs, sans même savoir si les entreprises concernées auront la capacité de relocaliser une grande partie des chaînes de valeur ajoutée aux États-Unis, sans compter que cela prendrait probablement plusieurs dizaines d’années pour ce faire.
Cette stratégie n’est pas viable à court ou moyen terme. Les États-Unis et la Chine ne peuvent pas se permettre de rester à ce très haut niveau de taux de droits de douane. Ils sont tous les deux placés à la même enseigne et vont devoir se parler à un moment donné. L’imbrication est trop forte.
On observe quand même qu’il y a aussi s’agissant des pays frappés par ces menaces qui sont quand même invraisemblables, l’idée d’amener leurs grandes entreprises implantées en Chine ou dans d’autres pays d’Asie à investir aux États-Unis. On le voit avec le cas de Taïwan, par exemple, avec l’idée de pousser l’île à délocaliser ses chaînes de production aux États-Unis.
TSMC, qui est la plus importante fonderie de semi-conducteurs indépendante, a d’ailleurs déjà commencé avec l’implantation d’une usine dans l’Arizona. Dans cet objectif, Trump et son administration ne sont pas confrontés à ce problème des délais de mise en œuvre que vous avez évoqué précédemment.
Il faut bien voir que les décisions qui ont été prises par TSMC portent véritablement sur des très hautes technologies et qu’il s’agit quelque part pour Washington de faire en sorte que certaines productions de très haute valeur ajoutée se trouvant à Taïwan, car certaines d’entre elles y resteront, s’implantent également aux États-Unis. C’est quelque chose qu'il est peut-être possible de faire un peu plus rapidement. Mais il y a aussi, et là on dépasse très largement le cadre économique, la question de la proximité géopolitique ou politique de Taïwan avec les États-Unis. Mais oui, il est effectivement tout à fait possible de procéder ainsi. En ce qui concerne la Chine, les choses sont un peu différentes.
D’abord, pour la grande majorité, ce sont des entreprises américaines qui s’approvisionnent sur le marché chinois pour des productions qui sont encore à faible ou moyenne valeur ajoutée. Et donc, la possibilité de maintenir à coûts constants cet approvisionnement et de le déplacer aux États-Unis - je reprends l’exemple du smartphone - est extrêmement difficile parce que les conditions de la production en Chine ne sont pas du tout les mêmes qu’en Amérique du Nord.
Il faudrait pour cela reconstruire tout le réseau des fournisseurs et avoir une même structure qui permettrait au consommateur américain de pouvoir bénéficier des mêmes coûts qu’en Chine. Si on reprend l’exemple des semi-conducteurs, le fait est qu’une partie de ceux-ci à très haute valeur ajoutée à la frontière technologique, resteront quoi qu’il en soit fabriqués à Taïwan. Il y a aussi toute une partie de semi-conducteurs de basse ou moyenne gamme technologique qui ne rentrent pas dans les interdictions américaines qui ont été posées au cours de ces dernières années, y compris sous la présidence Biden et pas uniquement sous celle de Trump, qui proviennent en fait de Chine et qui sont eux aussi encastrés dans un système très complexe de fournisseurs, de coûts, etc.
Encore une fois, cette organisation de la valeur ajoutée va être très difficile à déplacer. Elle n’est pas impossible mais elle va prendre du temps. Il est difficile de comprendre pourquoi l’administration Trump a souhaité faire la guerre à tous les pays en même temps. Cela reste peu compréhensible car si on peut admettre qu’il y a un problème de capacités d’absorption du modèle économique chinois, le fait d’attaquer tout le monde revient à placer la Chine au rang d’accusé au même titre que d’autres grandes régions économiques de la planète.
On voit bien que l’administration américaine est depuis revenue sur cette position pour faire en sorte d’empêcher peut-être qu’il se forme des alliances entre l’Europe et la Chine ou éventuellement avec l’ASEAN ou encore avec le Japon.
Maintenant c’est la Chine qui est quelque part en ligne de mire. C’est aussi le cas des autres pays d’Asie du Sud-Est, du Cambodge, du Vietnam et de la Malaisie, où Xi Jinping s’est empressé de se rendre sitôt les hausses tarifaires annoncées. On peut effectivement se demander si ces pays vont pouvoir toujours servir de base de contournement pour les produits chinois pour arriver aux États-Unis. Parce que, si ce n’est plus le cas, je n’aimerais pas être aujourd’hui à la place des industriels qui doivent réfléchir, à un horizon de dix à vingt ans lorsqu’ils implantent une usine quelque part, à ce qu'ils vont pouvoir faire dans cet environnement à très fortes incertitudes si on se place dans la perspective d'une guerre commerciale qui pourrait durer une, voire plusieurs années.
Cela devient un véritable casse-tête parce que nous ne sommes pas dans nos économies en capacité de rapatrier toutes les activités industrielles sur notre sol. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas le faire pour un certain nombre de produits. Nous y serons forcément amenés pour certains médicaments ou produits stratégiques sur lesquels reposent notre indépendance, et devrons reconstruire ces chaînes de production sur l’ensemble du territoire européen.
Mais nous ne pourrons pas tout faire. Il n’en demeure pas moins qu’il y a effectivement des dysfonctionnements de l’économie chinoise qui posent des problèmes difficiles à résoudre pour l’économie mondiale.
Oui, en effet, on voit bien, comme vous l’avez dit vous-même, qu’au-delà de la Chine clairement visée par les mesures annoncées par Trump, il y a aussi tous ceux qui ont servi à la Chine à contourner ces sanctions tarifaires, à savoir les pays d’Asie du Sud-Est principalement.
Ce qui est très surprenant quand on observe la liste, c’est que, hormis le Lesotho qui est au plus haut tarifié à 50 %, on a le Cambodge qui est à 49 %. Trump s’en prend à ces pays dont on connaît le double jeu, qui sont à la fois demandeurs du parapluie de défense américain vis-à-vis d’une Chine qui devient de plus en plus agressive dans la région et, dans le même temps, qui continuent à exploiter ce grand marché chinois qui leur profite.
Est-ce que finalement Trump n’arrive pas à un objectif qui se cache derrière tout cela qui est celui déjà dans un premier temps d’amener tous ces pays, hormis la Chine a priori, à se dire prêts aujourd’hui à engager des négociations avec Trump et donc à entrer dans cette logique transactionnelle qui le singularise ?
Effectivement, on voit que pour les pays de l’ASEAN, de l’Asie du Sud-Est, c’est assez clair. Nous voyons bien qu’il y a une volonté de traiter en bilatéral et qu’un pays comme par exemple le Cambodge qui est dépendant de Pékin autant qu’il l’est de Washington a de nombreuses usines chinoises qui sont présentes et investissent sur son sol pour ensuite réexporter leur production vers les États-Unis.
D’une certaine manière, le Cambodge est pris en tenaille dans cette guerre commerciale, mais Phnom Penh a quand même besoin des retombées de ces entreprises chinoises qui sont présentes sur son sol. Cela se traduit pour ce pays par des emplois, des rentrées de devises étrangères et potentiellement aussi la construction d’un système de fournisseurs locaux et donc les enjeux sont pour ce pays aussi importants.
Mais nous voyons bien en même temps que l’ASEAN, et là je parle de la structure économique et politique de l’Association, a réagi très timidement et n’est visiblement pas en capacité comme l’Union européenne de réagir collectivement face aux États-Unis. Alors même que l’ASEAN, cinquième puissance économique mondiale, pourrait avoir effectivement un poids, comme c’est le cas de l’Union européenne face aux États-Unis, si nous assistions à une logique de blocs commerciaux, très forts, très structurés contre ces derniers.
Mais ce n’est pas le cas. Il est vrai que ce qui se cache derrière aussi, c’est quelque chose qui dépasse très largement la question de la guerre commerciale et qui est celle de l’influence géopolitique de ces deux géants notamment en Asie. Il y a des pays qui sont plus proches de la Chine et ce sont d’ailleurs ceux-là dans lesquels Xi Jinping s’est rendu et puis d’autres pays qui ont des relations plus fortes avec les États-Unis, qui ont pris des décisions ces derniers temps beaucoup plus affirmées contre la Chine sur des questions d’ordre géopolitique. Et donc tout cela se croise.
On a une administration américaine qui mélange tout, à la fois les intérêts économiques et stratégiques, c’est le cas aussi pour l’Europe, le message étant : vous ne pouvez pas continuer à dégager un excédent commercial avec nous alors que nous vous protégeons avec notre parapluie nucléaire. C’est cette idée-là que l’administration Trump essaie d’avancer.
Or les choses ne se passent pas comme cela puisqu’encore une fois nous retombons sur ce découplage qui est intrinsèque à la globalisation, entre les multinationales, les États-nations, et les consommateurs. Tout cela ne fonctionne pas exactement de cette manière, en tout cas pas de façon aussi caricaturale que l’administration Trump le présente.
C’est d’ailleurs le même argument qui a été utilisé par l’administration Trump en direction de l’Union européenne, dans un contexte que l’on connaît bien qui est celui de la guerre en Ukraine où l’Europe est placée en position de difficulté...
Oui, mais quand même avec une différence majeure dans la structure des échanges commerciaux. Nous ne sommes plus sur des échanges structurés autour de produits finis entre l’Union européenne et les États-Unis. On trouve clairement un avantage du côté américain sur tout ce qui concerne les services, alors que nous avons un avantage plus fort du côté européen sur les produits industriels, voire agricoles, même s’il y a aussi un certain nombre de produits américains dans ce secteur qui l’emportent très fortement.
Mais ce sont avant tout les produits finis qui s’affrontent quelque part dans cette guerre commerciale voulue par les États-Unis avec l’Europe. Alors que, du côté de l’Asie, nous nous plaçons vraiment sur la trajectoire de la sous-traitance, de l’approvisionnement, de la structuration de chaînes de valeur ajoutée qui sont extrêmement complexes où on trouve des étapes de production et où les pays échangent entre eux avant qu’un produit fini reparte vers les États-Unis.
Et cette structure du commerce qui est vraiment l’incarnation de la globalisation complique considérablement l’objectif qui est celui voulu par l’administration américaine, à savoir de relocaliser toutes ces chaînes de valeur ajoutée aux États-Unis. Mais nous avons aussi le même problème en Europe, ce n’est pas uniquement un problème qui est lié aux États-Unis. La manière pour nous de trouver un meilleur équilibre, ce serait que la Chine s’ouvre encore un peu plus au commerce et aux investissements venant de nos pays et que nous parvenions à un rééquilibrage avec une Chine qui est encore en situation d’hypertrophie sur le plan industriel.
Est-ce que la Chine ne se fourvoie pas en quelque sorte en partant de cette idée consistant à penser pouvoir réorienter ses exportations qui sont le moteur principal jusqu’à présent de son économie vers l’Union européenne ?
Il y a eu déjà des déclarations allant dans ce sens et nous avons vu que la présidente de la Commission européenne était extrêmement réticente à cette idée, et que l’Europe, auquel cas, n’hésiterait pas à prendre des contre mesures afin de se protéger d’une invasion de biens et de produits chinois qui se dirigeraient vers l’Europe plutôt que vers les États-Unis.
Il y a aussi une autre possibilité comme la Chine a d’ailleurs commencé à le faire, qui consiste à réorienter ses exportations vers le « Sud global », et donc vers des petits pays, ou des pays avec des économies relativement faibles mais qui ne sont peut-être pas prêts ou capables d’absorber cette avalanche de produits chinois qui arriveraient sur leurs marchés.
Je vois là trois éléments à prendre en compte. Premièrement, les déséquilibres de l’économie chinoise qui, comme je le disais précédemment, voit une hypertrophie de son industrie. Et j’insisterai sur ce point : il convient de partir des chiffres absolus et non des chiffres relatifs, parce qu’ils sont vertigineux. Quand on regarde les surplus industriels qui découlent de la manière dont est conduite l’économie chinoise, y compris cette concurrence effrénée qui existe entre localités, entre provinces, et qui donc conduit à un surinvestissement.
Ce déséquilibre pose un problème majeur pour l’économie mondiale. Pour les États-Unis, pour l’Europe et aussi pour tous les pays du « Sud global » et même pour la Chine. Il n’est plus possible de continuer comme cela.
S’agissant de l’Union européenne, il est impossible pour celle-ci d’absorber plus de produits chinois qu’elle n’en absorbe aujourd’hui, sans que cela ne crée encore un peu plus de phénomènes que nous sommes en train de dénoncer depuis des années et qui sont les mêmes qu’aux États-Unis, à savoir l’éviction ou la disparition d’un certain nombre de nos producteurs.Tant qu’il s’agissait pendant de longues années de produits sur lesquels nous n’étions plus vraiment compétitifs, rappelons ici que nous avons abandonné la filière du textile, nous estimions que si nous arrivions à nous concentrer sur les services, sur l’industrie de hautes technologies, eh bien nous continuerions à nous en sortir.Mais aujourd’hui, c’est cela qui est en jeu. Oui, nous allons peut-être avoir quelques ristournes sur des jeans, sur le textile en Europe mais il y a une élasticité sur notre capacité d’absorption et de consommation qui n’est plus aussi forte.
Il y a en effet tellement de grands groupes textiles qui produisent en Europe. Mais ce qui est extrêmement dangereux c’est ce que nous avons connu sur le solaire, et que l’on connaît maintenant sur l’automobile électrique, voire même thermique. Il ne faut pas en effet oublier que la Chine est aussi un grand producteur de véhicules thermiques. Et cela, l’Europe ne peut pas se le permettre.
On ne peut pas, là où nous sommes à la frontière technologique, laisser une déferlante de produits chinois entrer sur le territoire européen qui conduirait à perdre le seul avantage compétitif qu’il nous reste en matière industrielle. Et nous ne pouvons non plus déconnecter l’industrie des services parce que nous nous rendons compte que nous avons été très certainement beaucoup trop loin dans cette externalisation des chaînes de valeur ajoutée. Aujourd’hui, il y a plein de métiers dont nous avons perdu la maîtrise.
D’où cet effort de réindustrialisation, de réarmement dont on parle, indépendamment des questions militaires. Là aussi les déséquilibres et les dysfonctionnements qui existent sur le marché chinois, ils se posent également à l’Europe.
Et donc politiquement, on comprend que Madame von der Leyen dise à la Chine, oui nous ne sommes pas contents de ce qu’il se passe avec les États-Unis mais pour autant faites un geste tangible, sérieux à l’égard des problèmes qui subsistent entre nos deux ensembles géographiques depuis très longtemps. Je ne vois pas comment l’Union européenne se mettrait tout d’un coup à ouvrir grand ses bras à la Chine tout simplement parce qu’elle est dans une position inconfortable aujourd’hui avec les États-Unis.
Nous sommes aussi, nous Européens, dans une position très inconfortable vis-à-vis de la Chine et donc tant qu’il n’y aura pas de gestes vraiment tangibles mais qui vont nécessiter un changement de fonctionnement majeur de la part de Pékin, je ne vois pas comment l’Europe aujourd’hui pourrait tout d’un coup baisser la garde et absorber les produits chinois, surtout ceux qui arrivent désormais sur nos marchés. C’est impossible, ou alors nous courrons au suicide.
Oui, mais s’agissant du « Sud global », des pays peu développés ou les moins avancés…
Ces pays n’ont pas une capacité d’absorption illimitée par rapport aux produits chinois qui atteignent des montants colossaux. Ce sont des pays qui aspirent comme la Chine dans les années 1980 à se développer industriellement. Par ailleurs dans ce que l’on appelle le « Sud Global », il se trouve de très grands pays, tels que l’Inde et le Brésil, et d’autres plus petits, et ceux-là ne le pourront pas non plus et d’ailleurs ils ont commencé à prendre un certain nombre de mesures pour se protéger eux aussi des produits chinois.
Cela fait pratiquement 30 ans que la Chine essaie de signer un accord de libre-échange avec l’Inde mais que Delhi refuse, les entreprises indiennes en premier, car cet accord serait pour le pays délétère pour son industrialisation.
Il est vrai que Trump est très erratique, prend des mesures qui sont tout à fait irrationnelles, revient tout le temps en arrière, mais il est vrai aussi que nous avons un vrai problème dans notre capacité à absorber une économie comme la Chine.
Nous l’avons fait avec le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, un certain nombre de pays, mais avec un pays de la taille de la Chine qui connaît de tels dysfonctionnements, il est vrai qu’avec nos institutions aujourd’hui qui sont nées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons un vrai problème.
Même si nous avons fait nous aussi d’énormes erreurs, je pense notamment côté européen dans l’externalisation de nos chaînes de valeur ajoutée, le fait est que nos institutions ne peuvent plus avancer, on le voit bien, tout est bloqué à l’OMC, les institutions de Bretton Woods sont devenues désormais inopérantes.
Dès lors peut-on en conclure que finalement la stratégie de Trump et de ses conseillers est une stratégie gagnante puisque la Chine se trouve d’une certaine manière assez isolée ?
Je ne suis pas sûr qu’elle soit gagnante parce que comme je l’ai dit, il y a une telle interpénétration dans un certain nombre d’industries que ces droits de douane ne vont pas pouvoir être appliqués pendant longtemps. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que l’activité des entreprises américaines sur le sol chinois demeure tout de même encore très grande. Cela se joue à hauteur de 600 milliards de dollars américains de chiffre d’affaires par an, en particulier s’agissant de l’approvisionnement qui est très important et que là les mesures de rétorsion que pourrait prendre la Chine seraient en mesure de faire très mal à ces entreprises.
Mais la Chine en souffrirait, elle aussi. À l’image de ce que j’ai dit tout à l’heure sur le Cambodge, la Chine a besoin de Foxconn pour produire les smartphones qui partent ensuite aux États-Unis.
Et même si la Chine ne retient qu’à peu près 10 % de la valeur ajoutée des smartphones sur son territoire, vu la quantité qu’elle produit, c’est énorme. Il y a des enjeux qui sont très importants pour la Chine aussi.
Je pense que les deux pays ne peuvent pas continuer à rester très longtemps dans cette situation, ou alors nous allons aboutir à un découplage qui va devenir très important si nous persistons sur la même voie dans les mois qui viennent.
S’il y a découplage, il faudra que les gouvernements l’assument sur le plan du prix auprès des consommateurs, de l’inflation, parfois même de l’arrêt d’un certain nombre de choses. On le voit aujourd’hui sur la question des terres rares, par exemple, nous savons très bien que d’ici deux à trois ans on pourrait trouver de nouvelles usines de production de terres rares un peu partout dans le monde, et c’est certainement ce qu’il va arriver.
Et c’est pour cela que la Chine manie cet aspect avec beaucoup de précautions, parce qu’elle sait que si elle coupe véritablement ses exportations de terres rares du jour au lendemain, cela va lui causer énormément de problèmes. Mais si une rupture de confiance se produisait, il est possible que dans deux ou trois ans, les États-Unis, l’Europe, le Japon, ces centres producteurs, aillent s’approvisionner ailleurs qu’en Chine et alors celle-ci se retrouvera avec toutes ses terres rares sur les bras.
Je pense que c’est déjà le cas, il y a déjà des réflexions à ce sujet.
Tout à fait. Mais à court terme, cela pourrait quand même engendrer des problèmes majeurs pour la production d’un certain nombre de produits.
Est-ce que l’on n’assiste pas in fine à une remise en cause de la mondialisation depuis l’entrée de la Chine à l’OMC, avec les espoirs qui en étaient attendus en 2001 et qui se sont avérés finalement décevants pour la plupart des pays ?
Cette entrée de la Chine à l’Organisation Mondiale du Commerce lui a surtout profité et a fait en sorte qu’elle puisse atteindre ce niveau actuel, être la deuxième puissance économique mondiale, voire la première, selon les modes de calcul.
Jusqu’à un certain niveau d’externalisation des productions, je pense que les pays occidentaux ont été très largement gagnants, en termes de prix… Enfin cela dépend de qui l’on parle. Le consommateur moyen a été gagnant. Par contre, un certain nombre d’entreprises ont dû fermer leurs portes, avec toute la question de la désindustrialisation que cela a entraîné. Cela a été vécu différemment selon les acteurs, on le sait. Et c’est paradoxalement la désindustrialisation que certaines régions des États-Unis ont vécue qui a alimentée, on le sait aussi, un vote du parti Républicain de plus en plus dur sur ces questions, faisant en même temps que les discours populistes aient pu prendre forme et se traduire par des effets électoraux très importants dans certaines parties de ce pays. C’est tout le paradoxe de la globalisation. Il est vrai aussi que jusqu’à un certain niveau de délocalisation, il y avait quand même des gains partagés.
Et puis, par ailleurs, souvenez-vous, il y avait à ce moment-là un discours récurrent, à savoir les classes moyennes vont émerger et se développer en Chine et puis nous assisterons à une évolution politique, démocratique de ce pays. C’est un peu la même idée que l’on avait au lendemain de la guerre avec le Japon, pour s’opposer aux grèves communistes de 1946-47.
On a laissé le Japon se développer, comme on l’a fait avec l’Allemagne. Il s’agissait dans le cas qui nous occupe de raccrocher quelque part la Chine au monde démocratique. Ce sont toutes ces idées de la fin des années 1980-1990 avec la fin de la Guerre froide.
Or, cela ne s’est pas passé comme cela. C’est même allé dans le sens inverse avec les discours nationalistes conduisant aujourd’hui à une perte de confiance sur cette évolution qui était attendue. Il y a aussi cet élément important qui est qu’aujourd’hui, après une vingtaine d’années, la Chine, comme le Japon, comme la Corée du Sud ou comme Taïwan, a réussi à digérer, à assimiler les technologies étrangères, à les développer et à les porter quasiment à la frontière technologique avec une capacité d’organisation qui est remarquable.
Et donc aujourd’hui, la Chine est compétitrice et pas uniquement sur les produits à usage civil mais aussi dual, militaire. Ce qui bien évidemment effraie aujourd’hui les Occidentaux après la prédominance géopolitique qu’ils ont assurée, notamment les Américains, en Asie. Donc là, on le voit bien, ce n’est plus une guerre commerciale dont il s’agit. Et il est assez troublant de constater que la Chine est devenue un sujet bipartisan aux États-Unis depuis la fin du mandat du président Obama. Les Républicains comme les Démocrates s’accordent pour voir dans la Chine un compétiteur, voire même un ennemi sur le plan stratégique.
Donc nous ne sommes plus dans un cadre purement commercial et pour la Chine c’est aussi le cas, avec des dimensions supplémentaires où le Parti communiste chinois se sent attaqué, où on a un régime et en particulier son premier représentant qui ne peut pas apparaître faible vis-à-vis des États-Unis, après avoir construit un discours nationaliste et revanchard.
Il y a aussi tout un discours qui s’est construit aux États-Unis pour mettre à genoux la Chine. Tout cela s’entremêle pour rendre à mon avis des négociations extrêmement difficiles et une situation de blocage qui est très préoccupante sur le plan économique et commercial.
Jusqu’à présent, on parlait d’atténuation des risques, de « de-risking ». Est-ce que nous n’avons pas aujourd’hui franchi une étape supplémentaire où Trump nous entraînerait dans une logique de découplage ?
Ou tout au moins un début de découplage qui va aller en s’approfondissant avec cette deuxième économie mondiale qu’est la Chine ?
Et est-ce que l’on pourrait, si cette guerre commerciale se poursuit et s’accentue, se diriger vers une Guerre froide amenée justement par ce découplage, quand à l’époque de Trump-I, le mot de Guerre froide était prononcé mais que ceux-là vous répondait par la négative, en avançant le fait qu’il existait une interdépendance entre les deux principales économies rendant un tel scénario impossible ?
Je pense avoir déjà insisté sur le fait que ce découplage sera très dur mais en même temps, il est encore une fois très difficile de continuer aujourd’hui sur la même lancée. Et que cela soit l’Amérique ou d’autres d’ailleurs - l’Union européenne est dans la même situation que les États-Unis vis-à-vis de la Chine -, il est impensable que nous abandonnions nos industries ou plutôt ce qu’il en reste, alors que nous nous sommes réfugiés sur la très haute technologie ou des produits très complexes comme l’automobile ou l’aéronautique, que l’Europe, ou les États-Unis ou le Japon autorisent une domination totale de la Chine.
Tant que nous n'étions pas amenés à une concurrence frontale, tant qu’il s’agissait d’approvisionnement où quelque part la Chine faisait de la production et de l’assemblage mais laissait la conception et la commercialisation aux pays occidentaux, comme pour les smartphones, cela ne posait pas trop de problèmes, le système actuel pouvait l’absorber.
Mais à partir du moment où la Chine commence à s’emparer du segment de la conception et de celui de la commercialisation sur des produits à haute valeur ajoutée, donc des produits complexes, c’est tout le système de globalisation qui va en se dégradant parce qu’à ce moment-là, il n’y a plus de jeu à somme positive entre les acteurs. En effet, nous arrivons à une étape cruciale de la globalisation et autant nous avons été en capacité mais non sans mal d’absorber des pays comme le Japon, dans les années 1970-80, où il y avait eu à ce moment-là des réactions très fortes mais politiquement l’archipel était quand même sous la protection du parapluie nucléaire américain conduisant à ce qu’un certain nombre de choses changent globalement dans le sens souhaité par l’Occident.
Et puis le Japon a connu un éclatement de sa bulle immobilière qui l’a affaibli. Pour la Chine, ce n’est pas du tout le cas, ce n’est pas la même dimension, elle dispose de son indépendance politique, militaire et donc nous sommes dans une situation qui est radicalement différente et qui à mon sens permet de dire que nous sommes à une étape majeure par rapport à ce que nous avons connu depuis la fin des années 1970-80. Nous allons en payer le coût très certainement mais cela va mettre du temps. Il y a sans aucun doute une rupture de confiance.
Oui mais en même temps avec ces mesures draconiennes annoncées par Trump - nous verrons ce qu’il en ressortira à la suite des négociations qui ont déjà commencé avec un certain nombre de pays -, est-ce que cela ne va pas conduire à des ajustements de part et d’autre ?
Oui, après il faut regarder avec quels pays, l’impact que cela peut avoir. L’objectif initial de l’administration américaine cherchant à conduire à des relocalisations, à une ré-industrialisation aux États-Unis est complètement différent. Si les États-Unis veulent reconstruire une filière de l’électronique c’est en grande partie avec la Chine que cela va se jouer. Sur le textile, le fait que le Vietnam ou le Cambodge aillent négocier avec les États-Unis ne va pas changer le problème pour les États-Unis. Cela aura un impact qui sera relativement peu important dans la mesure où il sera difficile de relocaliser le textile sur le sol américain.
On en revient à ma question précédente. Que cela soit une coïncidence ou pas, force est de constater que les mesures tarifaires qui ont été annoncées par Trump le 2 avril arrivent au même moment où le Premier ministre chinois Li Qiang lors des Deux Assemblées annuelles a fait un bilan de l’économie de son pays qui n’est pas fameux.
La Chine fait face à des difficultés qui sont quand même assez importantes, à l’exception des exportations qui ont battu l’année dernière tous les records avec un excédent de quelque 1000 milliards de dollars américains, on observe que les fondamentaux sont quand même mal en point nécessitant des mesures de relance qui ont été annoncées et qui paraissent d’ailleurs assez ambitieuses dans l’environnement intérieur et extérieur actuel, sans compter que celles-ci prendront aussi du temps pour être mises en place et à avoir des effets positifs sur l’économie chinoise.
Tout à fait, mais il est vrai aussi que si nous allions jusqu’au bout de la logique de la globalisation, il faudrait que la Chine désindustrialise et se mette elle-même à investir ou à s’approvisionner massivement auprès des pays qui sont à plus faibles revenus et qu’elle se concentre éventuellement dans cette pratique comme nous l’avons fait.
Mais on voit bien et je reviens à ce que je disais tout à l’heure, on entrerait là dans une concurrence frontale sur un certain nombre de biens et de services ou de production de produits finis. Quelque part, il faudrait que la Chine et c’est pour cela que ce sera très difficile à accepter, soit prête à se désindustrialiser et qui ce faisant l’amènerait indirectement à aboutir aux mêmes erreurs extrêmement importantes que nous avons commises aux États-Unis ou en Europe.
De ce fait, la Chine ne veut pas s’appliquer ce régime dont on connaît les effets néfastes : la perte de certains métiers et d’un certain nombre de productions. Or, si l’on observe l’environnement aujourd’hui, on a plutôt affaire à une Chine qui cherche à maîtriser son niveau d’exposition qu’elle qualifie de stratégique notamment sur l’alimentaire, sur les hautes technologies, sur tout un ensemble de secteurs. On le voit bien, c’est aussi un discours de découplage qu’elle tient pour assurer sa sécurité. Dès lors, on comprend pourquoi, après ses déboires dans l’immobilier, la relance de ce pays a aussi porté sur des investissements dans l’industrie pour le rendre plus autonome.
Le problème, c’est qu’il est difficile de se désengager de cette addiction de l’économie chinoise pour l’immobilier, les infrastructures et le foncier qui ont constitué un moteur considérable pour le développement de l’économie du pays et également de son industrie. Effectivement, il faudrait aujourd’hui procéder à des transferts sociaux massifs vers la population chinoise comme aussi ralentir la production industrielle et toute cette dépendance qui existe du côté des infrastructures et de l’immobilier.
Et cela, ce sont des ajustements qui sont très longs, très coûteux pour la Chine. Par ailleurs, nous ne savons pas si elle désire vraiment le faire. Sans noircir le tableau, nous nous trouvons en face d’un pouvoir pour lequel la croissance est quand même une composante majeure du compromis politico-économique passé avec la population dès après les évènements sanglants sur la place Tian’anmen en 1989. Nous ne savons pas ce que cela traduirait politiquement en Chine si tout d’un coup elle devait tomber dans une croissance européenne à hauteur de 1 %. On en revient toujours à cette image de l’éléphant qui fait du vélo et qui tant qu’il pédale rapidement maintient son équilibre. Ce contrat social a permis finalement depuis maintenant bientôt quarante ans à la population de s’enrichir à la seule condition de ne pas se mêler de politique. Qu’adviendrait-il si ce contrat social venait à être brisé ?
Cela étant dit, la Chine est un grand marché intérieur, une économie continentale qui a la possibilité effectivement de se débrouiller par elle-même. Mais elle reste quand même tributaire d’une dépendance extérieure très importante en matière de débouchés.
On a quand même quelque part l’impression que la Chine avait anticipé d’une certaine manière le choc qui allait se produire, je pense notamment au « Made in China 2025 » où il était question et cela a été redit par le Premier ministre chinois de mettre l’accent sur les hautes technologies, l’intelligence artificielle, le quantique, sur des choses qui sont quand même d’un point de vue technologique extrêmement avancées et dans lesquelles la Chine a déjà beaucoup progressé, voire même dépassé les États-Unis ou l’Europe dans certains secteurs.
On a vu également que Xi Jinping a légèrement changé de doctrine à l’égard du secteur privé, il semble essayer à la fois de séduire les entreprises étrangères en leur promettant la mise en place d’un certain nombre de dispositions qui leur seront favorables, et dans le même temps prendre davantage en considération les entreprises privées chinoises qu’il avait jusqu’à présent un peu mises à l’écart, à l’exemple d’Alibaba.
Dans le même temps, cela reste une économie très centralisée avec un président qui décide de tout et donc qui handicape toutes ces mesures qui pourraient être mises en place mais qui seront forcément pénalisées par le système hypercentralisé défini par Xi Jinping.
Oui, nous nous trouvons à la fois sur la conjonction de plusieurs choses. Quand on parle de l’évolution actuelle et future de l’économie chinoise, nous avons des données structurelles de long terme, en particulier la démographie que l’on ne peut occulter parce que ses effets sont extrêmement rapides et très conséquents.
Et là, la Chine est entrée très clairement dans une phase accélérée de vieillissement de sa population, une décroissance de celle-ci beaucoup plus rapide que ce que l’on avait prévu. Il s’agit d’un fait majeur, comme aussi l’évolution de sa productivité du travail.
La Chine n’est plus dans la situation où elle était dans les années 1990. En schématisant, on prenait alors un paysan et on le mettait dans une usine et après la productivité explosait. Tout cela est en grande partie terminé, même s’il reste encore quelques poches de ce genre dans certaines provinces. Il y a tous ces éléments conjoncturels. Il y a aussi bien évidemment les biens et équipements des ménages qui ralentissent, le fait qu’il y a des infrastructures de très bonne qualité qu’on ne peut pas agglomérer, quand on a une inflation d’aéroports ou de kilomètres d’autoroutes dans une région où il ne sert à rien d’en construire d’autres.
Il y a une sorte de trop plein. Si on prend par exemple la surface habitable par habitant en Chine, elle est aujourd’hui comparable à celle des Européens. Bien sûr, nous pourrions imaginer qu’elle évolue encore plus comme pour les Canadiens, les Américains ou les Australiens, mais alors à ce moment-là se poseraient des problèmes environnementaux colossaux. Comment cela se traduirait-il pour la population chinoise en mètres cubes de béton et en émissions à effets de serre ? La Chine ne peut pas se le permettre mais dans le même temps nous sommes passés d’à peu près 8 ou 9 mètres carrés de surface habitable pour les Chinois à autour 35-40 mètres carrés, qui est celle en moyenne des Européens.
Donc tout cela, avec la baisse de la population, forcément on a un ralentissement naturel, on est sur un plateau, voire même sur une décroissance de l’échelle de tous ces leviers. Il y a donc tous ces effets structurels qui se conjuguent et puis il y a la manière dont on en sort et là on se rend compte que les marges de manœuvre de l’économie chinoise ne sont plus celles dont elle disposait encore il y a quelque temps, avec aujourd’hui une croissance plus faible, un endettement beaucoup plus important, des marges de manœuvre fiscale plus réduites que ce que les chiffres officiels veulent bien annoncer parce qu’il y a toute une série de déficits qui sont cachés dans les comptes des gouvernements provinciaux.
Et cela pose un énorme problème pour la Chine en matière de relance et dans le même temps cette dernière a la nécessité impérieuse de poursuivre, voire même d’accélérer la construction de ses dispositifs de transferts sociaux qui vont coûter énormément d’argent. La Chine doit faire en sorte que ces biens publics se développent.
Elle a un système financier qui est aussi très fragile et c’est bien pour cela qu’elle ne veut pas faire comme la Thaïlande ou d’autres pays, ouvrir trop celui-ci parce qu’elle en perdrait le contrôle. Ce système est très fragile, le Parti sait parfaitement qu’il pourrait se trouver quelque part des ingrédients de crises systémiques. Le gouvernement chinois qui a piloté cette industrialisation depuis la fin des années 70 veut éviter nos erreurs en matière de désindustrialisation et continue d'investir massivement pour conserver des capacités industrielles sur son sol. Nous aimerions bien être tous à 4 ou 5 % de croissance en Europe, nous serions satisfaits, mais pour la Chine c’est quelque chose de nouveau et on peut tout à fait imaginer que ce régime de croissance baisse encore d’un cran.
Dans cette hypothèse, comment réagirait la Chine ?
Nous avons toute une série d’éléments qui font que, effectivement, les marges de manœuvre de l’économie chinoise sont devenues plus faibles. Et donc quand on met tout cela à plat et que l’on rajoute le problème des droits de douane et le fait qu’un certain nombre d’entreprises, de petites entreprises, privées notamment, dans les zones côtières qui travaillaient pour l’export vont se trouver sévèrement touchées, c’est quelque chose qui ne sera pas facile à gérer.
Et l’on sait que l’on gère plus facilement quand on a 8, 9 ou 10 % de croissance que lorsque l’on a seulement 3 ou 4 %.
On se souvient des discours qui étaient tenus par les économistes occidentaux dans les années 1990 qui affirmaient que si la Chine descendait en dessous d’un taux de croissance de 7%, le pays et son régime politique s’effondreraient.
On a en effet exagéré un peu tout cela, mais il y avait quand même une part de vrai. On a vu dans les années 1990 que les problèmes financiers des mauvaises dettes se sont résolus quasiment tout seuls en une petite dizaine d’années parce que la Chine enregistrait une croissance de 10 %, faisant que la dette se dévalue d’autant par an automatiquement.
C’est peut-être un peu caricatural de dire cela, mais c’est vrai quand même. Dans les faits, la Chine ne s’est pas très préoccupée de tous ces problèmes financiers qu’elle avait et qui se sont par ailleurs résorbés par eux-mêmes. Aujourd’hui, ce n’est plus possible d’agir de la sorte.
Quant au secteur privé chinois, c’est vrai qu’il a été mis à mal par les décisions de cette recentralisation, cette reprise en main de la part de Xi Jinping. Mais aujourd’hui, même si on sent qu’il y a une volonté de remettre le secteur privé dans le circuit, la confiance n’est plus là. Et je dirais que c’est le cas aussi pour les cadres au niveau local. C’est tout l’héritage de Deng Xiaoping qui a volé en éclat.
Cette déconcentration qui était la marque de fabrique de Deng a créé des problèmes de corruption mais il est vrai aussi que la campagne anti-corruption et la mise au pas du secteur privé comme la recentralisation de toutes les bureaucraties locales ont fait qu’aujourd’hui même, si on dit à ces acteurs revenez dans le jeu, ils continueront à regarder dans leur rétroviseur. Ils ont très peur à nouveau d’être pris en défaut.
Donc personne ne bouge. En tout cas, il n’y a plus désormais en Chine la confiance qu’il y avait dans les années 1980-90 ou au début des années 2000
*****
Jean-François HUCHET est Président de l'INALCO depuis avril 2019 et professeur des universités à l'INALCO depuis 2011 et vice-président de France Universités depuis janvier 2025. Il enseigne au département Chine sur l’économie de la Chine contemporaine et sur les modes de développement économique en Asie. Il a dirigé l’équipe de recherche ASIEs à l’INALCO entre 2014 et 2017 et le GIS Asie - Réseau Asie (CNRS) entre 2013 et 2017. Docteur en sciences économiques de l'Université Rennes 1, il a résidé pendant près de 16 ans en Asie. Il a étudié à l'Université de Pékin entre 1987 et 1991 pour y apprendre la langue chinoise et mener ses recherches doctorales. Puis il a occupé des postes de chercheurs dans deux centres de recherche français à l'étranger (IFRE) pilotés par le ministère des Affaires étrangères et le CNRS : de 1993 à 1997 à la Maison franco-japonaise à Tokyo et de 1997 à 2001 au Centre d'Études Français sur la Chine Contemporaine (CEFC) à Hong Kong, dont il est devenu directeur entre 2006 et 2011. Durant cette période, il a également créé et dirigé l’Unité de Service et de Recherche « Asie Orientale » (USR n° 3331 du CNRS) qui regroupe le Centre d'Études Français sur la Chine Contemporaine à Hong Kong et la Maison franco-japonaise à Tokyo ainsi que la revue Perspectives Chinoises (et son édition anglaise China Perspectives). Il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles sur le développement économique en Chine, ainsi que sur le rôle de l’État en Asie. Son dernier ouvrage portant sur La crise environnementale en Chine, a été publié aux Presses de Sciences-Po en octobre 2016.