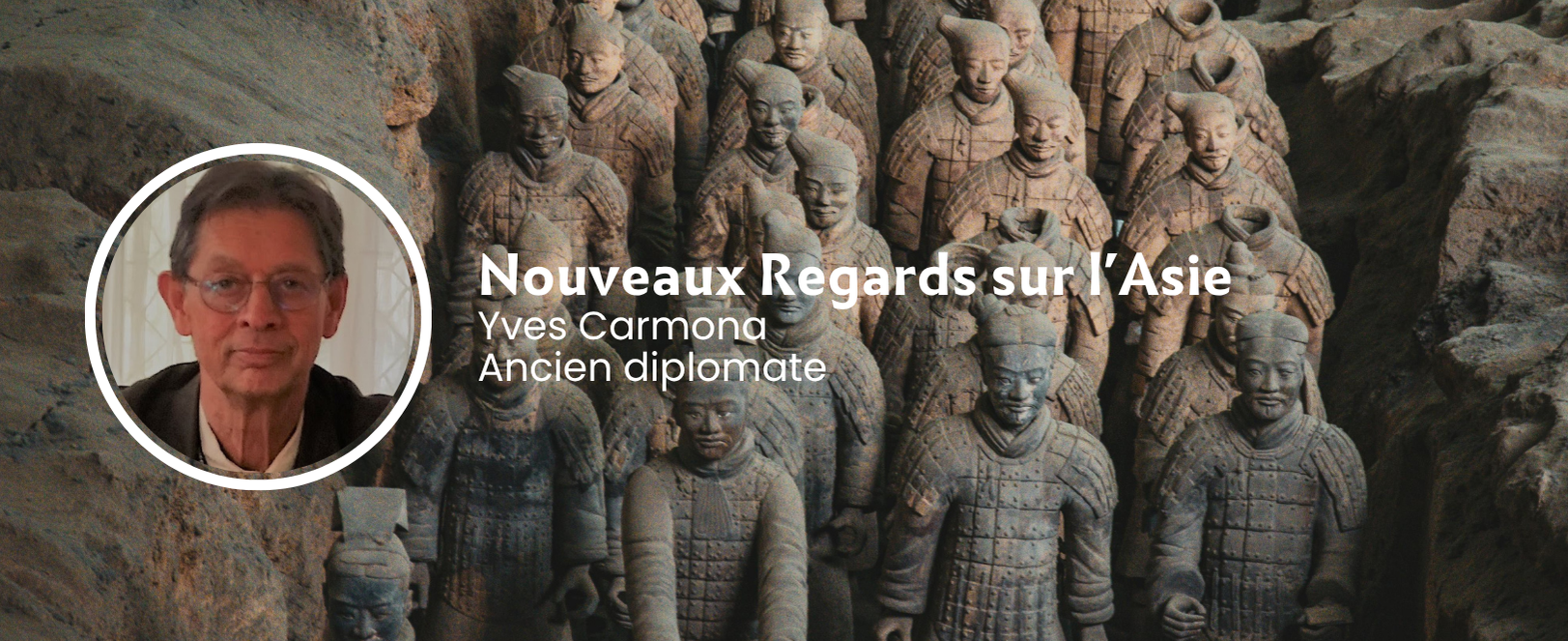
Rubrique Opinions
Par Yves Carmona
Non, c'est promis, nous n'allons pas nous consacrer exclusivement à la Chine et il faut pour cela résister aux médias de toute sorte qui se sont précipités à commenter les quelques photos que l'escouade des photographes officiels de Xi Jinping a publiées, c'est-à-dire des chefs d’État et de gouvernement que l'on n'avait pas l'habitude de voir réunis et aussi nombreux dans des sommets multilatéraux tels que l'Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) fondée en 2001.
Il est vrai que ses élargissements successifs en ont rendu membres les pays d'Asie du Sud-Est, l'Inde, le Pakistan et même l'Iran depuis 2023.
On a aussi été surpris d'y voir le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, surtout dans le contexte d'hostilité au multilatéralisme du président Trump, mais pour les Nations Unies il s'agit de considérer une organisation régionale, de loin la plus peuplée (60 % de la planète dit-on) comme participant à un ordre mondial par ailleurs fort ébranlé.
N'oublions pas que dans ce pays maître en usage orienté de la photographie, on repeignait les clichés où la « bande des quatre » apparaissait du temps de sa participation aux côtés de Mao à la victoire définitive de 1949, mais sa trahison interdisait désormais la proximité avec le Grand timonier…
Depuis, de pays pauvre, la Chine est devenue une des deux « superpuissances » mais les techniques de contrôle social y sont toujours plus efficaces.
Le forum de Tianjin, en mettant en scène le président chinois avec ses hôtes, qu'il s'agisse du criminel de guerre Poutine, du trublion Kim Jong-un, de l’irascible Modi de « la plus grande démocratie du monde », cependant malmenée par Trump, plus quelques-uns qu'on ne voit pas sur les photos mais qui sont présents et mènent des entretiens bilatéraux comme le président laotien et le Premier ministre népalais, participe à cette rhétorique.
C’est en effet l’occasion, comme dans tout forum plurilatéral, de multiplier les rencontres : ainsi le Premier ministre vietnamien rencontre ses homologues cambodgien Hun Manet, malaisien Ibrahim Anwar, indien Narendra Modi, arménien Nikol Pashinyan, ainsi que le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn.
À l'heure où l’existence même de l'ONU est remise en cause, y compris par plusieurs de ses plus hauts cadres qui ont récemment fait part au secrétaire général de leur inquiétude quand l’Organisation se montre incapable de résoudre aucun des conflits, des plus visibles comme avec l'Ukraine ou Israël et ses voisins, au moins présents dans les grands médias comme celui qui oppose le Rwanda et la RDC par groupes semi-mafieux interposés, sans parler des millions d'opprimés du Darfour, du Tibet ou du Xinjiang ; remise en cause encore plus brutale du fait du président Trump qui s'acharne à détruire l'ordre international mis en place par ses prédécesseurs démocrates à Bretton Woods en 1944, Xi Jinping ne cherche-t-il pas à montrer qu'il peut reconstruire un autre ordre, différent de celui qu'ont bâti les Occidentaux ?
C’est sans doute pourquoi il a aussi invité un ancien Premier ministre japonais opposant au parti au pouvoir (PLD), M. Hatoyama Yukio, qui après réflexion (son fils avait essayé de le dissuader) y est allé.
La parade militaire de Tianjin poursuit probablement cet objectif : elle montre que par sa puissance militaire, la Chine en a les moyens, après être sortie vainqueure de la guerre mondiale en Asie en septembre 1945 grâce à l’intervention décisive des États-Unis.
On a beaucoup glosé sur le « Sud global » dont beaucoup savent depuis longtemps qu'il n'existe pas : comment faire marcher d'un même pas l'Inde et la Chine, l’Inde et le Pakistan qui se sont fait la guerre il n'y a pas si longtemps, l'Égypte et le Brésil qui sont présents en raison de leur démographie mais dont les intérêts coïncident peu avec ceux de la RPC ?
L'auteur de ces lignes se souvient du collègue qui suivait l'évolution du G20 au début de ce siècle : un groupement - pas une organisation avec un secrétariat, etc. - qui ne parvenait à se mettre d’accord que sur un rejet de l'ordre occidental - cela a-t-il changé ?
Bon connaisseur de la Chine, François Godement l’observe : « Face à l’offensive commerciale américaine et aux tensions internationales, l’économie chinoise démontre une résilience inattendue.
La Chine a su préserver sa compétitivité industrielle grâce, entre autres, à une flexibilité logistique remarquable, une déflation continue, et un taux de change favorable. Plus étonnant encore, elle diversifie rapidement ses marchés d’exportation, renforçant significativement ses échanges avec l’ASEAN, l’Europe ou l’Afrique. Simultanément, l’économie chinoise accélère sa montée en gamme, dominant désormais des secteurs clés comme les batteries électriques, les énergies renouvelables ou les véhicules autonomes.
Cette stratégie industrielle hybride, entre public et privé, soutenue par une innovation constante et une automatisation intensive, maintient ainsi la Chine au cœur des chaînes d'approvisionnement. Toutefois, sa dépendance aux exportations reste, à court et moyen termes, un point faible structurel. » Effectivement, hyperpuissante, la Chine a aussi ses faiblesses. Son attitude par rapport à la pollution est paradoxale.
Ses grandes villes ayant subi pendant des décennies le nuage de CO2 créé par la circulation automobile, elle s’efforce aujourd’hui de la réduire drastiquement pour limiter les émissions : usage des énergies nucléaire, solaire, éolienne, limitation de la circulation automobile interurbaine en particulier grâce à un réseau de trains à grande vitesse qui ne cesse de s’étendre (y compris, à allure plus raisonnable, dans des pays voisins comme le Laos et la Thaïlande).
Mais en même temps, en achetant de grandes quantités d’hydrocarbures, elle contribue au financement par la Russie de la guerre qu’elle mène en Ukraine – plusieurs pays européens font d’ailleurs de même, suivant en cela la recommandation du président Trump dont le climato-scepticisme est affiché : « Drill, baby, drill ! And drill now ! » (fore, chérie, fore ! Et fore maintenant), a-t-il proclamé dès son investiture. Or aujourd’hui, la Chine est la puissance dominante dans l'énergie non polluante avec un tiers des dépenses mondiales dans ce secteur, 80 % des panneaux solaires et 60 % des éoliennes.
Au cours des 12 mois jusqu’à juin 2025, l’énergie éolienne et l’énergie solaire ont produit plus d’électricité que les autres sources d’énergie propre, au lieu de moitié moins il y a 4 ans, elle a déposé 75% des brevets dans ce secteur et la totalité des énergies propres représentent déjà 1/10ème de son PIB alors que les énergies fossiles, encore dominantes, plafonnent. Notons aussi que les technologies permettant une production d’énergie propre sont assez bon marché pour équiper des pays émergents, y compris en Amérique latine, il y a deux siècles chasse gardée américaine (doctrine Monroe). Elle impose ainsi une domination économique souriante (le « rêve chinois » de Xi Jinping depuis 2012) mais bien réelle.
Les principaux chefs d’État et de gouvernement réunis à Tianjin sont peut-être, comme l’a écrit un magazine généralement mieux inspiré, « 12 salopards », mais Xi Jinping ne cache pas son plaisir au point de se voir vivre jusqu’à 150 ans… Reste que son économie ne va pas au mieux. Le taux de croissance (officiel) n’a pas dépassé 5,2 % lors du deuxième trimestre de cette année, en baisse malgré les subventions à la consommation.
L’incertitude sur les droits de douane américains dont l’entrée en vigueur est pour le moment repoussée jusqu’à novembre, et surtout la crise immobilière profonde et persistante nourrissent l’inquiétude des classes moyennes.
Quant à sa puissance militaire, dont la récente croissance est impressionnante notamment par son usage de technologies de pointe et sa capacité exhibée pour la première fois à utiliser ses armes sur terre, sous mer et dans l’air, y compris dans l’espace extra-atmosphérique, à recourir à des missiles hypersoniques et à combattre les drones, elle suscite de la part de ses voisins des réactions hostiles qui soulignent son isolement.
Ainsi le quotidien Mainichi Shimbun nous apprend-il le 14 septembre dernier que « le ministère de la Défense (NDLA : sa Constitution de 1946 interdit en principe au Japon d’avoir une armée…) a annoncé son intention de déployer successivement des missiles à longue portée dans l’armée de terre, la marine et les forces aériennes d’autodéfense dans diverses régions d’ici l’exercice 2027, ce qui fournira des « capacités de contre-attaque » (des bases ennemies) en cas de nécessité.
La première destination de déploiement de l’unité de première ligne est la garnison de la Force terrestre d’autodéfense de Kengun (ville de Kumamoto), et le déploiement a commencé à la fin de l’exercice 2025.
La « possession » de capacités de contre-attaque, dont on dit aussi qu’il s’agit d’un « changement majeur » dans la politique de sécurité, est en train de se matérialiser.
La portée du missile sera étendue des 100 kilomètres actuels à environ 11 000 kilomètres. Le déploiement à Kyushu couvrira presque toute la côte orientale de la Chine et de la Corée du Nord, et devrait renforcer la dissuasion en pensant à la Chine, qui s’est livrée à plusieurs reprises à des activités militaires intimidantes. »
C’est que certains, à Tokyo, imaginent que les nombreuses incursions chinoises à proximité de Taïwan pourraient l’inciter à lancer une opération limitée, bien moins coûteuse en hommes et en équipements qu’une conquête de l'île « rebelle » mais qui constituerait une prise de guerre pour inciter le Japon à éviter de lui porter secours.
Certes, les États-Unis sont censés protéger et Taïwan et le Japon, mais qui fait encore confiance au Président Trump ?
Ses voisins d’Asie du Sud-Est également sont inquiets, au point que les manœuvres de la Chine visant à transformer des récifs en îles habitées ont été considérées en 2016 par la Cour permanente d’arbitrage de La Haye comme condamnables car ces récifs sont inclus dans la zone économique exclusive des pays riverains, ici les Philippines, mais Pékin a rejeté cet avis juridique.
Plus menaçante pour Pékin, la mise en place progressive d’une « stratégie indo-pacifique » lancée par Shinzō Abe (1954-2022), Premier ministre nippon, faisant face dès 2007 aux atermoiements américains et associant progressivement Inde, Australie, États-Unis et ASEAN.
Dans cette grande partie géopolitique, de meilleures relations entre le Japon et la Corée du Sud encouragées par le récent remplacement de son Président conservateur destitué par M. Lee Jae-myung, plus conciliant, peuvent constituer entre ces deux pays industrialisés et démocratiques d’Extrême-Orient, alliés des États-Unis dont les bases militaires dans la région sont nombreuses, une menace bien plus redoutable aux portes de la Chine.
Conclusion : le sommet de Tianjin dont on a retenu l’impressionnant déploiement militaire dans la parade célébrant la fin de la Seconde guerre mondiale en Asie donnera-t-il naissance à un « nouvel ordre » gouverné par la Chine ? Ou celle-ci se contentera-t-elle d’imposer le « rêve » lénifiant de Xi Jinping en jouant de sa puissance économique ?
Épisode à suivre.
*****
Ancien élève de l’ENA et diplomate, Yves CARMONA a passé la plus grande partie de sa carrière en Asie : conseiller des Affaires étrangères au Japon à deux reprises, premier conseiller à Singapour et ambassadeur au Laos puis au Népal (2012-2018). Dans ces postes comme dans ceux qu’il a occupés à Paris, il a concentré, y compris comme étudiant en japonais, son attention sur l’évolution très rapide des pays d’Asie et de leurs relations avec la France et l’Europe. Désormais retraité, il s’attache à mettre son expérience à disposition de ceux et celles à qui elle peut être utile.