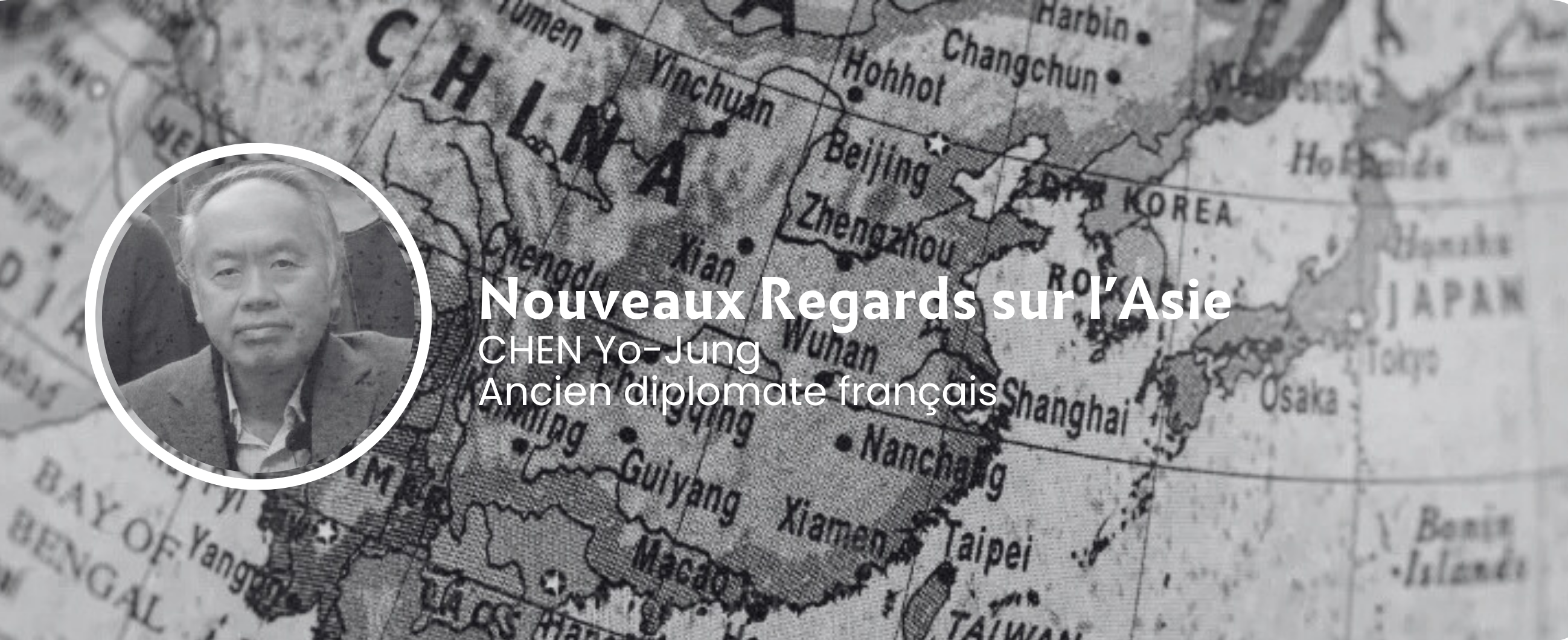
Par Yo-Jung CHEN
L’Asie du Nord-Est (Chine, Japon, les deux Corées, Taïwan, et, plus éloignée, Russie orientale) est une région ayant plus ou moins en partage l’influence de la culture chinoise. Malgré cette communauté culturelle, c’est une région profondément divisée, aujourd’hui encore, par les mémoires amères de la Deuxième Guerre mondiale et par les rivalités de la Guerre froide, tout en étant unie dans une croissance économique et technologique remarquable qui en fait, avec l’Asie du Sud-Est, le « nouveau centre du monde ».
Entretenus par une importante présence militaire américaine face aux pays communistes autoritaires (Chine, Corée du Nord) de la région, les antagonismes idéologiques et nationalistes persistants n’ont pas permis à la région d’évoluer au-delà des mentalités de la Guerre froide pour réaliser une intégration régionale du type de celles de l’UE ou de l’ASEAN.
L’Asie du Nord-Est est, sur le plan politique, profondément divisée selon une démarcation typique de l’affrontement Est-Ouest. D’un côté, l’alliance des régimes autocratiques (Chine, Corée du Nord, Russie) fait face aux alliés démocratiques de l’Amérique : Japon, Corée du Sud, Taïwan. Dans le contexte de cette rivalité politico-militaire persistante, les deux blocs, à l’exception de la Corée du Nord, participent à une constellation d’interdépendances économiques centrées sur le désormais incontournable dit « Empire du Milieu » (Zhongguo).
Cette Asie du Nord-Est s’attend aujourd’hui avec appréhension à voir son ordre géopolitique et géoéconomique bouleversé par le retour au pouvoir à la Maison Blanche d’un Donald Trump plus erratique, plus impulsif et plus intraitable que celui du premier mandat de 2016. D’autant plus que la nouvelle administration américaine a déjà laissé entendre que sa priorité géostratégique dorénavant ne serait plus le « Vieux Continent » mais l’Asie, avec un focus particulier sur la République Populaire de Chine, son plus grand rival.
L’inquiétude que partage l’ensemble de la région porte notamment sur un trait spécifique à Donald Trump et à certains membres de sa nouvelle administration : s’il a désigné l’Asie comme le point focal de sa diplomatie, le 47ème président américain fait preuve d’une ignorance inquiétante des subtilités de cette région. En plus de l’incapacité de son équipe (son Secrétaire à la Défense, Pete Hegseth) de nommer un seul pays membre de l’ASEAN, cette inquiétude générale est confirmée par exemple par sa façon de s’offusquer de « l’inégalité de traitement au détriment de l’Amérique » constatée dans les dispositions du Traité de Sécurité nippo-américain (les Américains s’engagent à défendre le Japon mais les Japonais ne sont pas tenus de défendre l’Amérique en cas d’attaque). Le chef d’État américain fait là la preuve de son ignorance oubliant que c’est son propre pays qui avait dans les années 1950 imposé ce Traité au Japon par souci d’endiguer l’expansion du communisme en Asie.
Une mise en cause de ce Traité par son « auteur » même risque de remettre complètement en question la fondation sur laquelle repose la sécurité nationale du Japon depuis la fin de la Guerre du Pacifique. Par ailleurs, la manière de M. Trump de menacer de retirer les garnisons américaines au Japon et en Corée du Sud démontre également son ignorance quand c’est l’Amérique elle-même qui avait imposé le stationnement de ses troupes en Asie dans les années de la Guerre froide. Il semble ne pas savoir que ces déploiements des forces américaines servent plus les intérêts stratégiques de son propre pays que ceux des pays hôtes !
Sur le plan économique, aucun pays de cette région n’échappera à la guerre commerciale tous azimuts dans laquelle s’est précipité Trump-II, et chacun va devoir trouver sa façon d’y faire face selon l’état et la nature de ses relations avec l’Amérique. Sur le plan stratégique, tout le monde, alliés ou non de Washington, retient son souffle devant les bouleversements inévitables de la carte géostratégique régionale qui s’annoncent, sachant qu’avec Trump-II, et au vu de sa façon de traiter avec mépris les alliés européens et l’Ukraine, il ne faudra plus compter sur les valeurs partagées ni les amitiés/alliances nouées jusqu’ici avec la capitale américaine. Dorénavant, c’est la loi des échanges transactionnels intéressés, chère au nouveau locataire de la Maison Blanche, qui va dominer toutes les relations de l’Amérique avec le reste du monde.
Dès avant le retour de M. Trump, l’ensemble de l’Asie, alliés ou non de l’Amérique, entretenait déjà un doute croissant sur la fiabilité de la « Pax Americana ». Le retour d’un président américain isolationniste, transactionnel et s’aliénant ses alliés européens, ne fait qu’accentuer la prémonition des alliés asiatiques comme le Japon, la Corée du Sud et Taïwan quant à la crédibilité de l’engagement américain à les défendre. L’on doute que M. Trump risquerait une guerre ouverte avec la puissante Chine pour défendre des alliés en Asie qui, de surcroît, ne « paient même pas la facture de leur protection américaine », à l’entendre.
C’est le sort de Taïwan qui est en tête des préoccupations stratégiques dans la région. Témoins de la façon dont M. Trump traite ses alliés européens et l’Ukraine, affichant au passage et sans le moindre scrupule son admiration pour un dictateur comme M. Poutine, une grande partie des acteurs de la région sont persuadés que l’homme d’affaires du Bureau Ovale n’hésiterait pas à « lâcher » Taïwan en échange d’une concession avantageuse que lui concéderait l’autre dictateur siégeant à Pékin. Une telle éventualité aurait des répercussions stratégiques catastrophiques pour tous les autres alliés américains (Japon, Corée du Sud, Philippines…) en Asie et même pour l’Amérique elle-même.
L’attitude décomplexée de Trump-II à l’égard du dictateur russe en Europe dans le dossier ukrainien, amène les observateurs en Asie à ne plus exclure la possibilité de le voir se comporter de la même façon vis-à-vis des deux autres despotes en Asie : Xi Jinping et Kim Jong-Un. Dépendants de la plus ou moins large latitude des concessions que Trump serait prêt à leur faire, Tokyo et Séoul (et peut-être aussi Taïwan) pourraient alors être tentés de s’embarquer sur une voie jugée tabou jusqu’ici : l’acquisition de leur propre armement nucléaire pour faire face, sans l’Amérique, aux États dotés à leur proximité. L’Asie du Nord-Est serait alors plongée dans une spirale dangereuse de course à l’armement nucléaire.
Asie du Nord-Est : Chacun ses soucis avec Trump.
- Chine
En pleine montée en puissance, la Chine suscite l’envie et la convoitise du fait de son énorme potentiel économique, mais aussi une appréhension générale face à sa musculature militaire renforcée qu’elle n’hésite pas à fléchir devant ses voisins et ses adversaires occidentaux. Émergeant du « siècle d’humiliation » infligée par l’occupation occidentale, la nouvelle Chine de Xi Jinping exige à sa façon le respect que le monde vouait par le passé à la Chine des Hans (l’empire Ming) d’avant la dynastie mandchoue Qing (1644-1911).
Alors que les activités économiques en accélération dans la région tournent autour de ce nouvel Empire, le réveil du géant représente une menace sécuritaire aussi bien pour ses voisins (Japon, Taiwan, Corée du Nord, pays de l’Asie du Sud-Est), avec lesquels subsistent des contentieux territoriaux, que pour l’Amérique dont la suprématie sur l’ensemble du Pacifique est de plus en plus contestée.
Dans l’immédiat, ses revendications territoriales sur l’ensemble de la Mer de Chine méridionale provoquent des tensions croissantes avec les pays limitrophes (Vietnam, Philippines, Malaisie), l’Amérique et ses alliés occidentaux. Pour contrer cette revendication illégitime (puisque rejetée en 2016 par la Cour permanente d’arbitrage (CPA) de La Haye) et empêcher que cet espace international ne soit transformé en un lac chinois, les marines américaine, française, allemande, britannique, australienne, néozélandaise et japonaise pratiquent régulièrement des démonstrations de « libre passage » dans les eaux internationales de cette mer.
S’ajoute la dispute sino-japonaise autour des îles Senkaku (appelées Diaoyutai par les Chinois) dont l’administration a été « confiées » au Japon par l’Amérique à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce que contestent la Chine et, sur un ton moins véhément, Taïwan. Les incursions fréquentes des garde-côtes chinois dans les eaux territoriales de ces îles inhabitées constituent une menace de tous les instants pour Tokyo.
Il ne faut pas oublier non plus la menace chinoise très réelle et imminente qui pèse sur Taïwan n’excluant pas le recours à la force pour « unifier » (comprendre annexer) ce territoire devenu démocratique mais que Pékin considère comme sien alors qu’il a toujours été autonome (sans être « indépendant » de jure) et de surplus jamais administré par la RPC depuis sa fondation en 1949.
À plus grande échelle, les ambitions maritimes croissantes de la Chine sont en train de poser un défi à la prédominance stratégique américaine dans le Pacifique. Pour l’instant, la capacité de la flotte chinoise, avec ses deux bientôt trois porte-avions et ses sous-marins nucléaires d’attaque, est encore géographiquement restreinte par l’obligation de se faufiler à travers la première « chaîne » que forment les îles japonaises d’Okinawa et de Taïwan pour sortir en pleine mer dans le Pacifique. Mais Pékin place déjà ses pions en nouant avec des États-îles du Sud-Pacifique des accords sur les droits d’escale pour sa flotte militaire en échange d’une coopération économique généreuse.
Récemment, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, les deux alliés américains dans le Pacifique, ont eu la désagréable surprise d’assister, sans préavis, à un exercice à munitions réelles conduit par trois vaisseaux chinois dans la Mer de Tasman qui sépare les deux pays.
L’incident a tous les airs d’une provocation en direction de Washington porteuse du message que l’Amérique n’est plus seul maître dans le Pacifique.
Le Vice-Président Vance a averti l’Europe fin février que les États-Unis ne voulaient plus perdre leur temps avec les Européens quand leur attention se portait dorénavant principalement sur l’Asie, c’est-à-dire sur la Chine, son plus grand rival.
Le moment ne peut qu’être pire pour Pékin qui traverse actuellement un ralentissement spectaculaire de sa croissance économique. Le tout dernier Congrès annuel du Peuple a d’ailleurs adopté début mars un objectif « officiel » de croissance plutôt modeste de 5%, sans avoir la conviction de pouvoir l’atteindre (mais le PCC pourra s’arranger pour qu’il le devienne). Les premiers décrets en forme de punitions tarifaires signés par Trump ont déjà provoqué un début d’exode des entreprises étrangères implantées en Chine, américaines en premier, pour lesquelles l’environnement s’était déjà sensiblement détérioré dans la mauvaise conjoncture politico-économique actuelle de ce pays qui ressemble de moins en moins à un eldorado.
Avec la promesse d’autres sanctions tarifaires venant de Washington, la Chine creuse ses tranchées et affirme sa détermination de répondre du tac au tac en s’attaquant aux produits américains.
Sur le plan stratégique, on ignore encore, avant la rencontre au sommet sino-américain prévue en juin, ce que M. Trump envisage concrètement à l’encontre de la Chine ou de l’Asie en général. Ses prises de position sur le dossier brûlant de Taïwan par exemple évoluent de façon chaotique au quotidien, laissant soupçonner une inquiétante ignorance du dossier. Il s’offusque non sans raison de l’énorme déséquilibre de la balance commerciale en faveur de Pékin. Il se plaint de la présence chinoise croissante partout dans le monde, notamment aux deux extrémités du Canal de Panama (dont les ports ont depuis été rachetés par Washington) et au Groenland, qui se présentent dans sa bouche comme des projets d’annexion (et du Canada !). Il accuse aussi la Chine d’inonder son pays de fentanyl, un produit opiacé hautement addictif et létal.
Malgré tout, la Chine semble garder un certain optimisme quant à sa capacité à engager un dialogue constructif avec son rival américain. Du fait de son économie en berne, Pékin souhaite plutôt pour l’heure éviter de croiser le fer avec l’Amérique. Par ailleurs, connaissant maintenant bien la personnalité de M. Trump depuis son premier mandat, notamment son penchant particulier en faveur des autocrates, M. Xi semble être confiant de pouvoir trouver avec l’auto-proclamé « génie du marchandage » un accord « gagnant-gagnant » sur les grands dossiers qui occupent les deux superpuissances.
La Chine a beaucoup à gagner d’un tel dialogue surtout si elle parvient à intéresser le président des États-Unis à ses grands projets à l’échelle mondiale comme son initiative des nouvelles Route de la Soie, ou la proposition que Pékin avait faite (sans succès) du temps de Barack Obama d’un égal partage de l’Océan Pacifique entre les deux superpuissances.
- Japon
Premier allié de l’Amérique en Asie, le Japon, jadis 2e puissance économique du monde, a perdu sa magnificence d’antan au cours de la dernière décennie face à la concurrence de la Chine et d’autres puissances émergentes comme la Corée du Sud et Taïwan.
À cause de sa maladresse dans le règlement définitif des séquelles d’une guerre qu’il avait déclenchée il y a près d’un siècle, à laquelle s’ajoute un litige territorial avec tous ses voisins sans exception, le pays du Soleil-Levant reste impopulaire dans la plupart des pays de l’Asie du Nord-Est. En plus de l’antagonisme idéologique, la Chine l’accuse aujourd’hui encore de refuser de reconnaître ses crimes de guerre commis il y a plus de 80 ans. Accusation partagée par la Corée du Sud, ancienne colonie japonaise, qui est pourtant un allié stratégique pour le Japon et l’Amérique. La Corée du Nord, avec son développement accéléré et incontrôlé de missiles balistiques et d’armes nucléaires, constitue, en plus de la Chine, une menace pressante pour Tokyo et Séoul. La Russie, alliée de Pékin et de Pyongyang, refuse de restituer au Japon les quatre îles (Kouriles) au nord de Hokkaido dont l’URSS s’était emparée après la défaite du Japon en 1945, laissant en suspens la question de la fin officielle des hostilités entre les deux pays. Il n’y a que Taïwan, en permanence menacée d’une annexion par la Chine, qui demeure véritablement nippophile dans toute cette région.
Vivant sous la protection du parapluie nucléaire américain depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon, en contrepartie et dans le cadre du Traité de Sécurité nippo-américain, se montre un hôte particulièrement généreux à l’égard de l’armée américaine qui maintient plus de 70 bases et 50 000 militaires réparties sur l’ensemble du territoire de l’archipel en se comportant comme le véritable maître du pays.
Dans ce contexte, le premier souci de Tokyo face à l’avènement de Trump-II est celui des menaces généralisées de tarifs douaniers supplémentaires que ce dernier lance au monde entier. Avec une économie qui dépend largement des USA, le Japon s’empresse d’obtenir un « traitement spécial de faveur » de la part du nouveau président américain. A la différence des autres pays, il n’est jamais question pour Tokyo de « riposter » en utilisant les mêmes méthodes aux menaces de son suzerain dans cette guerre commerciale. Le Japon s’efforce donc, sans succès, de convaincre l’équipe de M. Trump de prendre en considération l’amitié personnelle que ce dernier avait nouée avec feu Abe Shinzo, ancien Premier ministre assassiné en 2022, ainsi que les énormes efforts d’investissements consentis jusqu’ici par le Japon aux USA, et les promesses d’autres à venir, pour obtenir ce « traitement de faveur » tant désiré par Tokyo.
Il est vrai que le nouveau locataire de la Maison Blanche tient souvent des propos « aimables » sur le Japon et a reçu l’actuel Premier ministre Ishiba dès sa prise de fonction (juste après Benjamin Netanyahou). Cette attitude amicale apparente n’a cependant pas empêché M. Trump de s’offusquer de l’énorme déficit commercial enregistré par son pays avec le Japon et de crier au scandale en découvrant une soi-disant inégalité au détriment des USA dans les dispositions du Traité de Sécurité nippo-américain (voir supra). Ces prises de positions de M. Trump ont suffi pour convaincre Tokyo qu’il lui sera inévitable de devoir « payer » davantage pour satisfaire le président-homme d’affaires américain. La capitale nipponne s’est résignée à (devoir) payer des droits douaniers supplémentaires imposés par M. Trump, notamment pour ses exportations de voitures et d’acier.
Ses exportations de voitures vers les USA par exemple verront augmenter leurs tarifs douaniers de 2,5% à 25%. Par ailleurs, Tokyo, avec sa sécurité nationale reposant entièrement sur le dispositif de sécurité nippo-américain, et en dépit de sa « Constitution pacifique », se résigne, devant la pression soutenue américaine (il n’est jamais question dans l’esprit de Tokyo de résister aux desiderata de l’Amérique !) à relever sensiblement son budget de défense. Prévu de passer à 2% de son PIB d’ici 2027, celui-ci devrait atteindre à celui-ci devrait atteindre à terme 3% si l’on en croit les propos d’Elbridge Colby, nouveau Sous-secrétaire à la Défense. Et le Japon devra aussi payer davantage pour les frais d’entretien des forces US sur son sol.
- Corée du Sud
Face à la menace constante de son frère-voisin du Nord depuis l’armistice mettant fin (provisoirement ?) à la Guerre de Corée, Séoul est le 2ème plus important allié des États-Unis après le Japon dans la région. Démocratie prospère et hautement industrialisée, elle dépend fortement des forces américaines (plus de 30 000 soldats) stationnées sur son sol pour maintenir une paix fragile face à Pyongyang.
Sur le plan économique, cette nouvelle puissance industrielle semble se résigner à subir de plein fouet les attaques américaines en matière de droits douaniers supplémentaires. Le pays est actuellement immobilisé sur le plan diplomatique par la grave crise politique qu’elle traverse avec son chef d’État destitué, arrêté et inculpé pour avoir décrété la loi martiale en décembre 2024. La paralysie politique qui s’est ensuivie ne permet pas à Séoul de prendre les initiatives nécessaires vis-à-vis de Washington pour obtenir un régime de faveur.
Ceci étant dit, l’importance stratégique de ce pays, faisant face au pays autoritaire le plus dangereux au monde, ne permet pas à l’Amérique, même avec un président imprévisible et isolationniste, de l’ignorer. Trump par le passé a déjà menacé de retirer les troupes américaines si Séoul ne payait pas davantage pour leur maintien dans la péninsule. Anticipant la demande américaine, Séoul a rehaussé sa contribution de 8,3 % entre 2026 et 2030 (soit 1,3 Mds USD/an).
En plus de cette pression renouvelée de la part de l’Amérique de Trump pour un effort accru en matière de défense, les Sud-Coréens doivent aussi se préoccuper de l’amitié personnelle bien connue entre M. Trump et Kim Jong-Un, qui se sont rencontrés à plusieurs reprises lors de son premier mandat. Connaissant la personnalité imprévisible de Donald Trump, l’éventualité pour Séoul d’être trahie par l’Amérique à la suite d’une transaction Trump-Kim n’est pas à exclure.
L’incertitude croissante sur la fiabilité de l’allié américain semble avoir relancé à Séoul le débat sur la nécessité d’acquérir une indépendance en matière de défense nationale. Le débat comprend l’éventualité pour la Corée du Sud de se doter d’armes nucléaires afin de se protéger d’une Corée du Nord déjà reconnue (par inadvertance !) en tant que « puissance nucléaire » par Donald Trump. Une telle éventualité a toujours été catégoriquement rejetée par l’Amérique par souci de non-prolifération nucléaire. Or, l’Amérique n’est plus ce qu’elle a été et il n’est pas certain que son nouveau maître ait la moindre idée de la signification de la non-prolifération.
Certains experts, sur la base des propos tenus par M. Colby lors de son audition de confirmation au Sénat, soupçonnent que la nouvelle équipe à Washington pourrait entretenir l’idée de pousser Séoul à se charger de sa propre sécurité nationale afin de mettre les forces américaines stationnées en Corée au service d’un engagement contre la Chine en cas d’une agression par cette dernière de Taïwan.
- Taïwan
Comme nous l’avions décrit dans « Le Japon coincé entre la Chine et Taïwan » (voir le numéro de janvier 2025 de « Nouveaux Regards sur l’Asie »), l’île, première démocratie en Asie et jouissant d’une grande prospérité, est au centre des préoccupations stratégiques dans cette partie du monde. Constamment menacée d’annexion forcée par la Chine et exclue de la communauté internationale sous pression chinoise, l’île doit sa survie jusqu’ici à la détermination de l’Oncle Sam de la protéger.
Le sort de Taïwan comporte une importante incidence sur l’ensemble de la sécurité stratégique de cette région. Si les États-Unis décidaient d’abandonner l’île à son sort à la suite d’une transaction entre Jinping et Donald, comme ce dernier semble vouloir le faire actuellement avec l’Ukraine, cela remettrait totalement en question la crédibilité des alliances que l’Amérique entretient jusqu’ici dans la région. Une telle perte totale de confiance en l’Amérique lancerait nécessairement Tokyo et Séoul (et Taïwan ?) dans une course aux armements, pouvant aller jusqu’à l’acquisition rapide d’armes nucléaires du fait de leur degré d’avancement dans ce domaine.
Ce scénario ne pourrait que conduire à une explosion de la tension avec la Chine et la Corée du Nord déjà nucléarisées, transformant l’ensemble de la région en une formidable poudrière prête à exploser.
Un autre scénario plus pacifique mais non moins catastrophique pour l’hégémonie américaine dans la région est aussi envisageable : la perte éventuelle de Taïwan signifierait pour Tokyo et Séoul que la Chine prenne contrôle de leur route vitale d’approvisionnement en matières premières (pétrole, gaz...) en provenance du Moyen-Orient, laquelle passe au large de l’île. Ces deux alliés démocratiques de l’Amérique se verraient alors obligés de se plier davantage aux exigences diverses de la Chine communiste, finissant en fin de compte par rejoindre la sphère d’influence chinoise.
La région entière retient donc son souffle en attendant de voir comment l’homme d’affaires du Bureau ovale va se pencher sur le dossier épineux de Taïwan, connaissant le respect amical qu’il a pour le président chinois et sachant qu’avec lui et qu’au vu de sa façon de traiter les alliés européens, les intérêts passent avant les valeurs du monde libre.
Pour le moment, M. Trump laisse planer un flou sur ce qu’il a en tête pour Taïwan. Tantôt il rejette l’idée de risquer une guerre avec la Chine pour défendre une île « qui n’a même pas payé la facture de sa protection », tantôt il affirme vouloir punir la Chine de 200% de tarifs douaniers si cette dernière tente de s’emparer de l’île.
Par ailleurs, M. Trump a en février dernier fait une sortie virulente contre Taïwan qu’il accusait d’avoir « dérobé » aux États-Unis son industrie de semiconducteurs. En fait, Taïwan, avec sa firme TSMC, est aujourd’hui le premier fournisseur mondial de microprocesseurs de pointe, un avantage qui constitue un atout majeur pour sa sécurité nationale. L’accusation soudaine de l’homme le plus puissant du monde a suscité une levée de boucliers à Taipei et, afin de ne pas s’aliéner M. Trump, a poussé TSMC à annoncer un investissement de l’ordre de 100 milliards de dollars en Arizona. Le projet a été accueilli avec satisfaction par Donald qui n’a pu cependant s’empêcher de rajouter une remarque qui semble trahir une arrière-pensée plutôt inquiétante, à moins qu’il ne s’agisse que
que d’une mauvaise blague comme il en a pris l’habitude : « Maintenant que la technologie de pointe de TSMC va être transférée chez nous, nous n’avons plus à nous faire de soucis sur le sort de Taïwan ! »
Heureusement pour Taipei, en dépit du flou pesant sur les intentions du chef d’État américain, la nouvelle administration américaine semble continuer à fonctionner sur le mode de la défense de Taïwan, en conformité avec les dispositions du « Taiwan Relations Act » (TRA) qui a force de loi. Mais Taipei devrait consentir un budget de défense sensiblement supérieur, allant jusqu’à 10% de son PIB, comme l’a suggéré le nouveau sous-Secrétaire à la Défense précédemment cité. L’île devra par ailleurs effectuer un achat massif d’armes américaines pour calmer le mécontentement de M. Trump concernant le déséquilibre commercial bilatéral..
Certains experts, sur la base des propos tenus par M. Colby lors de son audition de confirmation au Sénat, soupçonnent que la nouvelle équipe à Washington pourrait entretenir l’idée de pousser Séoul à se charger de sa propre sécurité nationale afin de mettre les forces américaines stationnées en Corée au service d’un engagement contre la Chine en cas d’une agression par cette dernière de Taïwan.
- Corée du Nord
État paria, la Corée du Nord se voit constamment condamnée par les résolutions de l’ONU et à des sanctions de la communauté internationale, dans sa course démesurée en vue de se doter d’armes nucléaires et de missiles balistiques toujours plus puissants.
Sous la direction de KIM Jong-Un, cette course folle à l’armement affame sa population et inquiète ses voisins, dont en premier lieu Séoul et Tokyo. Sa politique en la matière a même mis mal à l’aise Pékin, son seul et véritable allié. La capitale chinoise semble en effet voir d’un mauvais œil le récent rapprochement entre Pyongyang et Moscou, avec l’engagement de troupes nord-coréennes aux côtés de celles de Moscou dans sa guerre contre l’Ukraine, qui s’accompagne en contrepartie pour Pyongyang d’une aide de la Russie dans le développement de son arsenal balistique, contribuant à davantage déstabiliser cette partie du monde.
À en juger par ses actions passées (essais nucléaires et tests de missiles intercontinentaux), on pourrait soupçonner que le dictateur nord-coréen tente par-dessus tout à faire reconnaître par Washington son statut de « puissance nucléaire » lui permettant de rivaliser avec les pays dotés. Ce n’est pas faute d’avoir essayé de l’atteindre à la suite de ses trois rencontres avec Trump-I en juin 2018 à Singapour, en février 2019 à Hanoï et en juin 2019 à Panmunjom, cette dernière n’ayant pas eu de suites. De surcroît, M. Trump, apparemment dans l’ignorance de la gravité de ses propos, a qualifié en février dernier la Corée du Nord de « puissance nucléaire », une qualification que la communauté internationale a soigneusement évitée jusqu’ici. Il accorde ce faisant à Kim Jong-Un le couronnement qu’il briguait depuis tant d’années et que la communauté internationale, dont précisément les USA, refusait justement de lui accorder.
Il est donc tout à fait possible que Trump-II, qui n’a de cesse de se vanter de sa relation amicale avec M. Kim, poursuive sur cette ligne de détente avec Pyongyang. Si tel était le cas, la question pour le moins préoccupante pour les alliés traditionnels de l’Amérique en Asie serait de savoir si le président américain irait jusqu’à pousser cette détente avec le Nord au mépris de ses intérêts avec le Sud, allant peut-être jusqu’à réduire sa présence militaire dans la zone.
Un tel scénario ne manquerait pasde plonger l’ensemble de l’Asie du Nord-Est dans la plus grande confusion stratégique jamais imaginée jusqu’à récemment.
*****
Yo-Jung CHEN
Né en 1947 à Taïwan, CHEN Yo-Jung a grandi au Vietnam et à Hong Kong. Il a fait ses études supérieures au Japon puis a servi pendant 23 années à l’ambassade de France à Tokyo en tant qu’attaché de presse et traducteur interprète. Naturalisé Français en 1981, Chen Yo-Jung est devenu en 1994 fonctionnaire titulaire du Quai d’Orsay. Il a servi en tant que consul adjoint/conseiller de presse dans plusieurs postes diplomatiques et consulaires français, dont à Tokyo, Los Angeles, San Francisco, Singapour et Pékin, avant de prendre sa retraite au Japon en 2012.