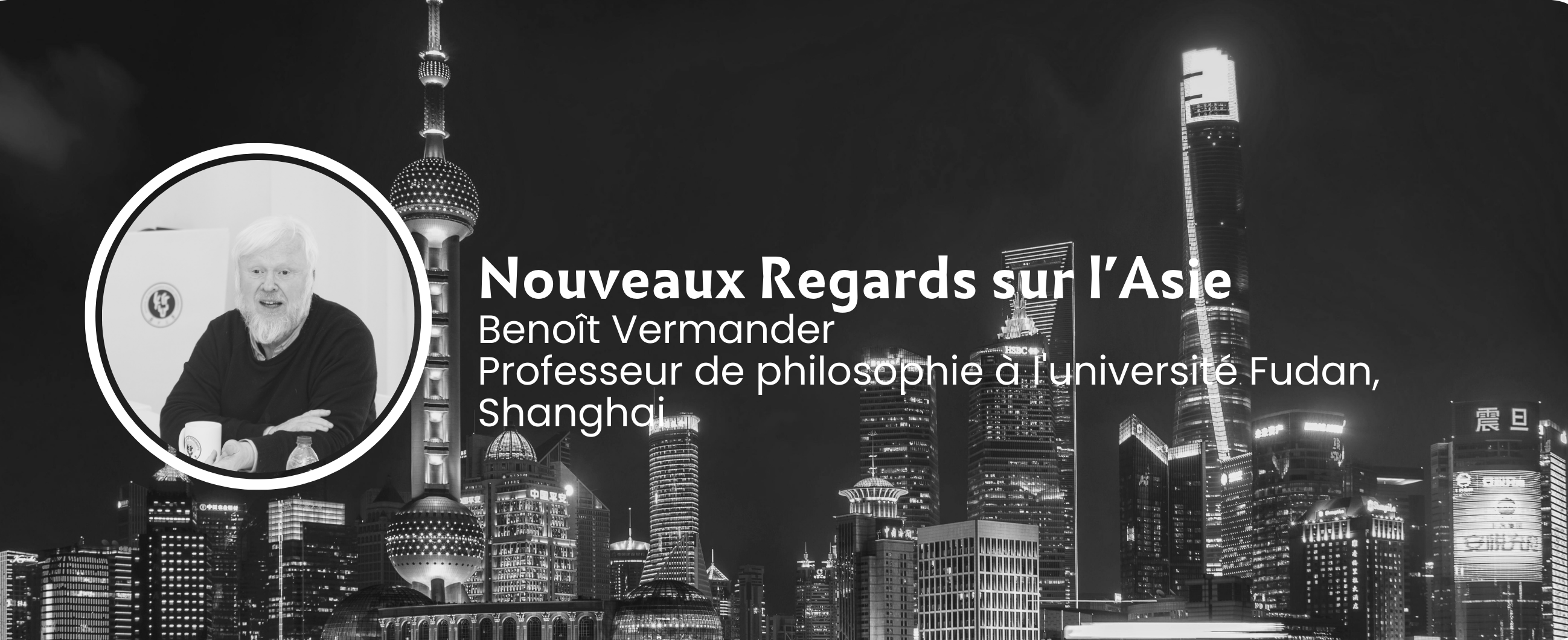
Par Benoît Vermander
Le 25 février, Jin Li, président de l'Université Fudan, à Shanghai, présentait publiquement les réformes d’ampleur que son équipe allait mettre en œuvre à l’université, après une phase préparatoire de deux ans. L’annonce de certains des axes choisis - la réduction du nombre d’étudiants en lettres et sciences humaines et sociales (SHS) à 20 % des effectifs, la diminution corrélée des cours en ces disciplines, l’augmentation à marche forcée des offres de formation en AI – déclenchait un émoi considérable, bien au-delà des frontières de l’université concernée.
Dans une interview accordée le 6 mars au Southern Weekly (南方周末) de Guangzhou, Jin Li précisait ses positions, sans se rétracter en rien. Il déclarait que l'université souhaitait former des étudiants « capables de faire face à l'incertitude de l'avenir ». Pour Jin, réduire de 20 % le nombre d'étudiants en lettres et sciences humaines (environ 35 % à Fudan aujourd’hui) est une nécessité sociale : « Combien d’étudiants en lettres et sciences humaines sont-ils nécessaires à l'époque actuelle ? (当前时代需要多少文科本科生 ?). »
Fudan est sans doute déjà dans le peloton de tête pour les cours donnés avec le soutien de l’IA : 116 au premier semestre de 2025, et c’est là qu’un début. La réduction du secteur des sciences humaines qu’elle planifie est loin d’être unique. Analysant les statistiques du ministère de l'Éducation sur les cours universitaires abolis durant l’année 2024 dans les universités chinoises, Southern Metropolis Daily (南方都市报) notait que la majorité concernait des diplômes en arts libéraux, certaines universités ayant même supprimé leurs facultés de sciences humaines.
C’est la conséquence d’une volonté planifiée : en 2023, le ministère de l'Éducation a publié un plan général de réforme centré sur l'introduction de nouvelles offres de cours pour « s'adapter aux nouvelles technologies » prévoyant l’élimination des formations « inadaptées au développement social et économique ».
Modernisation et interdisciplinarité
La position défendue par Jin Li – un généticien de formation, dont la recherche s’est concentrée sur la modélisation des migrations humaines, notamment en Asie orientale – est, sur le fond, moins caricaturale que certaines de ses déclarations à l’emporte-pièce semblent suggérer. Jin Li insiste sur la nécessité d’« intégrer les SHS aux sciences dures » pour mieux répondre aux défis globaux.
Il propose notamment la création de centres interdisciplinaires combinant philosophie, sociologie et technologies émergentes : une revalorisation des SHS via des projets appliqués (ex. études urbaines liées au développement durable) ; un financement accru pour les recherches en SHS ayant un « impact social mesurable ».
Il souhaite également qu’un modèle « d’internationalisation compétitive » contribue à ces objectifs : recrutement de chercheurs étrangers pour renforcer les publications internationales dans les programmes privilégiés ; et critères d’excellence bien quantifiés. Il n’empêche : le côté instrumental de l’approche globale est renforcé par d’autres annonces : l’importance soulignée d’une « éducation patriotique » intégrée aux SHS, notamment pour promouvoir les « valeurs socialistes » dans les cursus ; et le développement des recherches soutenant les politiques publiques (ex. gouvernance moderne, soft power chinois).
Un large débat critique
La vivacité du débat qui a suivi a surpris les observateurs. L’histoire de l’université Fudan explique en partie les oppositions déclarées au programme. Fondée par l’ancien jésuite Ma Xiangbo en 1905, lequel souhaite défendre l’esprit originel de l’Université Aurore créée deux ans auparavant et à son sens très tôt dévoyée. Fudan est connue pour sa tradition humaniste, son attachement aux arts libéraux, l’excellence de ses départements de chinois, histoire et philosophie. Entre 2000 et 2015 environ, à l’époque de la floraison point aboutie des médias chinois, son école de journalistes était la première de Chine.
Il s’agit cependant d’une université généraliste : sa faculté de médecine opère quatorze hôpitaux ; ses départements de sciences dures (mathématiques, physique théorique) sont parmi les tout premiers du pays. C’est dans les technologies qu’elle montre ses faiblesses, encore qu’elle ait réussi à développer remarquablement certains secteurs, notamment les technologies environnementales.
La devise de l’université peut être traduite, plus ou moins littéralement ainsi : « étendre la connaissance par une volonté ferme ; questionner sans trêve et réfléchir attentivement (博学而笃志,切问而近思) », idéal confucéen et humaniste s’il en est un.
Cela fait plusieurs années que des voix, internes et externes à l’université, regrettaient, de manière plus ou moins ouverte, l’érosion de cet idéal. Sur les réseaux sociaux, les annonces de Jin Li ont suscité de très nombreuses réactions d’internautes proches de l’université, ou originaires d’autres centres d’excellence, analyses généralement critiques (quoique assez souvent de ton résigné), certaines de ces analyses remarquablement longues et argumentées. Les paragraphes suivants résument un bon nombre de ces réactions, essentiellement celles parues sur le réseau social Weixin.
La première critique majeure porte sur l’écart entre le programme et l’esprit du lieu ; Fudan ne saurait devenir une autre université Qinghua, disent plusieurs, et la réforme annoncée ne saurait que lui faire perdre sa réputation traditionnelle sans réussir à lui en octroyer une autre.
La deuxième critique majeure est celle que l’on peut attendre : en tant que cette réforme reflète une tendance nationale, les SHS risquent de devenir davantage encore des outils au service d’un agenda politique ou économique, au détriment de la liberté académique. La priorité donnée aux projets « socialement utiles » marginalise automatiquement les recherches théoriques ou critiques. Ces critiques contre le projet ont pu être énoncées parce que plusieurs d’entre elles ont trouvé un angle politiquement acceptable. Ainsi, plusieurs participants dénoncent « l’occidentalisation excessive » des SHS que suppose leur instrumentalisation sociale, occidentalisation qui menace encore plus l’étude des classiques chinois. En réponse, Jin Li défend une « synthèse créative » entre héritage culturel et méthodes modernes.
Un angle d’attaque connexe s’inspire de ce que l’on pourrait nommer « l’humanisme marxiste ». Cette perspective tente d’opérer une synthèse entre certains aspects du projet porté par Jin et la défense d’une certaine tradition. Un internaute argumente ainsi :
« La vision marxiste de l'éducation met l'accent sur ‘le développement global des êtres humains’ et estime que l'éducation doit « cultiver tous les attributs humains de la société ». Dans la pratique éducative actuelle, le programme d'études en sciences humaines est devenu un bibelot ajouté sur la formation technique, et l'éducation politique est restée un discours de façade. Cette aliénation a réduit l'éducation, qui est censée façonner l'âme, à une chaîne de montage de formation professionnelle. La tragédie de Wan, doctorant au département de chinois de l'université de Fudan, est précisément la cruelle conséquence de cette aliénation de l'éducation : lorsque les tests quantitatifs deviennent l'épée de Damoclès suspendue au-dessus des enseignants et des étudiants, les questions sur le sens de l'existence et les réflexions sur la valeur à donner à la vie deviennent un luxe. Les dilemmes de la déconstruction exigent un retour à la nature méthodologique du marxisme. (…)
Dans le projet de réforme de l'université Fudan, la construction de « nouvelles lettres et sciences humaines » ne doit pas se limiter à une simple cure d’amaigrissement des disciplines traditionnelles, mais doit parvenir à une intersection profonde de la littérature et de la science : le département de philosophie peut explorer l'éthique scientifique et technologique avec le laboratoire d'intelligence artificielle. L'École d'histoire peut collaborer avec le Big Data Center on Digital Humanities, une innovation interdisciplinaire qui préserverait le patrimoine des sciences humaines tout en répondant aux besoins de l'époque. La restructuration de l'écosystème de l'enseignement des sciences humaines nécessite un changement systémique au niveau institutionnel.
Je propose de créer une ‘banque de crédits pour la culture générale en sciences humaines’ obligeant les étudiants en sciences et en ingénierie à suivre des cours de base en sciences humaines tels que la philosophie et l'art ; de créer un ‘fonds transversal pour les sciences, la technologie et les sciences humaines’ afin de soutenir la recherche conjointe sur des sujets majeurs dans les arts et les sciences. (…) Ces transformations institutionnelles peuvent à la fois faire tomber les barrières disciplinaires et cultiver des talents composites, transformant la sagesse traditionnelle consistant à ‘cultiver sa propre personne, gouverner son pays et faire du monde une totalité’ en une ressource intellectuelle qui puisse contribuer à résoudre les dilemmes de la modernité. »
On le voit : ici, les critiques formulées n’empêchent pas un accord de fond sur le projet développé par Jin Li lorsqu’on regarde au-delà des titres porteurs. En Chine, la fascination ressentie devant les Big Data et les progrès fulgurants de l’IA (notamment depuis le succès de Deep Seek, célébré par tous comme un triomphe national) l’emporte le plus souvent sur les autres considérations, même parmi ceux qui entendent défendre une certaine tradition humaniste.
Des résistances spécifiques s’expriment pourtant avec vigueur. Elles concernent le sous-financement des SHS et le risque flagrant de standardisation de la recherche (une standardisation déjà très largement avérée). Des chercheurs craignent aussi la perte de spécificités des SHS chinoises au profit de normes globalisées. La fusion de départements historiques (ainsi celle, possible à terme, de la philosophie et des sciences politiques) suscite également des craintes et des critiques prononcées.
Perspective
Le projet de Jin Li n’est pas sans mérites, et son ambition de développer ce qu’il appelle les « sciences hybrides » - des disciplines associant SHS, technologies et sciences dures, notamment par le recours aux Big Data et à l’AI – ne saurait être simplement ignoré. Ses faiblesses n’en sont pas moins patentes : l’esprit critique est déjà fort peu développé au sein des universités chinoises.
L’éducation à la sensibilité et à l’exercice de l’imagination est presque inexistante. Les « bases historiques » (pour la philosophie, l’apprentissage de la lecture minutieuse des classiques, chinois et/ou occidentaux) sont de plus en plus négligées au profit souvent de modes passagères. En fait, les sciences sociales en Chine sont d’ores et déjà entrées en crise, alors que leur développement entre 1980 et 2010 environ a été remarquable. Bien entendu, les contraintes proprement politiques jouent un rôle. Mais pas seulement ; le quantitatif a primé sur le qualitatif, et les jeunes chercheurs ignorent ainsi ce que c’est que « perdre du temps » avec leurs sujets d’enquête pour les comprendre, entrer dans leur monde.
Très peu de sociologues et d’anthropologues sont véritablement formés. En conséquence, nos connaissances sur la société chinoise « réelle », sa sensibilité, ses ressorts, son vécu, sont aujourd’hui minimes. Le pouvoir lui-même
« sait » bien davantage qu’il ne « comprend ».
Les réformes, bien entendu, « passeront », et les objectifs de Fudan sont et seront ceux de toutes les universités chinoises. Un risque de polarisation n’en existe pas moins, et la mise en œuvre du programme en souffrira nécessairement. Surtout, les contradictions entre une vision technocratique de l’éducation et la mission humaniste des SHS seront encore exacerbées. Reconnaissons en tout cas un grand mérite au projet lancé par Jin Li : il a suscité un débat sur la mission et la nature des SHS qui n’avait pas gagné la place publique depuis bien longtemps.
*****
Benoît VERMANDER, jésuite, est professeur dans la Faculté de philosophie de l’université Fudan à Shanghai, où il enseigne l’anthropologie du fait religieux et les classiques chinois en perspective comparée. Ses publications en français comprennent Que cette demeure est donc précaire ; De Chine, penser en pandémie (Ressuis, 2020) ; L’Homme et le grain (Les Belles Lettres, 2021, en collaboration avec Alain Bonjean) ; Comment lire les classiques chinois (les Belles Lettres, 2022).