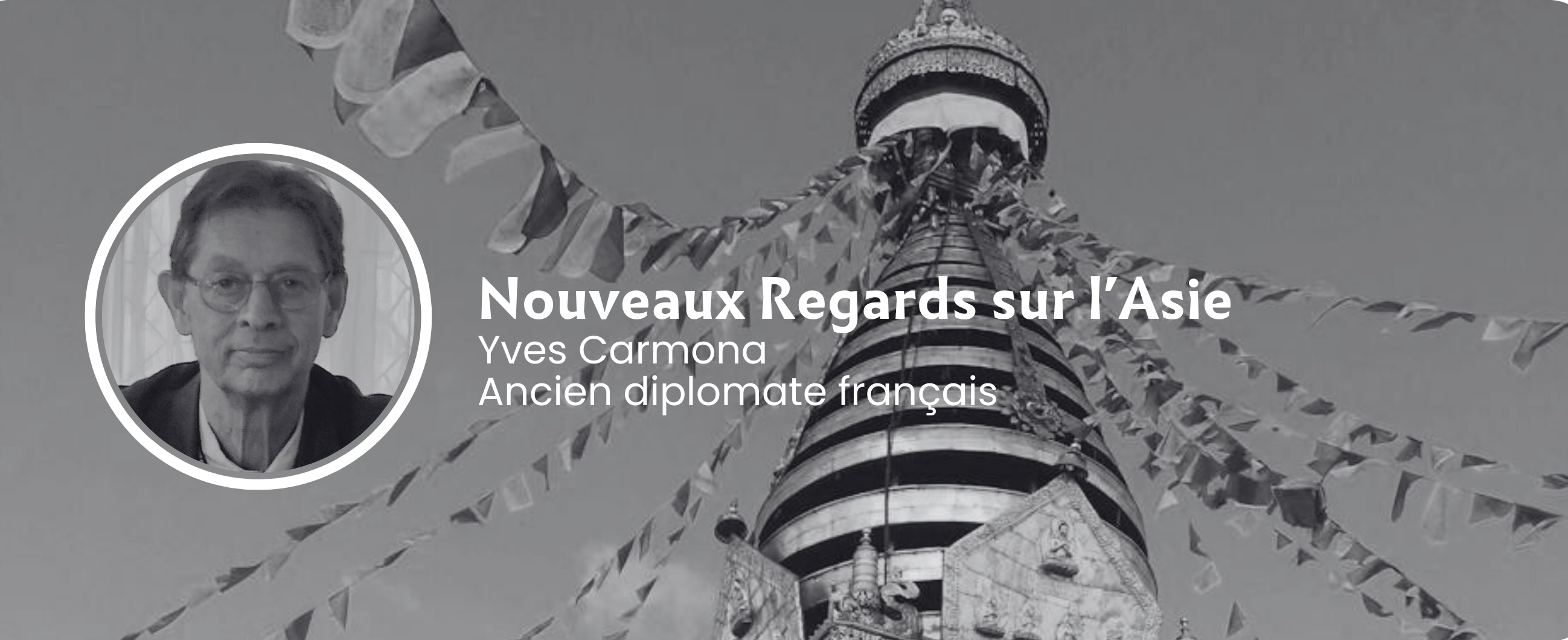
Par Yves Carmona
Écrire sur le Népal, c'est à la fois un enchantement, car l'auteur de ces lignes y a passé quelques-unes des plus belles années de sa vie, et un déchirement, car ce pays et sa population magnifiques connaissent certains des plus tristes épisodes de l'actualité, récente ou pas.
Commençons par son gouvernement.
Trois septuagénaires tous « communistes » et tous brahmanes (la plus haute caste), MM Oli né en 1952, 4ème mandat de Premier ministre, Deuba né en 1946, 5 mandats et Prachanda né en 1954, 2 fois Premier ministre, se passent et se repassent la charge dont même eux ne savent pas quand la valse prendra fin - ce n'est pas le seul pays où ça se produit bien sûr - changeant d'alliance au gré de leur seul intérêt : garder le pouvoir et en profiter pour un luxe relatif, par exemple de pouvoir aller à l’hôpital, quand le besoin se fait sentir, en Inde ou ailleurs mais le moins possible dans leur pays…
Cela dure depuis qu'en 1990 le Roi a accepté un moindre absolutisme, mais cela n'a pas suffi et la guerre civile entre l'opposition dirigée par le « maoïste » Pushpa Kamal Dahal alias Prachanda (« le féroce ») a combattu la monarchie de 1996 à 2006 après que le massacre d’une partie de la famille royale, dont on ne connaît avec certitude ni l'auteur ni la motivation, ait achevé de déconsidérer la monarchie. Il faudra attendre 2015 pour que les partis se mettent d'accord sur une Constituante qui permit des élections au suffrage universel à l'automne 2017 - avec quel enthousiasme le peuple a exercé alors pour la première fois son droit de vote !
Les Népalais vivent dans un des 10 pays les plus pauvres du monde, qui subit des catastrophes à répétition dont les tremblements de terre, le dernier en date de cette importance, le 25 avril 2015, a tué environ 10 000 personnes - et ce n'est pas le premier. Le Népal, ce sont aussi des territoires de très faible altitude et donc de fréquentes inondations, phénomène auquel s'ajoute récemment, du fait du changement climatique, le débordement de lacs glaciaires - cela s'est produit le 16 août 2024, apparemment sans victimes, mais la menace est d'autant plus sérieuse qu'un séisme pourrait à l'avenir détruire un barrage hydroélectrique. Le financement d’un nouveau barrage sur le haut Arun (upper Arun) est compromis d’une part par des considérations écologiques et d’autre part par les réticences de Delhi à financer un projet dont elle ne serait pas chargée.
Malgré cette épée de Damoclès au-dessus de leurs têtes, les Népalais s'acharnent à aller de l’avant. Cependant, le GAVI (organisation internationale fournissant des vaccins aux pays pauvres) indique que les cas de dengue, fièvre répandue par les moustiques à chaque mousson, ont augmenté depuis 20 ans, aggravés par le changement climatique.
Les Népalais qui le peuvent font de l'alpinisme une ressource toujours plus importante quitte à accepter le risque d'aéroports de montagne dangereux ou de vols en hélicoptère parfois emportés par une bourrasque. Les plus connus, et aussi les plus prospères, sont les « Sherpas », ethnie d'origine tibétaine vivant aux confins de la Chine, qui concèdent souvent à d'autres - les Tamang, Gurung et Rai - le portage. Industrie lucrative, souvent la seule à être connue en Occident – il lui a fallu du temps pour reconnaitre que le vainqueur de l'Everest, Edmund Hillary, un Néo-Zélandais, n'aurait pas accompli son exploit en 1953 sans le sherpa Tensing Norgay ce dont lui, en revanche, a toujours été reconnaissant – l’alpinisme ou plutôt l’himalayisme est loin d'assurer à tous un emploi. Or 500 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail et le Népal ne parvient pas à tous les satisfaire.
En fait, la ressource principale du Népal – la Banque mondiale l’estime à près de 30 % du PNB - repose sur les « remittances », les virements envoyés à leurs familles par les millions d'émigrés. Les plus connus sont ceux qui travaillent à en mourir pour construire les grands équipements, par exemple les stades de la coupe du Monde de football au Qatar en 2022. Le Ministère du travail vient de révéler que 14 213 Nepalais avaient perdu la vie depuis la création du « Foreign Employment Board Secretariat » en 2008. Le nombre est certainement plus élevé car l'émigration est devenue un phénomène de masse depuis 2000 du fait de la guerre civile.
Mais la migration est un mode de vie au Népal de longue date, pas toujours définitif et parfois en sens inverse, beaucoup d’Indiens venant y moissonner pendant l'été et un certain nombre de Tibétains y échappant aux tentatives du Parti communiste chinois de les faire disparaître, moins physiquement qu’après l’invasion de 1959 mais démographiquement et culturellement, avec la « hanisation » de Lhassa et d’une grande partie de la province. De longue date aussi, les Gorkhas avec leur fameuse épée « khukri » ont constitué la part la plus célèbre de l’émigration, le Royaume-Uni leur assurant même la nationalité depuis 2007. Cependant, ce sont les États-Unis, d’après un récent rapport américain, qui connaissent le volume de non-résidents le plus important. Plus de 200 000 Népalais environ y vivraient, pour la plupart depuis 2010. 60% de cette diaspora enverrait de l'argent au pays, dépassant largement en valeur d'autres pays d'émigration (Qatar, Malaisie, Émirats, Arabie Saoudite).
Encore le rapport évoque-t-il peu la Corée du Sud et le Japon où pourtant nombreux sont les migrants, souvent inscrits à l'Université et non comme migrants officiels, apprenant donc au moins des rudiments de japonais pour pouvoir présenter leur dossier, acceptés pour 3 ans renouvelables et fondant souvent leur entreprise, par exemple en électronique, à leur retour. Ce rapport ne dit rien non plus de l'abondante émigration en Inde, qui n'est pas comptabilisée car la frontière de 1700 km est poreuse et on peut circuler sans passeport entre les deux pays; lorsque l’émigration est féminine, elle finit parfois mal : l'emploi domestique se traduit souvent par de mauvais traitements ou pire compte tenu du genre. Pour se tourner vers l’avenir, donnons la parole à un grand ami, Sujeev Shakya (dans quel autre pays pourrait-on rencontrer un descendant du Bouddha Shakyamuni ?) qui écrit dans son dernier livre « Unleashing the Vajra » (on pourrait traduire « libération de la foudre ») : « Chaque fois qu’un ami se plaint de la vie au Népal, ma question toute simple est : peux-tu citer 5 personnes de ta connaissance qui vont moins bien qu’il y a 10 ou 20 ans ?
Or 10 000 étudiants par an vont aux États-Unis, le Népal a la 48ème population mondiale, son PNB a plus que quadruplé de 10 Milliards de $ en 2006 à 44 en 2024. Le volume du commerce incite à se demander d’où vient l’argent. Notons que le taux de scolarisation atteignait 97% en 2019, qu’une majorité de femmes poursuivent des études supérieures dans une population dont la moitié a moins de 25 ans. et que le taux d’extrême pauvreté (moins d’1,25 $ par jour) a baissé de moitié depuis 2005, l’espérance de vie s’est allongée de 55 ans en 1990 à 72 ans en 2018.» Mais, poursuit Sujeev, il n’y a pas que de bons côtés. « Premièrement, une culture de rente, donc de cartellisation politisée qui pousse les jeunes à chercher à l’étranger une herbe plus verte, d’autant que le système des castes sévit encore, même pour l’accès à l’eau ou à l’électricité.
C’est ainsi que la vallée de Kathmandou est devenue une décharge de béton, faisant de la vue sur la chaîne de l’Himalaya, de l’air pur et d’un espace libre un luxe.» C’est que le Népal attire des convoitises. « L’Inde a un besoin insatiable de matériaux de construction (bois, sable, etc.) et en fournir à partir du Népal est devenu fort lucratif. Les 10 ans d’insurrection et les 12 ans de transition qui ont suivi ont offert des conditions politiques idéales pour ce genre d’affaires. En trois décennies, nous avons transformé la belle vallée de Kathmandou et quantité d’autres petites villes ou villages en un paysage urbain que nous déplorons sans faire grand-chose pour que cela s’arrange ». Les enjeux actuels doivent être soulignés.
1/ On écrit beaucoup sur les tares gouvernementales, mais qu’en est-il du secteur privé et de celui de l’aide au développement ?
2/ Le capitalisme est fréquemment stigmatisé, mais à défaut de le renverser, comment agir en son sein ?
3/ L’émigration n’est pas qu’une nécessité due à la pauvreté, n’est-ce pas aussi un moteur d’insertion dans le monde ? [cf ci-dessus]
4/ L’influence indienne est abondamment décriée mais quid du voisin chinois ?
1/Redoutant la concurrence internationale,
beaucoup d’entrepreneurs népalais ont préféré des politiques protectionnistes, se repliant dans leurs corporations plutôt que de rendre leurs affaires internationalement compétitives ; ainsi prédominent le corporatisme et le poids des castes, même si cela évolue depuis que le libéralisme l’a emporté en 1990 sur la monarchie absolue puis que l’avènement de la République en 2006 a ouvert les carrières. Encore aujourd’hui, les divers groupes d’intérêt cultivent en priorité leurs relations avec le pouvoir qui leur permet de financer les campagnes électorales et de restreindre le nombre d’entreprises, notamment étrangères, susceptibles d’améliorer une productivité très insuffisante.
Dans ce contexte, les « syndicats » sont généralement associés avec cette politique d’exclusion souvent mafieuse, ainsi que l’association des non-résidents implantée dans plus de 100 pays et devenue un puissant outil de financement partisan au Népal alors qu’à l’étranger, elles affectionnent souvent les « petits Népal ». Pas étonnant que le Népal baisse dans les indices mesurant la facilité à faire des affaires (« Ease of Doing Business ») mais c’est surtout l’instabilité du cadre légal qui effraie les investisseurs internationaux. Certaines « success stories » cependant réussissent à briser les barrières, ainsi que ces designers de mode, chirurgiens de haut niveau, créateurs de chaînes d’hôtels sans parler d’artistes et écrivains de plus en plus reconnus.
2/ Capitalisme et socialisme
Le Népal est en principe une économie de marché avec un gouvernement associant selon les moments différentes sortes de communistes mais l’idéologie est utilisée pour capter les bénéfices inégalement répartis et se dresser contre le « monde capitaliste » de l’Occident. Or l’expérience, même chinoise, montre que la prospérité nait d’entreprises individuelles « protégées par la Loi » selon M. Shakya plutôt que d’aide au développement ou d’interventions gouvernementales, surtout à l’ère du code QR et autres technologies électroniques ; mais les entreprises auraient tort de se complaire dans le protectionnisme au détriment de la qualité.»
Le fédéralisme consacré par la Constitution de 2015 et mis en oeuvre par les élections de 2017 fait actuellement l’objet de critiques, certains accusant les gouverneurs des provinces de se comporter comme le Roi autrefois et d’avoir ainsi multiplié par 7 les travers du pouvoir absolu. Mais il a aussi permis une résistance contre l’effacement de l’identité, des terres et de la culture autochtones dans une province située loin de la capitale, tout à l’Est du pays. D’autres pays dans la même situation montrent qu’avec une gouvernance efficace et pas trop coûteuse, qui ne refuse pas la mondialisation, le Népal peut aller vers un « capitalisme de bien-être », il détient les atouts nécessaires. « Il faut une vision de long terme comme en Malaisie, Singapour ou dans les pays scandinaves. En 2050, la Chine et l’Inde seront les deux plus grandes économies du Monde. (…) Le Népal, certes, aura vieilli mais doit profiter des opportunités que cela va créer ».
Encore faudra-t-il, selon notre ami, qu’il « investisse 7-8 Milliards $ par an au lieu de 2 actuellement et cela incombe au secteur privé, comme l’indique mon rapport rédigé pour la Banque asiatique de Développement (BAD) et la Commission de planification présidée par Swarnim Wagle [NB un expert de haut niveau connu de l’auteur de ces lignes] ». Le rôle de l’Etat est de « veiller à que l’inégalité des revenus soit régulée, les droits des consommateurs protégés et des conditions égales de concurrence assurées à tous ». 5 réformes y seront nécessaires :
- Le système fiscal doit être réformé;
- La valeur et les règles d’usage du sol doivent être adaptées;
- Le marché des capitaux doit être plus ouvert;
- Le marché du travail orienté vers la formation ;
- Les institutions financières qui doivent être plus accessibles.
4/ L’avenir du Népal entre Chine et Inde.
Faut-il le rappeler, le Népal n’est petit que comparé aux deux géants dont il est le voisin. On estime qu’en 2050, la Chine et l’Inde auront dépassé les États-Unis et détiendront les deux principaux PNB dans le monde. Sans compter la croissance continue des pays d’Asie du Sud-Est (ASE) et celle du Pakistan. La place des deux grands voisins ne sera en fait qu’un retour à l’ère préindustrielle où ils contrôlaient 80% du commerce mondial. C’est le Roi Prithvi Narayan Shah qui, en 1768, a établi son contrôle sur la route commerciale Chine-Inde. Celle-ci a été interrompue par les vicissitudes géopolitiques, notamment la guerre entre les deux géants en 1962 qui a donné au Népal un rôle de tampon adhérant de gré ou de force à la politique d’une seule Chine, laquelle s’applique non seulement à Taiwan mais également au Tibet, l’Empire du milieu y veille sans faiblesse comme l’auteur de ces lignes a pu le constater lors de son séjour au Népal.
Le paradoxe est que les Népalais ont à tous égards – langue, culture, cinéma, séries télévisées, musique, etc - les yeux tournés vers l’Inde mais en font le bouc-émissaire par excellence de leur nationalisme. « Il est vrai, rappelle Sujeev Shakya, qu’elle a imposé au Népal un blocus quasi-total en 2015-2016 alors qu’il venait de subir un séisme meurtrier. C’est encore elle qui contrôle ses routes aériennes et prive ce pays montagneux d’un développement hydroélectrique régional auquel il a vocation. En sens inverse, l’instabilité politique décourage l’investissement dont l’Inde reste le numéro 1. Au point que le premier ministre Oli tente à nouveau, comme lors de son mandat de 2015-2016, de jouer la carte de la Chine avec laquelle pourtant la barrière de l’Himalaya constitue un obstacle infranchissable.
Ainsi, depuis que le Premier ministre indien Modi a établi en 2014 un pouvoir de plus en plus dictatorial, l’aide chinoise a été utilisée pour diversifier le commerce comme l’accès à Internet. L’Empire du milieu, à travers l'Institut Confucius, répand le langage mandarin et accorde un grand nombre de bourses entre autres outils de “soft power” ». L’auteur de ces lignes a assisté à une conférence sur le bouddhisme tibétain dispensée dans un hôtel de Katmandou par un éminent professeur chinois dont le propos en mandarin était interprété en anglais mais l’écrasante majorité de l’auditoire était constitué de jeunes Chinoises venues spécialement l’entendre.
La hausse du renminbi et plus généralement la forte croissance chinoise accroissent son influence. Reste à prolonger la Nouvelle Route de la Soie (BRI) qui rivalise avec la route indienne, les deux devant se croiser à Kathmandou – les deux géants y parviendront-ils pacifiquement ? Hindustan Times écrit que « l’influence grandissante de la Chine sur le Népal est un enjeu stratégique pour l’Inde ». La récente visite à Pékin du Premier ministre Oli, alors que l’Inde bénéficiait jusque là de la préséance, n’a échappé à l’enrégimentement verbal qu’au prix de contorsions sémantiques, un « Belt and Road Initiative Framework Cooperation Agreement » a bien été souscrit mais personne n’y a vu de différence.
Quant à elles, les relations sino-indiennes n’ont cessé de s’intensifier et de s’améliorer bien qu’un affrontement dans l’Arunachal Pradesh les ait encore opposées en décembre 2022 tandis que la menace chinoise au Pakistan et au Sri Lanka nourrit l’inquiétude de Delhi. Reste donc au Népal à arrimer sa croissance à celles de ses voisins. Et ce n’est pas le « communisme » ou le « maoïsme », importés d’Inde et non de Chine comme on pourrait le croire qui y contribueront. Mais l’Inde tient à garder toute son importance au Népal et écrit dans le journal des Affaires étrangères que « Lumbini, site du patrimoine mondial de l'UNESCO et l'une des quatre destinations de pèlerinage les plus sacrées du bouddhisme, a une grande importance pour les adeptes du bouddhisme du monde entier. Selon les Écritures bouddhiques, Maya Devi a donné naissance à Siddhartha Gautama ici en 624 avant notre ère. Siddhartha a ensuite atteint l'Éveil pour devenir Shakyamuni Bouddha, le fondateur du bouddhisme. » Une visite à Lumbini en témoigne, la présence massive de pèlerins indiens est indéniable. Hélas, le plurilatéralisme n’est pas d’un grand secours pour sortir de ce face-à-face car le Népal, pourtant siège de la South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) depuis 1987 n’a pas pu, du fait de l’exécrable relation Inde- Pakistan, tenir de sommet depuis 2014. BBIN (Bangladesh, Bhutan, Inde et Népal), association signée en 2015 est censée y pourvoir – mais la Chine n’en fait pas partie. BIMSTEC (Initative pour la coopération économique dans la baie du Bengale) qui associe deux pays d’ASE et cinq d’Asie du Sud est plus maniable mais elle ne comprend pas non plus la Chine. Le Népal reste enfermé dans ses frontières. Un ami dont le fromage fait fureur à Kathmandou ne peut l’exporter à Delhi où il est apprécié qu’en le dissimulant dans sa valise… Ainsi écrit M. Shakya « les frontières sont ouvertes 24/24 en Afrique orientale et dans l’ASEAN, le Népal pourrait s’en inspirer.». Comme le souligne le même auteur, la culture du thé enjambe la frontière indo-népalaise et il faudrait un changement radical de la législation pour favoriser la connectivité dans cette région frontalière. N'est-ce pas ce que prône l’Acte unique européen depuis qu’en 1986 il a instauré la libre circulation des marchandises, personnes, capitaux et services, les 4 libertés fondamentales ?
Conclusions : Le Népal est bien plus, comme le présentent tant de médias, qu’un terrain d’alpinisme, où l’on sacrifie lors d’une fête traditionnelle « plus de 11 000 buffles et des dizaines de milliers de chèvres, pigeons, poulets etc. » ce qui provoque l’ire de Brigitte Bardot. C’est aussi un endroit jeune, plein de dynamisme, où l’on manifeste de manière exubérante, où l’on lit beaucoup en anglais et en népali alors qu’à Paris, le nombre de librairies a baissé de 40% depuis l’an 2000, vaincues par les boutiques de mode et les smartphones. Un pays où paradoxalement le taux de bonheur, comme le signalait récemment le Nepali Times dont le rédacteur en chef Kunda Dixit, un courageux critique des abus de pouvoir, ne cesse d’augmenter.
Où la presse est peut-être la plus libre d’Asie et la culture ou plutôt les cultures d’une diversité peu commune. Dans quelle autre contrée réunir un sommet sur fond d’Himalaya pour la 9ème fois au cours des 20 dernières années, associant journalistes, traducteurs, activistes, technologues, hommes et femmes politiques et experts du développement de tous pays pour discuter d’expression libre et de diversité linguistique ?
Alors, il faut souhaiter que le Népal atteigne ses objectifs économiques, actuellement 3,7% par an ce qui n’est pas beaucoup, en partie grâce au tourisme mais que celui-ci ne privilégie pas la quantité sur la qualité et reste soutenable, que l’investissement permette de meilleures infrastructures et que ce pays recouvre la beauté dont il était doté avant qu’une modernisation au rabais l’estompe depuis les années 1970, que le secteur hydroélectrique déjà de loin numéro 1 garde toute sa place et son Directeur, qui l’a porté très haut, le reste malgré l’hostilité du pouvoir politique.
*****
Yves Carmona
Ancien élève de l’ENA et diplomate, Yves Carmona a passé la plus grande partie de sa carrière en Asie : conseiller des Affaires étrangères au Japon à deux reprises, premier conseiller à Singapour et ambassadeur au Laos puis au Népal (2012-2018). Dans ces postes comme dans ceux qu’il a occupés à Paris, il a concentré, y compris comme étudiant en japonais, son attention sur l’évolution très rapide des pays d’Asie et de leurs relations avec la France et l’Europe. Désormais retraité, il s’attache à mettre son expérience à disposition de ceux et celles à qui elle peut être utile.